
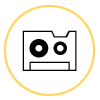
|
Goldman – Rocard : le débat
|
Goldman – Rocard : le débat
Le nouvel Observateur Numéro 1213, 5-11 février 1988
Propos recueillis par Claude Weill
Retranscription de Bénédicte Moyen
Goldman-Rocard : le débat Ecole, fac, tiers monde, Restos du Coeur
Quand le chanteur préferé des jeunes s'entretient avec la star des sondages.
Jean-Jacques Goldman : Mitterrand est au pouvoir, Barre, on l'a eu comme premier ministre, Chirac aussi. Il n'y a qu'un homme politique majeur qu'on n'a pas encore vu à l'oeuvre. Et donc la "surprise" ne peut venir que de lui. Voilà pourquoi il me paraît intéressant de vous interviewer vous, Michel Rocard, et pas un autre.
Michel Rocard : Eh bien d'accord, on y va !
Jean-Jacques Goldman : Commençons par la formation. Vous dites que c'est la clef de l'avenir. Or quand un PDG n'a pas de résultats, le conseil d'administration le fout dehors, quand un chanteur fait un bide, il change de métier. Mais quand un professeur n'enseigne pas, est incapable d'enseigner, dégoûte ses élèves, là, ça peut durer des années, des générations, une carrière. Pourquoi les gens les plus importants pour l'avenir sont-ils les plus protégés ? C'est un privilège hallucinant !
Michel Rocard : Je conviens tout à fait qu'il y a certains excès dans les protections liées au statut de la fonction publique. Ce que vous avez dit n'est d'ailleurs pas vrai pour les seuls professeurs…
Jean-Jacques Goldman : C'est plus grave dans leur cas...
Michel Rocard : C'est toujours grave, un fonctionnaire inefficace. Donc c'est un problème plus général. Mais enfin, des professions protégées, il y en a un peu partout. Et il y a bien d'autres types de protections : je pense par exemple à certaines rentes de situation des notaires, des chauffeurs de taxi, etc. Donc il faut mettre de la souplesse dans la société française tout entière. C'est possible si c'est progressif et si l'on donne à ceux dont on remet en question les sécurités le sentiment qu'ils ne sont pas seuls à payer les pots cassés.
Jean-Jacques Goldman : Il y a «fonctionner» dans fonctionnaire...
Michel Rocard : Oui, mais il faut voir aussi ce qu'on les paie. Un bon cadre, chez moi, dans ma commune de Conflans, est payé de 7 000 à 8 000 francs par mois. Il serait payé le double dans le privé, en tout cas une fois et demie. Quand un instit en début de carrière est payé moins que des professions... je ne veux pas en citer, ce serait incendiaire, mais enfin, regardez la grille des salaires dans l'enseignement. Autrement dit, il y a un problème de revalorisation de la fonction enseignante. On peut faire tomber certaines sécurités, en effet excessives, mais à la condition de donner à cette profession la garantie qu'on s'occupe d'elle.
Jean-Jacques Goldman : C'est vrai que de 7 000 à 8 000 francs c'est pas assez pour celui qui fait bien ce boulot, mais c'est beaucoup trop pour celui qui le fait mal.
Michel Rocard : Et un instituteur commence plus bas que ça !
Jean-Jacques Goldman : Et vous croyez que les syndicats accepteraient de perdre un peu de sécurité en échange d'un traitement simplement décent ?
Michel Rocard : Il y a chez les enseignants une peur considérable pour l'avenir de leur métier. Ils sentent bien que le système est menacé. La crise de l'enseignement, aujourd'hui, est le résultat de trente ans de non-gestion. Quand, d'année en année, le ministère des Finances rogne sur les traitements, mais aussi sur les autres crédits : l'entretien des écoles, le matériel pédagogique (il n'y a plus de cartes de géographie dans les lycées de Paris ni d'appariteurs pour les transporter), on crée des conditions de travail impossibles pour ces hommes et ces femmes. Ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Et il y a une démobilisation qui vient largement de là. Il faut le savoir. Cela étant, s'il y a des cas scandaleux il y a aussi des gens admirables...
Jean-Jacques Goldman : Je ne le nie pas.
Michel Rocard : Et moi j'ai envie de le dire.
Jean-Jacques Goldman : Mais je trouve qu'ils sont pénalisés par cette espèce de complaisance généralisée.
Michel Rocard : Tout à fait. Mais on ne pourra s'y attaquer qu'à la condition de dynamiser tout le système. Et c'est l'enjeu du septennat qui vient. Vous savez pourquoi j'ai annoncé que le prochain Premier ministre devrait se charger de l'Education ? Parce qu'il y a une longue tradition en France qui veut que, quand il y a un problème extrêmement lourd, le patron s'en charge. C'est le seul moyen d'assurer que, dans les arbitrages interministériels hebdomadaires, sinon quotidiens, qui sont le lot du gouvernement, le parti pris soit du bon côté.
Jean-Jacques Goldman : Une autre chose qui m'étonne : toutes les études scientifiques montrent que l'avenir d'un élève, à 90 %, se joue avant l'âge de 10 ans. Comment se fait-il que ce soient les instituteurs et les enseignants de maternelle les moins formés et les moins rémunérés ? Ce devrait être eux les stars de la pédagogie, et non pas les profs de fac.
Michel Rocard : Belle idée ! Mais, écoutez, il y a de 7 800 à 8 000 enfants scolarisés sur ma commune. C'est vrai, les relations avec le système éducatif ne sont pas toujours faciles. Tenez, il m'est même arrivé un jour, revêtu de mon écharpe, d'aller faire le gardiennage des enfants à la cantine parce que le rectorat avait décidé de supprimer le personnel de surveillance...
Jean-Jacques Goldman : C'était bon ?
Michel Rocard : Pas mal !
Jean-Jacques Goldman : Carottes râpées, poisson pané, frites et pomme ?
Michel Rocard : Non, ce jour-là c'était steak-purée. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas enterrer le système trop vite ! Il y a des résultats, il y a quelques améliorations. Pour ce qui est des maternelles, il faut à tout prix en défendre la qualité. Elle est bonne. Ce qui manque, c'est la quantité. L'école primaire : la revalorisation de la condition de l'instituteur est engagée ; la formation a été rallongée d'un an. Le point ultra-chaud, maintenant, il est dans le secondaire. Problème de pédagogie et de contenu des programmes dans les collèges. Et problème quantitatif dans les lycées. Il nous manque à travers la France de 80 000 à 100 000 places. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un bon contrat pluri-annuel, discuté avec toutes les parties prenantes : les enseignants, les parents, les syndicats, le CNPF, embrassant l'ensemble des problèmes qui se posent.
Jean-Jacques Goldman : Toujours à propos des privilèges de la fonction publique : il y a un quasi monopole des fonctionnaires, en particulier des professeurs, dans la classe politique, et dans l'ensemble, c'est pas dans la classe politique que j'ai rencontré les gens les plus brillants ni les plus proches des problèmes concrets. En revanche, j'en ai rencontré dans le privé, à la tête d'entreprises, et je me suis dit que ces types-là seraient très utiles dans la gestion de la société France. Or quelqu'un qui est dans la fonction publique peut s'en aller pendant deux ou trois ans puis réintégrer son poste, ce que les gens du privé ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cet état de choses ?
Michel Rocard : Il est vrai qu'on n'aura pas un rééquilibrage du personnel parlementaire si on ne traite pas mieux le statut des élus. C'est très difficile à faire. Les chefs d'entreprise sanctionneront inévitablement, en termes de promotion, un employé qui va passer trop de temps à s'occuper d'autre chose que de faire tourner l'entreprise. L'unique réponse, je crois, est de donner à tout élu qui perd son mandat le droit d'exiger sa réintégration dans son emploi. Mais seules les plus grandes entreprises, celles qui ont plus de 1 000 salariés, pourraient faire face. Il faudrait donc probablement un engagement du CNPF pour le compte des PME, garantissant un droit à être recasé en priorité. Ça jouerait sans doute plus pour les hommes politiques de droite que de gauche, mais ça je suis tout à fait prêt à l'assumer.
Jean-Jacques Goldman : C'est peut-être aussi une des raisons du décalage entre la classe politique et la réalité.
Michel Rocard : Je ne signerais pas ça. Il y a le problème de la politique professionnelle. Le drame, c'est que 1) il n'existe pas de système de formation des hommes politiques, mais 2) je ne suis pas du tout sûr qu'il en faille. Quels sont les cheminements ? Il y en a trois, en gros. D'abord, le parachutage en politique de gens qui ont une grande expérience acquise ailleurs. C'est le cas de Raymond Barre ou de Pompidou. Un autre moyen d'arriver en politique, c'est de gravir la hiérarchie des mandats locaux : maire, conseiller général, etc. C'est une excellente formation, à un détail près, qui compromet le tout : c'est qu'elle ne met jamais les individus en relation avec les affaires internationales. La troisième voie, ce sont les appareils militants. Ce cheminement ouvre à une formation politique polyvalente. Simplement, il exige aussi des échines très souples, une grande capacité de servilité, à moins d'affronter des risques énormes... Moi, je suis un miraculé.
Jean-Jacques Goldman : Justement, depuis la cohabitation, on a assisté à un changement du rôle du président de la République. Il est devenu plus un représentant, quelque chose d'un peu inutile comme la reine d'Angleterre, ou un acteur américain aux dents bien alignées. Vous pensez que c'est irréversible ou que c'est dû seulement aux circonstances ?
Michel Rocard : Le fait que, pour la politique intérieure courante, ce soit le Premier ministre qui décide, que le président de la République n'ait plus le pouvoir, cela me paraît largement réversible. L'habitude s'était prise que les présidents en fassent trop. Trop de choses remontaient au sommet, c'est vrai. Mais il faut veiller à l'équilibre du système. L'élection présidentielle est devenue l'élection la plus importante. Par conséquent, toute la pyramide des talents, des ambitions, des servilités s'organise en fonction de cette échéance. Donc, même si la lettre de la constitution dit que "le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation" personne n'ose agir sans l'accord du président. Et il faudra, si l'on retrouve des majorités convergentes, une grande volonté aux présidents de la République à venir pour refuser de se mêler du quotidien. Pour avoir la préoccupation du long terme et s'attacher aux grandes priorités, quitte à ne superviser le reste que de plus loin. Ce ne sera pas simple. Mais l'un des enjeux pour mieux gouverner la France est là.
Jean-Jacques Goldman : Et vous pensez qu'en cas de majorités non convergentes, comme vous dites, le président de la République pourrait faire autre chose qu'être en campagne électorale permanente et s'occuper de ses sondages ?
Michel Rocard : Tout à fait. Je pense qu'on n'a pas tiré tout le bénéfice du fait que le mandat est long. En sept ans, on a le temps de travailler.
Jean-Jacques Goldman : On vous entend beaucoup parler de l'IGF, qui ne rapporte pas grand chose. Pourquoi les socialistes sont-ils discrets sur cet incroyable privilège de naissance qu'est l'héritage ?
Michel Rocard : Je voudrais vous rappeler que la gauche a quand même beaucoup augmenté les droits de succession...
Jean-Jacques Goldman : Ils restent moins élevés que l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'un gros héritier est moins imposé qu'un gros travailleur.
Michel Rocard : C'est pourquoi nous avons complété le dispositif avec l'impôt sur la fortune, justement. Mais l'incitation à travailler passe par le revenu. A force de matraquer les gens, on risque de se trouver dans la situation de la Suède, dont les artistes, les compositeurs et les cinéastes vont s'installer en Suisse. Il y a donc une limite. Et notre impôt sur la fortune était trop fort. En revanche, on ne doit pas transmettre le droit de commander. Il faut de l'expérience pour diriger une entreprise. Aux Etats-Unis, la transmission des entreprises est frappée à 90 % en ligne droite. Les Français le savent peu.
Jean-Jacques Goldman : Donc vous êtes d'accord pour que l'argent hérité soit plus taxé que l'argent gagné ?
Michel Rocard : Oui, bien entendu. Nous n'en sommes pas si loin d'ailleurs.
Jean-Jacques Goldman : Mitterrand a dit un jour - je cite de mémoire - que pour un gouvernement de gauche l'échec est réactionnaire. Est-ce que vous avez eu le sentiment de participer à un gouvernement réactionnaire ?
Michel Rocard : Ce mot était une boutade, ne la sortons pas de son contexte. Le gouvernement socialiste des années 1981-1986 a fait beaucoup de choses. Du bon et du moins bon. J'ai moi-même qualifié d'erreurs un certain nombre de décisions : j'ai combattu publiquement les nationalisations à 100 % et les 39 heures payées 40. Il y a eu surtout l'augmentation de 27 % du budget de l'Etat sur l'année 1982, ce qui nous a mis dans une situation intenable. Mais je ne laisserai pas oublier 1) la décentralisation; 2) le fait qu'après les nationalisations, on a remis ces entreprises sur pied ; 3) la réduction massive de l'inflation.
Jean-Jacques Goldman : Donc ça aurait pu être pire...
Michel Rocard : Je ne dirai pas seulement ça. Avant 1981, la gauche française exhalait une hostilité générale aux patrons, aux entreprises et au profit. Il a fallu le passage au gouvernement pour qu'on comprenne que les entreprises sont des unités de production avant d'être des champs de bataille et qu'elles sont là pour faire du profit. Maintenant, c'est passé dans le consensus national. Je plaide que le gouvernement socialiste et le président Mitterrand n'y sont pas pour rien, moi non plus.
Jean-Jacques Goldman : Le retour de la droite était donc inéluctable ?...
Michel Rocard : Non, non. Il aurait pu être évité. Mais nous avons payé deux choses : les erreurs du début; et surtout l'excès des promesses.
Jean-Jacques Goldman : Est-ce que ces promesses étaient obligatoires pour être élu ?
Michel Rocard : Ceux qui les ont faites pensaient sans doute que oui, et moi j'ai toujours pensé que non. Je l'ai dit.
Jean-Jacques Goldman : Qu'est-ce que c'est qu'être un homme de gauche en 1988 ?
Michel Rocard : Trois choses. D'abord l'impératif de solidarité: ne jamais accepter de laisser des gens au bord de la route. Ensuite la lutte pour l'égalité des chances : c'est pourquoi la priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'école. Enfin, la reconnaissance du fait que les fonctions de l'Etat ont changé : il est là pour préparer l'avenir et fixer les règles du jeu mais pas plus. Pas pour produire à la place des producteurs. Ni pour tout régir par la loi, les règlements, les décrets, les arrêtés, les circulaires et le petit doigt sur la couture du pantalon.
Jean-Jacques Goldman : Justement, prenons un cas précis: les Restaurants du Coeur, une initiative individuelle de Coluche au départ, pour régler un problème qui concerne tout le monde. Quel devrait être le rôle de l'Etat ?
Michel Rocard : La situation actuelle est caractérisée par un refus croissant - et compréhensible - de l'impôt. Il m'est arrivé de dire que la paupérisation de l'Etat est le problème le plus grave des temps modernes. On ne va plus jamais repeindre les écoles ni les casernes, ni les salles d'accueil dans les commissariats de police. Les gens ne veulent plus payer. A partir de là, lorsqu'un besoin nouveau et grave surgit, comme la grande pauvreté qui est l'une des indignités de notre société, il est impossible de dire que cela relève exclusivement de l'Etat. D'où Coluche. Et c'est probablement parce que l'initiative a été privée que ça s'est bien passé. Cela dit, il a tout de même fallu que l'Etat, en l'espèce le ministère de l'Agriculture, aille négocier à Bruxelles pour l'utilisation des surplus agricoles. Il a fallu des locaux, etc. Dans le cas de Conflans, la commune a puissamment aidé. Donc bravo aux jeunes qui ont fait tout le travail. Mais ne nous imaginons pas que les Restaurants du Coeur auraient pu fonctionner sans que la puissance publique donne un coup de main. Moi, j'aime assez cette manière de faire.
Jean-Jacques Goldman : Autre exemple de charité, autre question : Band Aid et l'Ethiopie. Est-ce que l'argent qu'on a donné a aidé les gens ou est-ce qu'il a conforté le régime de Mengistu, qui est en grande partie responsable d'une situation qui d'ailleurs se perpétue ?
Michel Rocard : Le monde est plein de chefs d'Etat qui sont des assassins, des oppresseurs de leur peuple, des meurtriers. Dans la vie internationale, on entretient des relations avec de curieuses gens. Il reste que si l'on prend ce genre d'éléments en considération, quand on entreprend de soulager les misères, on ne peut plus agir. La question que je me pose, moi, elle ne concerne pas l'effet sur le régime de Mengistu mais le fait de savoir si à ce moment-là l'aide est tombée à l'endroit où on en avait le plus besoin. Bon, effectivement, le drame éthiopien était épouvantable. J'approuve votre aide. C'était bien. Si cela a conforté Mengistu, tant pis car ça a surtout "conforté" ceux qui, sinon, seraient purement et simplement morts !
Jean-Jacques Goldman : Autrement dit, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre dans les caisses de la Croix-Rouge des mitraillettes et des grenades ?
Michel Rocard : Non. On a mieux fait d'exporter des vivres que des armes. De plus, l'histoire des mouvements d'indépendance montre que quand des pouvoirs s'installent par la violence, ils ont du mal ensuite à se pacifier.
Jean-Jacques Goldman : Une question personnelle: est-ce que vous croyez qu'être intègre, avoir des idées et de l'enthousiasme, ce soit suffisant pour devenir président en 1988 ?
Michel Rocard : Il vaudrait mieux que ce soit nécessaire. Ce n'est pas tout à fait suffisant. Il y a aussi la tactique.
Jean-Jacques Goldman : Et l'importance du système médiatique ? Avez-vous confiance dans vos qualités de show man ?
Michel Rocard : Ça aussi ça se travaille. Avec plus ou moins de plaisir, mais je respecte toujours ceux à qui je m'adresse. C'est ma façon d'être courtois.
Il marche seul
Avec sa chanson "Là-bas", Goldman est en tête du "Top 50". Trente six ans, look ados, baskets, il a débarqué il y a douze ans dans le monde du show-business, du fric et des paillettes, en chantant la générosité, le respect, la tolérance. Ringard ? Au début on pensait que ce gentil ménestrel du rock n'était qu'un baba-cool égaré, un Léonard Cohen de banlieue. Et puis, tout doucement Jean-Jacques Goldman est entré dans les moeurs. Avec "Comme toi" ou "Je marche seul", il a pris le pouls de toute une génération, celle de l'après-68, de 10 à 25 ans. Il est même devenu un symbole. Il n'avait pourtant rien demandé et faisait simplement ce qu'il aimait : de bonnes chansons, quelques photos pour magazines de midinettes, un disque pour les Restos du Coeur, un autre pour les boat-people. Sans en faire un fromage. Goldman ou l'antidémagogie. Quand il quitte une scène, il n'a qu'une idée : se faire oublier. "Je doute que mes chansons passent à la postérité" dit-il. Et s'il se trompait ?
Serge Raffy
Retour au sommaire - Retour à l'année 1988