
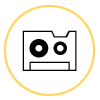
|
Philippe Labro : Rencontre avec... Jean-Jacques Goldman
|
Philippe Labro : Rencontre avec... Jean-Jacques Goldman
Le Point n° 975, 27 mai 1991
Dix ans qu'il domine la scène. Dix ans qu'il est un inconnu célèbre, "un anonyme de luxe", comme il dit. Et qui veut le rester, en attendant son "déclin", sagement.
Le jeune homme, Jean-Jacques Goldman, n'était pas réticent, mais il avait préféré avertir : "Je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire. Je crains que vous ne soyez déçu". J'avais protesté. "Je ne cherche pas la médiatisation", avait-il ajouté. - Ça, c'est clair, avais-je ri. Vous le démontrez depuis assez longtemps !"
Mais j'avais renouvelé la proposition. Depuis dix ans qu'il domine la scène, il n'avait pas souvent ouvert ses portes à qui que ce fût d'autre que ses intimes, et il refusait de figurer dans la rubrique "people", avec photos dans la cuisine, enfants sur le tapis et autres sacrifices à la bête médiatique. La notoriété, au niveau atteint par Goldman, laisse l'observateur sur sa faim, car elle obscurcit tout, a fortiori lorsque le sujet a su organiser un rideau défensif qui le préserve des pièges dans lesquels tombent la plupart de ceux qui s'expriment devant le grand public, et y ont gagné la fortune et la gloire ?.
Acquitter la rançon de la gloire", écrivait le poète. Goldman n'acquittait aucune rançon.
Tel était son cas presque unique. A la veille d'une longue tournée, avec passage de quelques jours à Paris dans un stade-vélodrome à ciel ouvert, à la suite de son nouveau CD, dont les sonorités n'avaient plu autant qu'à un million d'autres acheteurs (disque de platine en quelques mois - record battu), après avoir lu les textes de cet album et constaté leur progrès, l'envie de le revoir m'était venue. Perspicace, il avait fait la suggestion suivante : "Je comprends pourquoi vous avez besoin de voir là où je vis, et comme je vous fais confiance, c'est d'accord, nous irons faire un petit tour à la maison. Mais si vous voulez savoir ce qu'est mon environnement, nous nous verrons d'abord ailleurs ?.
Et Jean-Jacques Goldman, "l'anonyme de luxe", comme il aime à s'identifier, me donna rendez-vous à une adresse qui m'intrigua, au douzième étage d'un immeuble, du côté du parc Montsouris.
Le jeune homme aura 40 ans en octobre, mais si je persiste à l'appeler "jeune homme", c'est qu'il en paraîtrait quinze de moins, n'eût-ce été une raréfaction naissante de ses cheveux noirs sur un beau front large et lisse. Tout, dans son allure, reflète jeunesse, souplesse et agilité : vêtu des mêmes couleurs, entre gris clair et gris foncé, il marche dans la rue pour monter sur sa Honda Transhalp trial et se coiffer d'un casque intégral à visière fumée qui le met encore plus à l'abri des chasseurs de stars - seul, comme dans sa chanson, sans chauffeur ni garde du corps, sans autres lois que celles qu'il s'est, au fil des ans, dictées.
Il a des yeux vifs et sombres en amande, un teint inhabituellement mat, dû à un séjour "travail - vacances" à l'Île Maurice. Vacances : pour sa femme et ses enfants. Travail : un principe, mis au point depuis plusieurs tournées, selon lequel le meilleur moyen de souder une équipe - choristes, musiciens, techniciens, et, en l'occurrence, deux autres solistes, Fredericks et Jones, à qui il offre, en toute fraternité, le même espace et le même rôle qu'à lui, sur la scène comme à l'affiche - avant le marathon dans les villes de France, un principe, donc, qui consiste à vivre ensemble, et à essayer sur des publics éloignés ce qui, peu à peu, va se transformer en un de ces grands concerts à propos desquels les plus importants acteurs de cinéma français lui ont souvent dit, ébahis devant les chants, les lumières des briquets du public : "Comme je vous envie de pouvoir recevoir et donner cela !"
La première fois que j'ai croisé Jean-Jacques Goldman, au début des années 80, à l'amorce d'un succès qui devait faire de lui le chanteur ? auteur - compositeur dont chaque parent français a entendu au moins une fois au moins l'une de ses chansons fredonnée par au moins l'un des enfants de la famille, il n'avait pas encore entièrement franchi la distance qui mène de l'obscurité des années d'apprentissage à la lumière des moments de réussite. Il était néanmoins évident qu'il possédait un magnétisme, qui ne s'arrête pas à la découpe du masque et à l'éclat dans les yeux, mais qui est dû à cet autre facteur indéfinissable et qui sépare les caractères. Il avait l'air un peu loquace, réfléchi, sensible, pudique, animé d'une volonté et d'une lucidité peu communes. Curieusement, il me rappela un autre faciès, celui du troisième des frères Kennedy, Bobby. Nez busque, mâchoire opiniâtre, lèvres sensuelles, l'inférieure un peu protubérante, qui exprime l'humour et une dose de sûreté de soi, et, surtout, un sourire éblouissant qui efface la dissymétrie de la partie gauche du visage et semble ouvrir des trésors d'enfance, un désir intense d'atteindre les autres. On lisait tout cela sur la gueule de Bobby Kennedy, pendant sa campagne électorale, avant qu'il ne se fasse descendre le 8 juin 1968 dans les cuisines d'un hôtel de Los Angeles. Loin de moi l'idée de comparer deux hommes aussi différents, mais si l'on étudie biens les chansons de Goldman, sur dix ans et 25 tubes, on peut les résumer à trois mots clés : générosité, respect, tolérance. Un homme n'a jamais que le visage qu'il mérite, eh bien, pour paraphraser un texte du même Goldman, lui et Bobby, ou, plutôt, Bobby et lui me parurent appartenir à la même famille. Aucun de ces traits n'a disparu, dix ans plus tard. On remarque seulement que la maturité est venue faire son oeuvre, encore que..." Je n'ai pas l'impression d'avoir changé depuis que j'ai 12 ans. J'étais anormal, trop grave, j'avais déjà 40 ans ! J'ai simplement acquis une meilleure évaluation de mes capacités, donc de mes incapacités".
Nous parlons, assis sur des chaises de métal, dans la cuisine étroite d'un très banal appartement, composé de trois pièces, qui fait l'angle de cet immeuble récent, au douzième étage, sans voisins, sans vis-à-vis. "Ici, c'est chez moi. C'est la que je compose et écris. A la maison, c'est l'univers de ma femme et de mes enfants, le mien aussi, certes, mais je passe ici tout le temps de mon élaboration. Il m'est nécessaire d'être seul, de pouvoir faire le bruit que je veux, m'endormir ou me réveiller à n'importe quelle heure. C'est mon atelier, en somme. On appelle ça un "home studio" dans le jargon des musiciens de rock, et si vous ne voyez rien à côté de mes outils de travail, c'est parce que je suis aveugle à ces choses-là : décor, couleurs, moquette ou pas, etc".
Les "outils" sont répartis dans la pièce d'angle, dont les fenêtres donnent sur un paysage urbain, des tours, de la pierre, du gris, du blanc. Il s'agit d'un ordinateur Atari dont la programmation autorise à concocter des arrangements couvrant plus de vingt instruments de musique. Il est relié à un Digital Piano, un Roland, appareil synthétique, dit "synthé". Un magnétophone Akai à 12 pistes et un petit mixer Boss BX 16, qui permet de mélanger les sons, complètent, avec des baffles et plusieurs boîtes à rythme, ce dispositif grâce auquel Jean-Jacques Goldman peut préparer ce qui, dans un studio professionnel, deviendra un album.
"C'est un changement fondamental. Il a fallu que je m'y mette. On est à cent lieues de Brassens écrivant ses notes et ses rimes, mais, en même temps, le problème de base reste identique. Il faut d'abord inventer.
- Pécisément, dis-je, parlons-en. En gros, de "Là-bas" à vos "Actes manqués", ce qui m'intéresse, c'est votre faculté de trouver, en paroles comme en musique, ce que j'appellerai "l'immédiatement universellement identifiable". Ce qui fait qu'à peine entendue une chanson de vous se retient, envahit l'inconscient collectif. C'est quoi, ce don?
- Vous mettez un musicien sans talent dans une pièce, et vous le laissez jouer toute la journée. A un moment, il va faire deux choses de qualité dans le tas, mais il ne saura pas les reconnaître. En ce qui me concerne, je ne sais pas d'ou cela me vient, mais je peux reconnaître la qualité. Un son, un changement d'accord, un petit rien vont me plaire, et si ca me plaît, ça va plaire aussi aux autres. Il y a une étincelle et je la décèle. C'est là où je suis plus balèze que l'autre musicien. Avec le texte, c'est pareil : trois mots, détachés du fatras des autres mots, vont concrétiser un moment d'émotion musicale. "Quand la musique est bonne", quoi de plus simple ? Et pourtant, cela a fait une chanson à succès, et pour les jeunes qui l'ont chantée, l'idée que je voulais transmettre passait par ces petits mots.
- Vous avez donc tamisé toute la journée, toute la nuit, et découvert une ou deux pépites au milieu des cailloux.
- Non, "pépite" est trop prétentieux, disons un ou deux cailloux blancs au milieu de milliers de cailloux gris. Il a suffi que j'entende une fois, à 13 ans, "Hey Joe", de Jimi Hendrix, pour savoir que c'était une sensation, avant même que cela le devienne. Mais chez nous, chez les Goldman, même si je sentais que j'étais musicien, il était inconcevable qu'on puisse vivre de la musique ! Et il aura fallu que je vende un million de disques en 1981, pour laisser tomber le magasin de sports que j'avais repris à mon père, avec mon frère. C'est dire dans quelle sous-estimation je tenais le métier de la musique !
- Et vous-même ? Vous vous sous-estimiez ?
- J'étais, en 1981, quand tout a explosé pour moi en une seule chanson, dans la situation du type qui joue vaguement au tennis le dimanche, s'inscrit à Roland-Garros et se met à gagner. Il est étonné de passer tous les tours : il a battu Edberg, Lendl, il a battu Becker, c'est pas normal !"
L'itinéraire de ses succès, déjà connu, importe moins qu'essayer d'analyser ses influences, ses héritages. Il est franc, mais pas volubile. On le sent en permanence habité par le souci de la relativité, soutenu par un système de mesures qui semble rarement lui faire défaut. Il ne se dérobe pas devant les questions, comme si le fait de n'avoir accepté dans son repaire secret signifiait qu'il était prêt à parler de tout. Ainsi évoquera-t-il ses parents qui, "comme tous les immigrés n'ont eu pour seul but dans leur vie que celui de faire de nous des enfants comme les autres". Rire : "Ils n'y sont pas entièrement arrivés !" Nous, c'était lui, sa soeur et ses deux frères. Les parents : Ruth, née à Munich, et Alter Mojze, né a Lublin, en Pologne. Le père, mort il y a peu de temps, dont il dit qu'il demeure l'homme qui l'a le plus impressionné. Un autodidacte "d'une intelligence et d'une clairvoyance politique ahurissantes". Il quittera le PC dès 1945, dès l'histoire du "complot des blouses blanches".
"Alors qu'il avait été FTP pendant l'Occupation. Quitter le PC, à cette époque, dans ces conditions, c'était une rupture terrible. On devient un renégat. Mais il a dit ? il y a manipulation, il y a mensonge, cette idée n'est pas la mienne ?. Il lisait tout; on lisait beaucoup dans la famille ; je conserve la vision de tous les enfants, dans la même pièce, le soir, sans radio, sans télé, chacun plongé dans un livre, et l'un relevant la tête pour rire à une formule et l'échangeant avec les autres. On lisait aussi bien Zola que Hemingway, Martin du Gard que San Antonio ou Montaigne".
La figure du père domine le souvenir : petit (1,63 m) mais une force d'athlète, habité par une énergie de vie peu coutumière, parlant peu de son passé ("C'est seulement six mois avant sa mort que j'ai appris, par un ministre, le rôle primordial qu'il avait joué dans la résistance, dans la région de Lyon"), mais diffusant un climat de culture politique, imposant une des données essentielles dans la famille: l'idéalisme, l'altruisme.
"Il ne supportait pas les situations acquises.
- Et vous, aujourd'hui ? Quand vous écrivez : "Si j'étais né en 17, et allemand, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens ?"
- Je n'ai pas de doutes sur mes choix, même si je m'attends au tournant. Mais je suis souvent énervé par la morgue vertueuse des gens qui défilent, quand je sais qu'il existe des fascistes potentiels au sein des troupes de la vertu. C'est facile, ça se voit dès la première crise, dès qu'un manque apparaît. il suffit d'un manque d'essence. Il y a une façon, dans notre pays, d'accuser les petits Blancs, les soldats irakiens, les autres, ces "improbables consciences, larmes au milieu d'un torrent". Je crois qu'il est commode d'être vertueux, en France, et qu'il faut tenter de juger en se débarrassant de cette prétention".
On comprend, dans ces propos, ce qui aura été l'attitude de Jean-Jacques Goldman sur les dix ans écoulés, au cours des actions de solidarité dans lesquelles il s'est engagé, avec un discrétion systématique, érigée en éthique. C'est lui que Coluche viendra chercher pour écrire la fameuse chanson des "Restos du Coeur", et il s'y donnera à plein. il chantera, aussi, pour SOS Racisme, sans hésitation, puis il s'en détachera, fermement, sans tapage.
"J'ai toujours pensé que c'était une belle et grande idée, mais j'ai aussi dit qu'à l'instant où un homme de droite ne pouvait pas se reconnaître dans ce mouvement, c'était la fin de cette idée. Et je l'ai dit à Harlem Désir".
Le ton du jeune homme est posé, comme attaché à ne pas blesser inutilement, convaincu que ce qu'il dit ne présente pas plus d'intérêt sous prétexte qu'il vend des millions de disques, car les "attributs de la star" l'indiffèrent.
"Cela ne veut pas dire que je crache sur l'argent. Je profite de ma situation sur le plan matériel. J'ai des voitures, quelque part dans des garages à Paris, et je peux, en effet, affréter un avion pour aller voir tel ou tel spectacle. Je suis maître de mon temps libre. Mais il faut savoir détecter son luxe à soi. Et ce luxe-là est à la portée de tout le monde : l'odeur du café le matin ; un film de Woody Allen ; la douche après le tennis ; regarder les gens, au bord de la mer ; un poulet-patates chez mes copains du Sud-Ouest ; aller au concert en spectateur incognito, assis parmi la foule ; déceler l'étincelle".
Il aura su trouver, en plusieurs circonstances, cette "étincelle" qui fait de certaines de ses chansons de véritables petites vignettes sur notre époque. Le regard est aigu, comme dans "La vie par procuration", ou juste sur les femmes d'aujourd'hui, comme dans la célèbre "Bébé toute seule".
"On peut, commente-t-il, considérer la chanson comme une photo assez précise de l'air du temps. Ça a toujours été le cas, et que le mécano des années 20-30 se soit retrouvé dans "Ma pomme" de Maurice Chevalier et celui des années 80 dans les textes de Renaud démontre une constante évolution des moeurs. Il n'est pas insignifiant qu'un texte intitulé "A nos actes manqués" soit devenu le substitut de "Da Dou Ron Ron".
- Cela veut dire que le public a changé ?
- Bien évidemment ! Les jeunes qui composent la majorité des salles ne sont plus du tout les mêmes. Dans les années 60, on chantait quelque chose du genre "Tu m'aimais, tu es partie, depuis je souffre". Aujourd'hui, ça ferait rire les enfants de 12 ans. mais sont-ils des enfants au sens où on l'entendait autrefois ? A 12, 13 ans, ils me stupéfient par leur humour, leur connaissance du monde, leur distanciation. Ils ont fait du "Père Noël est une ordure" leur film-culte, parce que ce film démasque toutes les pudibonderies, les fausses attitudes. Et j'observe aussi, parmi celles et ceux qui m'écoutent, une compréhension, voire une compassion à mon égard qui vient contrebalancer leur humour dévastateur.
- Vont-ils, vont-elles autant vous aimer à mesure que vous vieillissez ? Et sentez-vous, comment dire, un affaiblissement de votre 'électorat'?" Il a un grand sourire, comme devant une évidence.
- "Mais oui, bien sûr, oui !
- Et cela ne vous attriste pas?" Le sourire devient rire. "Ce n'est pas une tragédie! C'est un déclin absolument inexorable : vous pouvez conserver un public de base qui va vieillir avec vous, mais vous perdrez celui qui se renouvelle, les 13-17 ans qui arrivent. Il faut être sérieux : vous ne vous imaginez tout de même pas que, sous prétexte que j'avais plus de succès que Léo Ferré entre 1980 et 1990, j'aie pu croire que j'avais plus de talent que lui ?... J'avais ma jeunesse, et la jeunesse s'identifiera désormais, peut-être, moins facilement à moi. Je vais rejoindre les 99 % des chanteurs dont le succès est basé sur leur travail, et je quitterai le 1% des "élus". Ça se passe anormalement doucement, mais ça se passe. Une espèce de grâce, d'aura, va se perdre.
- Ça vous manquera ?
- Je sais cela depuis toujours. Ça ne peut pas me manquer. Au début, quand j'ai vu ce cirque autour de moi, je me suis posé la question: Que fais-je ? J'y vais, ou j'arrête? Nous n'en avions jamais parlé, avec ma femme, puisque nous ne l'avions jamais envisagé. Je me suis dit : Comment ? Je refuse un statut auquel tous mes amis musiciens rêvent d'accéder ? De quel droit ? Et puis, aussi : Vais-je me retrouver dans la position, plus tard, du type qui sort les coupures de presse et dit : "Vous voyez, si j'avais voulu, j'aurais pu..." ? Alors, j'y suis allé. Mais ce statut de chanteur - vedette allait à l'encontre de mon éducation. Le respect que j'avais pour mon entourage familial m'a même interdit de les inviter la première fois que j'ai "fait" l'Olympia !"
Un auteur-compositeur-interprète qui s'offre le luxe de vous annoncer son déclin, alors qu'il est au sommet de tous les hit-parades et que sa tournée affiche déjà complet partout ; même s'il ajoute que cela "se passe anormalement doucement", ce qui sous-entend : ne me périmez pas plus vite que je le fais moi-même; cela dénote, on en conviendra, une jolie lucidité. Devant tant de franchise, il me parut que je pouvais hasarder une question à propos de son frère.
Un matin de 1979, Pierre Goldman, demi-frère aîné de Jean-Jacques, a été abattu à coups de pistolet sur le pas de sa porte ; on n'a jamais découvert - ou voulu découvrir - par qui et pourquoi. Ce dont le lecteur se souvient peut-être encore, c'est que Pierre Goldman devint, pour un temps, l'une des "causes célèbres" de la gauche intellectuelle, et qu'il fut acquitté d'une accusation de meurtre après qu'on eût évoqué, au cours d'un procès spectaculaire, son parcours de révolutionnaire, son talent d'écrivain, ses dérives dans la délinquance. A aucun instant de sa carrière Jean-Jacques Goldman ne s'est complu à se référer à ce disparu dont, aujourd'hui, plus personne ne parle. Et lorsque je prononçai le prénom, je le sentis sinon sur ses gardes, du moins habité par la pudeur, une sorte de devoir de réserve qui relevait, selon moi, à la fois de la dignité, de l'orgueil, de ce que les Anglais appellent ? a sense of decency ? - une notion de décence par rapport au reste de la famille, à ce qui ne peut pas, si l'on a quelques principes, être étalé sur la place publique. Au fond, c'était une approche similaire à la préservation de sa vie privée, à la protection dont il a réussi à entourer sa femme, une psychologue, et ses trois enfants. Aussi bien ne passâmes-nous pas plus de quelques instants sur le sujet, mais je lui sus gré de ne pas fermer la porte.
Il avait insensiblement penché la tête, comme il lui arrivait de le faire lorsqu'il cherchait la façon précise de répondre. Je l'avais trouvé plus grave qu'auparavant et je croyais lire, dans ses yeux, le déroulement de scènes qu'il garderait pour lui ; de mots qu'il avait assimilés, perdus puis retrouvés ; d'émotions dont il tentait de contrôler le surgissement.
"L'histoire de Pierre Goldman est indissociable de celle de mon père. C'est un prolongement. Il y a eu comme une mythologie autour du père, de son passé de combattant clandestin, et je ne saurais dire s'il n'a pas fait une identification, sauf que ce n'était plus la même époque, ni la bonne - puisqu'il n'y avait pas la guerre, la vraie... Il faut voir, aussi, que ce frère, enfant reconnu par mon père, a très tôt demandé à être émancipé, ce qui indiquait une volonté de rupture... Nous avons appris le côté "mauvais garçon", après ses aventures au Venezuela, par les journaux, mais nous savions qu'il n'était pas intéressé par l'argent. On n'a jamais eu l'impression d'être loin de lui. J'ai toujours considéré que ses valeurs restaient les mêmes que les nôtres : amitié, idéalisme, fraternité ; une tendresse pour les faibles, la lutte contre les forts.
- En avez-vous su plus, depuis sa mort, sur qui a pu l'abattre, et pourquoi ?
- On en sait plus que les autres, sur tout ce qui concernait Pierre, puisque nous étions les plus proches de lui ! Cela ne veut pas dire que l'on sait. Un phénomène comme celui de la bande à Baader (où commence le gangstérisme pur et simple ? Où s'arrête la militance révolutionnaire ?) n'a pu exister pendant l'Occupation et la Résistance, tandis que vous ne pouviez, dans les années 70, baigner dans certains mouvements politiques sans entrer, un jour ou l'autre, en contact avec le droit commun. Voilà ce que je crois pouvoir dire".
Comme il n'apparaissait pas vouloir aller plus loin, je lui exposai une théorie sur l'attitude de certains journaux à son égard. Par trois fois, au moins, dans des publications dont le contenu aurait pu, a priori, laisser croire qu'ils éprouveraient une proximité entre Jean-Jacques Goldman et eux-mêmes, le chanteur avait été littéralement mis au pilori. Adjectifs à la limite de l'insulte, ton vindicatif, aigre, comme une sorte de règlement de comptes, une volonté de nuire. J'avais relu tout cela à tête reposée, avant notre rencontre: "Bêtasse, godiche, degré zéro, vacuité, savonnette manufacturée". Ou encore : "Voix de castrat endimanché". Ou enfin : "Produit parfaitement ciblé. Nul". Une telle volée de coups appelait explication, et je m'étais demandé s'il n'y avait pas, chez les auteurs de ces épithètes, un reproche informulé, comme s'ils en avaient voulu à Jean-Jacques qu'il n'ait pas prolongé Pierre - qu'il ne l'ait pas déployé comme un drapeau. Et s'ils ne l'accablaient pas de je ne sais quelle "trahison".
"C'est votre théorie, rétorqua Goldman, une fois que je l'eus énoncée. Mais, enfin, peut-être... Pour beaucoup de gens, le fait de chanter "Quand la musique est bonne", et que cela émeuve un public d'adolescents, qui ne savaient pas que Pierre Goldman avait existé, avait quelque chose de... louche. Ça a peut-être énervé ces juges vertueux que je ne fasse aucune référence apparente - même dans mon goût musical. Car Pierre était fou de musique sud-américaine, alors que j'ai été exclusivement nourri de rock.
- Vous vous en écartiez délibérément ?
- Non, je ne me suis pas posé la question sur le plan musical. Mais je n'ai jamais nié mon lien avec lui, de même que lorsque, à mes débuts, la maison de disques m'a suggéré de changer de nom, il ne m'a pas fallu trois secondes pour dire non".
Puis, avec une certaine lassitude :
"Il est utile de savoir, aussi, que l'un des auteurs de ces articles écrit des chansons. Donc, je le comprends. Et je l'absous. (Rire de dérision.) par mépris.
- Non, lui dis-je. L'absolution ne peut aller de pair avec le mépris.
- C'est vrai, dit-il. Alors, je l'oublie. On va déjeuner ?"
Il existe, dans certains milieux à Paris, une haine du succès. Ceci est particulièrement vrai dans ce monde de la chanson qu'on a coutume d'appeler "showbiz". je me souviens de Serge Gainsbourg quand il prononçait ce mot, "showbiz", devant son énième verre de Peppermint Get pur, sur des cubes de glace, un rien geignard, la voix dégoûtée, tordant le nez et les lèvres en tirant sur son clope et disant : "A la base de la haine, il y a toujours un type qui aurait voulu être à la place du mec qui chante".
Et si Jean-Jacques Goldman a suffisamment accumulé de succès ; assez vécu de moments exaltants sur scène entouré par ceux avec qui il "adore" chanter ; s'il est parvenu à un niveau de sérénité qui lui a fait admettre : "Je pourrais m'arrêter demain et dire, comme Romain Gary: 'Je me suis bien amusé, merci'", on devine qu'il a été blessé par ces attaques. Il en rit, mais il en a reçu le coup, et la confirmation que, décidément, il n'appartient pas à ce monde du spectacle. Il appartient à son passé.
"Mes parents sont arrivés en France sans racines, porteurs de cette inquiétude d'une race aux aguets. Des gens attentifs, comme entraînés à sentir, et ressentir les autres. C'était cela, avec mon père : Est-ce qu'on m'aime ou pas ? Est-ce qu'il va falloir encore se battre ?"
Nous avons déjeuné chez lui, dans la banlieue sud. Il tenait à cette définition de son territoire. Il était né en banlieue sud, il y avait connu sa femme, ils s'étaient mariés là, ils y avaient fait leurs trois enfants, ils n'en avaient jamais bougé. La banlieue sud, d'où étaient issus Coluche et sa génération, et dont l'étendue lui permettait de conserver une vie familiale normale.
"Je revendique ma normalité", me disait-il en me faisant goûter un poisson froid mayonnaise, pour achever par un dessert "recette enfants Goldman" : banane écrasée dans du fromage blanc rehaussé du contenu d'une bonne moitié d'un tube de lait concentré sucré Nestlé. De quoi vous caler pour toute la journée, de quoi nourrir cette charpente mince et musclée, alimenter ce moteur étrange qui brûlait en lui, personnage aigu, à l'affût, vraisemblablement surchargé d'un excès d'énergie, enclin à la solitude, prenant sans cesse des notes sur des petits carnets, personnage, "non homologué", ayant un jour clamé qu'il rejetait "l'apologie classique du désespoir, des zonards, drogués, sexe, et toutes ces fausses révoltes qui nous arrangent".
Dans ce pavillon confortable, dépourvu d'extravagance, aux couleurs gaies et vives choisies par sa femme, dôté d'un jardin (simple pelouse, quelques arbres, avec, dans le fond, la cabane construite pour les enfants), il était facile d'imaginer avec quelle délectation Jean-Jacques Goldman avait un jour rédigé sa propre fiche biographique : "Sujet difficile à saisir. Banalité préoccupante".
Je soupçonnais ce cérébral d'avoir choisi de demeurer au centre de ce décor, au coeur de la banlieue sud, de l'autre côté du périph', non seulement parce que cela faisait partie de ses "racines" (il y trouvait sans doute, sans l'analyser, quelque réassurance), mais surtout parce que cette atmosphère, ce rythme de vie lui conserveraient sa clarté de jugement, le garderaient de toute illusion. ne jamais être dupe - phrase clé du comportement de Jean-Jacques Goldman face à sa popularité.
"Avec Catherine, on le vit avec distance. On a le même regard sur le phénomène : étonnement, intérêt, mais détachement et amusement, en sachant que, fondamentalement, ce n'est pas important.
- Qu'est-ce qui est important, pour vous deux, alors ?
- Ce qui arrive à tout le monde. Les vrais problèmes. Les relations avec autrui. Comment nous allons vieillir ensemble".
Ensuite, la conversation a porté sur le rugby ("Le plus beau des sports. Il est, à lui seul, un village") ; Saddam Hussein ("Un pays n'est pas victime de son tyran, il le secrète") ; les dix ans de la gauche au pouvoir ("Ce sont les Français qui ont décidé de la fin du clivage droite - gauche, la société française a eu et aura dix longueurs d'avance sur la classe politique") et enfin, sur Rocard ("Les hommes politiques qui fraient avec le spectacle essayent de nous séduire. Ils nous prennent pour des imbéciles, ils sont pathétiques. Rocard est le seul qui n'ait pas essayé de me séduire, ce que j'ai trouvé séduisant"). Nous nous sommes quittés en fin de tournée. Le matin même, j'avais eu l'occasion de dire à deux adolescentes, respectivement âgées de 11 et 12 ans, que j'allais à la rencontre de Jean-Jacques Goldman. Elles avaient eu deux réactions courtes et authentiques, comme il est de mise à leur âge, et en leur temps. La première avait seulement dit : "Il ne frime pas". La seconde : "Il chante bien". Lorsque j'eus répété ces petites phrases au jeune homme, il me donna l'impression qu'elles lui convenaient, qu'il n'en avait jamais souhaité plus. Je me demande s'il ne se déroula pas entre son orgueil et son humilité, son humour et sa faculté de relativiser, un bref combat intime pour ne pas céder à la tentation de déclarer: "Vous vous seriez contenté de ces mots, tout était dit, et vous n'auriez pas été déçu, comme je vous avais prévenu que vous le seriez". Mais il ne rajouta rien. D'ailleurs, il était loin de m'avoir déçu, puisqu'il venait de me donner, pour reprendre une belle expression, un exemple sans failles de "destruction de comédie" - une des trois formes de l'intelligence, selon la célèbre formule d'André Malraux.
Retour au sommaire - Retour à l'année 1991