
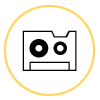
|
Jean Mareska : "Goldman a chanté les Platters et le Disco"
|
Jean Mareska : "Goldman a chanté les Platters et le Disco"
Platine, août 1994
J.-P. P.
Alors que Warner ressort en CD les trois albums Taï Phong, Platine a voulu en savoir plus sur les années Taï Phong et celles de la sortie des 3 premiers singles en solo de JJG. Nous avons retrouvé le directeur artistique de Jean-Jacques de 1975 a 1980, Jean Mareska. Aujourd'hui responsable des collections chez... Sony, la maison de disques de Goldman, Mareska nous livre en exclusivité ses confidences sur le Goldman des années 70.
Platine : Comment arrive-t-on sur la route d'un Goldman ?
Jean Mareska : C'est une longue histoire. qui commence dans l'Aube où je suis né en 1945. Je suis arrivé dans la banlieue est de Paris, la même que Voulzy, au Perreux plus exactement, alors que j'avais trois mois. Mes premiers souvenirs musicaux sont ceux que la TSF diffusait : Patrice et Mario, Dano Moreno... mais aussi les chansons que ma mère chantait et qui étaient encore plus anciennes: Lucienne Delyle, par exemple. Bien sûr, dans ce début des années 50. Il n'y avait pas de télé, ni de tourne-disques à la maison, et, dans la cour de l'école, on ne parlait pas de chanson. Ce n'est qu'à la fin des années 50, qu'un copain d'école m'a parlé pour la première fois de Rock'n'Roll. Je devais être en cinquième ou en quatrième. Son père voyageait à l'étranger, et grâce à cela, il avait des disques d'Elvis Presley, de Bill Halev. Il était un peu le diffuseur de cette musique, qui n'intéressait d'ailleurs pas tous les adolescents de ma classe. A part ça, je ne crois pas que j'ai vu Elvis au cinéma avant 1961, j'avais alors seize ans. J'appréciais aussi beaucoup Ray Charles, qu'un copain qui aimait le jazz m'avait fait découvrir, mais nous ne l'assimilions pas au Rock'n'Roll. Je me rappelle avoir acheté son 25 cm jaune, Atlantic, celui où il y avait "What'd I Say".
Platine : Le Rock'n'Roll est un raz de marée pour vous ?
Jean Mareska : Oui. D'autant plus que, comme nos parents détestaient ça, cela nous encourageait à nous passionner pour cette musique. En plus, j'avais un père musicien qui jouait en amateur dans un orchestre musette. Lorsque je lui ai fait écouter Bill Haley, il s'est demandé si j'étais pas tombé sur la tête. Tous les gosses ont dû avoir les mêmes réactions de la part de leurs parents, sauf, peut-être, ceux qui avaient des parents amateurs de Jazz.
Platine : Vous parlez beaucoup du Rock'n'Roll américain. Le Rock'n'Roll français : Richard Anthony, Claude Piron, Danvel Gérard, Johnny Hallyday, les Chats et les Chaussettes ne vous ont pas touché ?
Jean Mareska : J'ai entendu parler du Rock américain avant d'entendre du Rock français. Dès que j'ai connu les rockeurs français, évidemment, je me suis précipité sur leurs disques. Je ne me souviens pas que nous ayons eu beaucoup le choix, et donc je les aimais tous. Ils étaient *ma* musique. Je crois cependant que j'étais plus Chaussettes Noires que Johnny Hallyday. Je dois avouer que je les ai rapidement lâchés pour m'orienter vers le rock anglais. Mon premier concert fut celui de Blackie et des Jazz Messenger à l'Olympia. Ils faisaient du Jazz, mais c'est vrai que cette musique n'était pas ce que je préférais. Dès 1963, j'écoutais les Beatles, que j'avais découvert cette année-là lors de mon premier voyage en Angleterre où j'étais parti avec un pote qui n'était pas très fondu de Rock'n'Roll, mais qui était curieux. Je me souviens qu'à Londres, je fréquentais le "2 I's" (prononcer "Two eyes") où tous les groupes à la mode se produisaient. Un club mythique qui était un bouge immonde dans une cave, où la scène était a peine à 15 centimètres au-dessus du sol. L'Angleterre me fascinait car je lisais des revues de musique : Rave, Fabulous, qui étaient pleine de photos en couleurs des groupes que j'aimais et qui avaient des dégaines pas possibles et déjà les cheveux longs. En revanche, contrairement à mon frère qui était et, est toujours, guitariste, je n'étais pas du tout musicien : je jouais trois accords à la guitare, j'étais spectateur, auditeur, acheteur de disques, et fier de l'être. J'ai vu ensuite les Beatles à l'Olympia en janvier 1964, quand ils sont passés avec Trini Lopez et Sylvie Vartan. Le "Package" était pour le moins étonnant. Dès cette époque. Je n'ai plus écouté de musique française. Même les Lionceaux qui reprenaient les Beatles en français, on trouvait ça un peu léger, pas très sérieux.
Platine : Les Beatles de 63 étaient très sucrés avec leurs "Love me do" et "Please please me". Comment peut-on passer du Elvis rock des années 50 aux Beatles pop gentil ?
Jean Mareska : On ne se posait pas ce genre de question. En plus, Elvis, on ne l'avait jamais vu qu'en photo et un peu au cinéma. Les Beatles, on les voyait en vrai, à Paris sur scène avec leurs guitares. En plus, ils s'agitaient bien, ils avaient de bonnes mélodies, un son parfait et ils chantaient bien. Je crois même que j'ai dû apprendre l'anglais plus en les écoutant qu'ailleurs. Peu à peu, l'envie de monter un groupe est venue. Plus pour être les stars du quartier et séduire les filles que pour faire carrière. Nous ne savions pas ce qu'étaient de bons arrangements ou une bonne mise en place, nous ne remarquions même pas les "pains", les fausses notes. Et c'était très bien comme ça. Une musique nous touchait ou nous touchait pas, c'était aussi simple que ça. Depuis plus de vingt ans maintenant que je travaille dans le disque, j'écoute plus la forme que le fond, et je le regrette. Je suis très heureux, par ailleurs, de ne rien connaître en peinture, car, quand je regarde un tableau. je suis vierge : ou il me plaît ou il ne me plaît pas. Notre groupe, les Shotgun, est né au milieu des années 60. Comme le groupe anglais, les Swinging Blue jeans, nous jouions beaucoup de reprises de classiques du Rock'n'Roll : "Good Golly Miss Molly", "Tutti Frutty", "Lucille", notre grand "tube" étant "Shake, Rattle and Roll". Il n'y a aucune trace de cette période, car nous n'avons jamais rien enregistré. Nous écumions les arrières salles de bistrot, les salles de fêtes du coin, la fête du petit vin blanc à Nogent sur Marne. Une année, lors ce cette fête, les amplis Vox ont organisé un tremplin. Nous nous sommes inscrits et c'est la première fois que nous sommes montés sur une vraie scène, nous sommes arrivés deuxième groupe ex aequo, premier groupe vocal, toujours en faisant des reprises. Ensuite, nous sommes allés au Golf Drouot voir Henri Leproux, Jean-Claude Berthon de Disco Revue/ Les Rockeurs, qui organisaient des Tremplins au Golf Drouot. On a commencé par les tremplins de Berthon le samedi après-midi. Là, il y avait deux groupes à la fois, un connu et un inconnu. Nous nous sommes produits avec des gens comme Ronnie Bird, Vigon et les Lemons dont le clavier était Michel Jonasz. Puis on a commencé à enchaîner tremplin sur tremplin. Il y avait, à chaque fois, six à sept groupes. Nous n'avons jamais gagné. Je crois que nous ne devions pas être assez bons (rires), Nous avons, cependant, durant trois ans, vécu au rythme de la scène parisienne, trimbalant nos amplis, notre batterie, nos guitares, dans le métro, et tremblant, le soir au retour, de rater le dernier bus pour Le Perreux, que nous devions prendre au terminus du métro Château de Vincennes. L'absence de permis et de voiture, nous privait des avantages de notre statut de groupe. Surtout auprès des filles, que nous laissions à regret au Golf, dès notre prestation terminée. J'ai côtoyé cependant tous les membres des groupes français qui allaient exploser dans les années 70 : Triangle, Martin Circus, Variations. J'étais très pote avec Papillon, entre autres. Je me souviens un jour, il est venu me voir avec Prévotat, car il cherchait un guitariste pour monter Triangle, et je leur ai trouvé leur premier guitariste.
Platine : De 1965 à 1968, donc. Vous vous souvenez de Mai 68 ?
Jean Mareska : Comme je n'étais pas étudiant, cela m'a moins touché. Je ne me sentais pas concerné. On pense aujourd'hui que Mai 68 fut la Révolution de la jeunesse, pour moi, ce fût avant tout celle des étudiants. Ca ne nous empêchait pas de trouver nos galas et d'aller jouer, aux quatre coins de la banlieue, en demandant aux copains qui avaient des bagnoles de nous accompagner. Heureusement, nous n'avions pas de sono à transporter, car tous les endroits qui accueillaient des groupes installaient leur propre sono, pas toujours de qualité. Le seul souvenir professionnel que j'ai, c'est le jour où Salut les Copains avait réuni tous les groupes de rock français sur la place de l'opéra pour faire une photo ; et j'y suis. Le reste du temps, c'était du grand amateurisme, sans aucune autre velléité. Aucun membre du groupe n'avait envie de devenir vraiment pro. Peut-être savions nous au fond de nous mêmes que nous n'étions pas à la hauteur. Dans le groupe, qui était devenu le Kamasutra Blues Band, nous étions cinq. Il y avait mon frère et un batteur qui s'appelait Jean-Louis Mongin. Il continue toujours aujourd'hui à se produire pour chanter du rock et du country, en s'accompagnant à la guitare. Pour nous tous, c'était un loisir d'adolescent. Pour ma part, je ne savais pas trop si j'allais partir à l'armée, alors, en attendant...
Platine : Comment passe-t-on du statut de chanteur de groupe amateur à professionnel du disque ?
Jean Mareska : J'ai rencontré des gens de chez Polydor qui m'ont proposé de faire un disque en solo. Comme mes potes s'en fichaient éperdument, j'ai enregistré un quatre titres. Ils s'en fichaient moins après, car ce disque, même s'il n'a pas marché, nous a rapporté pas mal de galas. Je me suis vite aperçu que je n'étais pas fait pour chanter, et j'ai laissé tomber en me disant qu'à défaut de faire l'artiste, je pourrais peut-être travailler avec des artistes. J'ai définitivement arrêté de chanter, la période d'inconscience où nous reprenions sans complexe Hendrix ou les Cream était finie. En 1969, par le bouche à oreille, j'ai appris qu'une place d'attaché de presse radio se libérait chez Barclay. Je me suis présenté et j'ai été engagé au département international, ce qui fait que j'ai été amené à faire la promo des catalogues que Barclay représentait en France : Atlantic, Atco, Monument, Buddha, Kamasutra. Sous la direction de Bernard De Bosson et avec Benoît Gautier, je m'occupais d'Aretha Franklin, Milson Pickett, Sam and Dave, Otis Redding, toute la fine fleur du Rythm and Blues de l'époque. Comme il n'y avait que quatre radios à l'époque, RTL, Europe 1, France Inter et RMC, je prenais ma petite boîte de disques et je faisais le tour des programmateurs : il y en avait sept à huit par radio, peut-être un peu plus à France Inter. Je me souviens de Babar, Arlette Tabar, qui me recevait à Europe et qui était déjà extraordinaire. A France Inter, il avait André Marchand, qui est décédé depuis. A RTL, il y avait déjà Monique Le Marcis, qui était très pro. Les gens de RMC, on ne les voyait pas car ils étaient à Monte Carlo. On déposait les disques rue Magellan et ils étaient acheminés à la station monégasque par navette intérieure. Je pensais vraiment à l'époque que j'étais un bon attaché de presse. car je menais "Le nouveau" Aretha Franklin, et deux jours après, je l'entendais sur les ondes. Je ne me rendais pas compte que ces artistes se vendaient tous seuls tellement ils étaient puissants et abordables. Nous avions vraiment la fine fleur de la musique étrangère et c'était plus facile de faire passer Dock Of The Bay par Otis Redding, que les Pretty Things. Je me souviens d'une anecdote à Europe 1 en 1969. Ce jour-là, j'avais fini mon tour par Babar. J'apportais "Oh Happy Day", par les Edwin Hawkins Singers. Babar a écouté le disque, s'est levée, m'a pris par la main, m'a emmené au studio. Michel Brilliet était aux manettes et Hubert au micro. Babar a pris le conducteur de l'émission, elle a rayé un titre, a mis à la place "Oh Happy Day". Elle est allée ensuite trouver Hubert, pendant la diffusion d'une chanson, et lui a dit ce qu'elle venait de faire en rajoutant que cette nouveauté était géniale. Dans les dix minutes qui ont suivi, le disque passait à l'antenne. C'était exceptionnel, mais cela était possible. Aujourd'hui, à l'époque des réunions, des panels, des comités, du média-control, c'est carrément utopique de penser qu'un coup de foudre peut bouleverser une programmation.
Platine : Vous ne souffriez pas de travailler sur un catalogue fantôme. Vos artistes étaient soit américains, soit anglais, et vous n'aviez d'eux que des disques et des photos ?
Jean Mareska : Ce n'est pas tout à fait exact, car, ils venaient souvent en France pour se montrer en télé, ou faire des scènes. Je me souviens avoir promené un artiste Monument, Tony Joe White, dans tout Paris. Il était descendu à l'hôtel du Pas de Calais, rue des St Pères. Il était très sympa, curieux de tout, il a voulu prendre le métro. Nous avons fait des photos avec Jean-Pierre Leloir. White était venu donner une série de concerts harmonica-guitare-voix à l'Alhambic du Roi à Enghien. Pendant une semaine, on lui avait même trouvé un batteur pour l'accompagner. Il chantait "Polk Salad Annie", et "Soul Francisco". Je sais que Joe Dassin lui vouait un culte, mais je ne l'ai pas vu là-bas. En plus de mon boulot d'attaché de presse radio, j'ai commencé à écrire des papiers dans Best en 1969 grâce à Gérard Bernard. Le premier que j'ai fait fut consacré à Wilson Pickett, qui était venu à Paris pour faire l'Olympia. J'avais dû le suivre partout, et même à Bruxelles, alors qu'il était déjà assez méchant et aigri. Comme aucun journaliste de Best n'était présent au concert, Gérard m'a demandé de faire le papier et j'ai accepté, car j'avais été plutôt bon en français au lycée. J'ai commencé à signer de mes deux prénoms : Jean Martial. J'ai continué à travailler pour Best jusqu'à la mort de Patrice Boutin, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 70. A cette époque, nombreux étaient les attachés de presse, Stanislas Vitold de chez Philips, Max Dumas de chez Pathé à collaborer aux journaux, car nous étions toujours les premiers au courant. Personne ne nous a jamais accusés d'être juge et parti, bien que nous écrivions sur nos artistes. A l'époque, un papier était plus un compte-rendu d'un concert, d'un disque, qu'une réelle critique. Pour nous, c'était un appoint à nos salaires non négligeable et la possibilité d'assister à des concerts. C'était aussi la naissance d'une presse spécialisée. Salut Les Copains était fait par des journalistes, Best par des musiciens qui écrivaient, ce n'était pas pareil.
Platine : On dit que Barclay connaissait en 1969 une phase difficile, vous l'avez ressentie ?
Jean Mareska : Plutôt, car j'ai été viré (rires). Il y a eu une charrette mi-70 à l'international, et au bout d'un an et demi, j'ai quitté Barclay. Nous avions peu de contact avec les gens du national, qui nous considéraient comme des martiens. Nous avions des cheveux sur les épaules, et le look de nos artistes. On était une équipe de barge à la promo comme à la prod. Nous n'étions pas à la même adresse que le siège de Barclay, mais dans un appartement dix numéros plus loin, au 153, avenue de Neuilly à Neuilly. Je connaissais un peu Nicoletta, et je n'ai jamais vu Sardou. Je jouais seulement au flipper avec Philippe Lavil, ce qui m'a permis de le retrouver plus tard, en 1982, et d'être son directeur artistique.
Platine : Qu'avez-vous fait alors ?
Jean Mareska : Je suis rentré chez un éditeur, Denis Bourgeois, qui dirigeait Bagatelle et pendant six mois j'ai été label manager d'un petit catalogue qui s'appelait Afco Embassy et qui n'avait que deux artistes : Eric Mercury et un groupe qui s'appelait Liquid Smoke. Ce n'était pas très facile à promouvoir. Ensuite, j'ai retrouvé mon ancien patron de chez Barclay, Bernard De Bosson, lors d'un cocktail. Il m'a dit qu'il était en train de monter une nouvelle maison de disques : Kinney-Filipacchi, la réunion de Warner, Elektra et Atlantic, et m'a proposé un job. Je ne voulais plus faire de promo, car, quand j'avais des disques difficiles, je n'arrivais pas à les imposer aux radios, n'étant pas du genre a revenir à la charge lorsqu'on me jetait avec un disque. Je lui ai demandé de faire autre chose et il m'a propose un poste de label manager pour Atlantic et Elektra. Nous étions en mai 1971. Même si la Soul d'Atlantic était un peu en perte de vitesse, ce catalogue avaient de nouvelles valeurs sûres : Led Zeppelin, Crosby Stills Nash and Young. Elektra était aussi un très beau catalogue où il y avait les Doors, Tom Paxton. Warner avait Grateful Dead, James Taylor. Nous étions une jeune maison de disques, mais notre trésor de guerre était monstrueux. Mon patron y était Dominique Lamblin qui venait de chez Decca où il avait été label manager des Rolling Stones en France. Ces derniers venaient de créer leur propre marque Rolling Stones Records et avaient signé un deal avec Atlantic pour le monde. Nous nous sommes donc retrouvés avec les Stones au catalogue et... bientôt dans nos bureaux. Pour moi qui ne les avais vus que sur scène jusqu'alors, ça avait de quoi nous donner la grosse tête. La première chose que j'ai faite chez Kinney-Filipacchi, fut d'organiser une party au Port Canto de Cannes pour célébrer la signature de leur label avec Atlantic et le lancement de leur nouveau disque "Sticky Fingers". Toujours à propos des Stones, nous sommes allés les voir, tous frais payés par Kinney, l'année suivante, au Madison Square Garden de New-York. C'était le dernier concert de leur tournée américaine et Stevie Wonder était en première partie. A la suite du concert, nous avions été aussi invités à une grande party sur le toit d'un hôtel new-yorkais. Là, il y avait Andy Warhol, Bob Dylan et comme orchestre d'ambiance, en alternance Count Basie et Muddy Waters. Quel fond sonore mes amis !! En plus, quelques mois après, Bernard De Bosson, avec une équipe artistique composée de Michel Berger et Jean-Pierre Orfino, ex-Pirate, a commencé à signer des artistes français : Jeanne-Marie Sens, Véronique Sanson, Michel Jonasz, France Gall. Nous en étions tous très proches, car ils aimaient les mêmes choses que nous. Nous pouvions parler de Joni Mitchell et Judy Collins à Véronique Sanson, de Randv Newman à Michel Berger, nous étions de la même famille musicale. Je me souviens bien du jour où Véronique Sanson a rencontré Stephen Stills, avec lequel elle a eu ensuite une liaison. C'était dans les salons du Georges V où il y avait une party, . Je me souviens qu'Hugues Aufray était là, et qu'on a présente Véro à Stills. Ils ont commence à parler tous les deux, sont allés s'asseoir dans un coin, et ne se sont plus quittés de toute la soirée. C'était comme dans les romans d'amour, plus rien n'existait pour eux.
Platine : Vous restez longtemps dans cette aventure ?
Jean Mareska : Quatre ans et demi environ à l'international, durant lesquels, j'ai fait pas mal de festivals en Angleterre, notamment à Bath. Entre temps, j'avais rencontré mon épouse, je continuais a écrire pour Best, et je voyais toujours mes potes musiciens. Pour en revenir aux artistes de notre catalogue, vous ne devinerez jamais quelle était leur première question, quand ils débarquaient en France ? (rires). C'était texto "Est-ce que c'est vrai qu'il y a des putes nues au Bois de Boulogne ?" Ils devaient se transmettre l'info de groupes en groupes, car je ne sais pas combien de fois, nous avons dû faire les guides, surtout Benoît Gautier car moi j'avais une vie rangée. Il prenait la limousine et faisait un charter en direction du Bois de Boulogne. Un seul groupe ne nous a pas demandé cela, c'est Blacko Arkansa, un groupe pré-hard, avec un chanteur qui se produisait torse nu, moulé dans un pantalon en daim de façon outrancière, et qui a demandé à visiter le Musée du Louvre. Nous n'en revenions pas. En revanche, la vague française des néo-romantiques pattes d'éph n'était pas du tout notre tasse de thé, tant et si bien qu'on nous a souvent reproché d'être frimeurs, grandes gueules et show off. Mais, vu le catalogue international et français "classe", que nous avions, c'était un peu inévitable. L'avenir a prouvé que notre écurie était celle de l'avenir, et nous devions être un peu odieux.
Platine : Début 1975, vous quittez l'international pour le national ?
Jean Mareska : Ça m'agaçait un peu de ne pas être à la source d'un succès, de m'occuper d'un album quand il était déjà double ou triple disque d'or aux USA. J'étais un peu frustré et je m'en étais ouvert à Dominique et à Bernard, qui savaient que j'étais bien branché par la musique américaine acoustique, le genre Crosby Stills, Nash and Young, Yes, Genesis Un beau jour, vers fin 1974, ils m'ont appelé dans leur bureau en me lançant "Tu veux toujours faire le directeur artistique ? Ecoute ça !", à l'époque cela ne s'appelait pas encore producteur. Ils avaient reçu une maquette d'un groupe et ils me l'ont faite écouter. C'était une maquette extrêmement élaborée d'un groupe qui se faisait appeler Taï Phong. J'ai appris plus tard que cela signifiait "Grand vent" en vietnamien, et que cela était l'idée des deux frères qui drivaient le groupe et qui s'appelaient Tai et Khanh Ho Tong. Je ne me souviens plus exactement, ce qu'il y avait sur cette maquette, mais je suis sûr d'avoir écouté "Sister Jane", que Khanh avait écrit, et peut-être un ou deux autres titres.
Platine : Vous avez tout de suite flairé le tube ?
Jean Mareska : Nous avons été tout de suite très emballés. Le groupe nous proposait d'aller le voir là où il répétait, dans la maison des parents Ho Tong (Alias Mr and Mrs Minh). Nous avons pris rendez-vous et, quand nous sommes arrivés, nous avons découvert qu'ils répétaient dans le sous-sol d'une grande maison, qui avait été entièrement aménagé pour eux. Cela va sans dire qu'ils n'étaient pas dans le besoin et ne connaissaient pas la galère. Je me suis vite rendu compte qu'ils étaient techniquement très avancés, car ils avaient été jusqu'à faire un souple, c'est-à-dire une gravure de leurs enregistrements. Khanh avant été graveur de disque, il connaissait toutes les ficelles des studios d'enregistrement. Les frères Ho Tong avaient recruté trois musiciens français de leur quartier, le sud de Paris, du côté de Montrouge. L'un d'eux avait été organiste à l'église de Montrouge et avait chanté dans les Red Mountain Gospellers, avant de faire partie du groupe Phalanstère, dont le nom venait d'une vieille formation militaire. Son nom était Jean-Jacques Goldman. Les autres étaient Stéphan Caussarieu, le guitariste, et Jean-Alain Gardet, le clavier. Nous avons rapidement signé un contrat avec eux pour trois ans et trois albums, ce qui était classique à cette époque. Nous n'avons pas hésité car Taï Phong nous paraissait vraiment dans le coup. Ils étaient dans la mouvance Yes, Genesis, et en plus ils avaient un tube très commercial pour l'été qui arrivait. Une chanson au format radio périphérique, c'est-à-dire d'un peu plus de 3 minutes, "Sister Jane". Très vite, nous avons pris des dates pour aller en studio et je dois dire aussi que je n'ai pas eu beaucoup de travail, en qualité de directeur artistique. Lors des séances d'enregistrement des définitifs qui ont eu lieu au studio IP (un 16 pistes rue du Colisée) en février-mars 1975, les frères Ho Tong étaient très organisés et avaient des cahiers sur lesquels ils avaient tout noté scrupuleusement : les mélodies, les textes, les arrangements... Jean-Jacques chantait les principales voix lead, Taï, qui était le bassiste, en chantait aussi quelques unes, et puis les autres faisaient des choeurs. Les têtes du groupe étaient déjà Khanli (qui signait Khanh Mai alors que son frère signait Tai Minh), et Jean-Jacques. En studio, nous avons travaillé avec Georges Blumenfeld, Jean-Pierre Pouret, Andy Scott et Philippe Beauchamp. Pendant cette période d'enregistrement, Jean-Jacques est parti à l'armée. Comme il n'était pas très loin, à Issy ou peut-être Villacoublay, et que c'était assez souple pour lui, nous allions le chercher en voiture quand nous avions besoin de lui pour faire des voix ou des photos avec Claude Gassian. Il demandait une permission, nous attendait devant sa caserne, ses cheveux étaient devenus très courts - on le voit ainsi d'ailleurs sur la pochette du premier album - enregistrait et se faisait reconduire en voiture à la fin de la séance. Comme il était extrêmement doué, cela allait très vite. Nous avons fait le premier album en même temps que le single qui en était extrait. Ce n'était pas le cas dans toutes les maisons de disques, mais chez WEA, tous nos artistes sortaient un album, en même temps qu'un premier simple.
Platine : Comment s'est passée la promo de "Sister Jane" ?
Jean Mareska : Pour faire la promo, qui s'est résumée à quelques radios et quelques télés, Jean-Jacques prenait d'autres permissions. Si Taï Phong n'a pas fait beaucoup de télés c'est que le groupe n'était pas très "télégénique" : ils chantaient en anglais, n'étaient pas très à la mode côté variété, n'avaient pas beaucoup de présence scénique car ils ne bougeaient pas, étaient très statiques. Je leur disais d'avoir un peu l'air gai quand ils chantaient "Sister Jane", mais ça n'était pas "Le sirop typhon", pas vraiment la chanson pour rigoler. La chanson est également passée beaucoup en discothèque et avait reçu la mention Spécial Disc-jockey, comme tous les disques "aptes" a séduire les boîtes de nuit, comme les Doobie Brothers. Le groupe était plus un groupe de studio qu'un groupe de scène : c'étaient des auteurs, des compositeurs, plus que des gen, de scène. Ce qui explique aussi qu'ils en ont fait ensuite très peu. Leur formule musicale ne leur permettait pas de faire la scène comme ça. Il leur fallait de gros moyens, beaucoup du matériel, des synthés, qui étaient a l'époque nouveaux et très chers. Si pour les Variations, quelque temps avant, quelques Marshall étaient bons, pour Taï Phong trois amplis dans un coin de night-club étaient largement insuffisants.
Platine : Le single a dû se vendre très bien, mais l'album beaucoup moins ?
Jean Mareska : Nous avons dû vendre 40 à 50 000 albums très rapidement, c'était très bien pour un premier album. Et il s'est même vendu à l'export, jusqu'au Japon avec un pressage spécial, ce qui nous a étonné. Le single lui n'a été qu'un gros succès en France et en Belgique, quelque chose comme 200 000 exemplaires. C'était un été très slow avec "L'été Indien" de Joe Dassin. Il est d'ailleurs sorti sur un petit label aux USA. Probablement une sous-marque d'Atlantic. Pour eux qui venaient de milieux aisés, l'argent n'était pas leur principal préoccupation, mais ils avaient vraiment envie de réussir dans la musique, ça c'est clair. Ca n'était pas un hobby, c'était métier pour eux : ils avaient rapidement créé une société, de façon a pouvoir gérer les achats de nouveaux matériels. Ils avaient négocié les éditions avec You You Music qui étaient les éditions qui dépendaient de WEA.
Platine : Après le succès du premier single, comment avez-vous pu enchaîner ?
Jean Mareska : Les chansons du deuxième album étaient quasiment finies quand le premier a été enregistré. C'est vrai que pour trouver une chanson qui allait succéder à "Sister Jane", ils ont beaucoup discuté et des dissensions ont commencé à apparaître dans le groupe. Ils étaient cinq et avaient chacun une personnalité forte et un point de vue sur tout bien arrêté. On a donc sorti un deuxième single intermédiaire : "North for winter", qui n'est ni de Jean-Jacques, ni de Khanh qui étaient les deux têtes pensantes du groupe, mais qui est chanté par Tai. En plus, pour la promo en télé, après avoir vu un chanteur français, grand et mince, les téléspectateurs découvrait un Vietnamien petit et rondouillard : pour le marketing, ça n'était pas terrible, mais je ne pouvais rien contre les luttes internes. C'était à qui allait chanter, à qui allait placer sa chanson, qui allait imposer son idée sur les arrangements en studio, où bien sûr il se mettait en valeur. Les mixages se faisaient à 12 voire 14 mains, jusqu'à ce que l'ingénieur du son craque et remette les tirettes à zéro et qu'on recommence. Je ne sais pas combien d'ingénieurs du son le groupe a dû user. Toujours sans photo, avec une illustration toujours signée de Lang, le troisième frère Ho Tong, ce single n'était extrait ni du premier ni du second album. Il avait été enregistré en plus, car les maisons de disques n'hésitaient pas et avaient les moyens d'investir : je ne sais pas combien d'albums de Jonasz on a produits avant d'en vendre. S'il n'y avait pas de photo sur les pochettes de Taï Phong, c'est qu'il n'y avait pas grand chose à montrer : Taï Phong n'était pas un groupe à paillettes mais un groupe de musiciens. En plus, je crois qu'ils n'avaient Pas tellement envie de faire voir leur tête, ils n'étaient pas narcissiques, n'avaient pas envie de se montrer, ni sur scène, ni en public. Ils voulaient vraiment faire les choses à leur manière, à leur vitesse à eux. Le deuxième album, "Windows", est sorti l'année suivante, toujours enregistré à IP entre janvier et mai 1976. Un album par an, c'était la cadence à l'époque. Le seul single qui est sorti de ce deuxième album était "Games".
Platine : Quand des problèmes ont commencé à naître dans le groupe, venaient-ils vous voir pour se plaindre les uns des autres ?
Jean Mareska : Non, quand même pas. Ca n'était pas non plus l'époque où un groupe renégociait son contrat après un tube. Nous avions donc plus des rapports artistiques que juridiques ou commerciaux.
Platine : Avant le troisième album de Taï Phong, Jean-Jacques Goldman sort un premier single en solo. Comment cela s'est-il passé ?
Jean Mareska : Jean-Jacques vouait une admiration énorme à Michel Berger, qu'il considérait comme le compositeur le plus brillant du moment, et qui était aussi chez WEA. Je me souviens les avoir présentés l'un à l'autre et que Jean-Jacques était très ému. Un jour, on nous a fait part, à moi, comme à Dominique Lamblin, que Jean-Jacques allait enregistrer des simples en solo. Cela n'a pas été sans mal vis-à-vis du groupe, car Jean-Jacques allait mener deux carrières en parallèle. Un contrat de trois ans avait été signé avec lui précisant qu'il devait y avoir quatre ou six mois d'espace entre la sortie d'un disque Taï Phong et celle d'un disque solo. Même s'il allait chanter en français en solo et en anglais pour le groupe, les tensions se sont densifiées. Jean-Jacques avait fait savoir au groupe qu'il ne tournerait pas avec, il ne voulait pas tourner, et nous avions alors aussi commencé à lui chercher un remplaçant uniquement pour la scène. Taï Phong trouvera d'ailleurs à cet effet Michaël Jones qui était le garçon censé remplacer Jean-Jacques sur scène. Nous sommes donc rentrés en studio pour un premier disque solo en 1976, "C'est pas grave papa". Pour l'accompagner, nous avions choisi des musiciens de studio, des calibres du genre Pascal Arroyo, Marc Chantereau. Patrice Tison, ou de la bande à Lavilliers avec lesquels j'était copain, et qui de toutes façons étaient bons et rapides (les studios se louent à l'heure...) et n'étaient cependant pas plus chers (sauf Claude Engel...), les tarifs étant syndicaux. Ce n'était pas du tout les gens de Taï Phong. Ce premier disque n'a pas du tout marché et on s'est ramassés.
Platine : En 1977, vous sortez un deuxième disque en solo entre deux singles de Taï Phong ?
Jean Mareska : "Les nuits de solitude" était une chanson que Goldman avait proposée à Taï Phong en anglais et que le groupe avait refusée. En français comme en anglais, Jean-Jacques écrivait tout, paroles comme musique. La seule chose qui le "gonflait" vraiment, c'était le mixage. Il y assistait mais ne voulait pas intervenir. Il disait souvent qu'à partir du moment où il avait fini de mettre sa voix sur la bande, il avait fini son boulot et que c'était mon affaire et celle de l'ingénieur du son. Il faut dire que pour poser sa voix, ça allait très vite : en une ou deux prises il était en place, avait le feeling, était parfait. La seule chose qu'il demandait c'est qu'on le prévienne 20 minutes avant de chanter pour qu'il aille se remplir l'estomac, en allant acheter deux ou trois brioches, pains au chocolat, croissants... Malheureusement, ce deuxième simple en solo n'a pas marché plus que le premier, ni moins que le troisième, "Back to the city again", toujours en 1977. On a dû en presser 1000 ou 2000 de chaque et puis c'est tout. Je crois que Jean-Jacques n'a décroché aucune promo, ni en radio, ni en télé, en plus parce que l'équipe de promotion percevait très mal les velléités artistiques en solo de Jean-Jacques et devait se dire : "Mais qu'est-ce qu'il nous fait ?". Je me souviens d'une réunion un jour chez Warner, où la directrice de promotion m'a dit alors que j'annonçais le troisième disque de Jean-Jacques, "Encore lui. mais tu ne veux pas arrêter ?!" Il y a cependant dans les trois premiers disques de Jean-Jacques en solo, les trois pôles autour desquels il va construire tout son répertoire futur. D'abord, le social familial : le papa qui rentre à la maison après avoir perdu son boulot et auquel les enfants répondent "c'est pas grave papa, chante nous une petite chanson". Ensuite, il y a le social humain : la tristesse et la solitude de l'homme isolé même quand il est entouré, "Les nuits de solitude". Enfin, il y a l'humour sur le social avec "Back to the city again", l'histoire de citadins qui partent élever des moutons à la campagne, se rendent compte de ce que sont les réalités à la campagne et reviennent vite à la ville respirer le bitume. Il y avait même un côté un peu provoc.
Platine : Ces trois singles ont été des échecs. Pourquoi Jean-Jacques Goldman n'a-t-il pas enregistré d'albums alors que chez WEA, même les débutants y avaient droit ? La maison de disques n'y croyait pas ?
Jean Mareska : Il n'y avait pas chez lui de velléité d'albums, il voulait faire des coups, des chansons Pop. Le propre d'une chanson Pop à l'époque était d'être sur un support court: C'était peut-être aussi parce qu'il avait vu le succès des singles de France Gall produits par Michel Berger comme "La déclaration". Jean-Jacques avait un contrat de trois ans. donc d'autres singles auraient du suivre, malheureusement cela n'a pas été le cas. Les singles de Taï Phong, "Follow Me" en 1977, tellement club disco qu'on a pressé un maxi promo. et "Back again" en 1978, où Jean-Jacques chante également. n'ont pas marché non plus. Ils n'étaient pas extraits du deuxième album .
Platine : D'où est venue l'idée du medley de slow, "Slow me again" en 1978 ?
Jean Mareska : Du succès de "Rock Collection" de Laurent VouIzy en 1977. Jean-Jacques, toujours à l'affût d'un bon coup m'a dit : "Si on faisait la même chose avec des slows ?". J'étais OK et on a enregistré la chanson sous un troisième nom : Sweet Memories, c'était vraiment un coup, avec un avenant au contrat d'interprète de Jean-Jacques. On a travaillé avec un arrangeur qui s'appelait Michel Bernholc pour arriver à imbriquer les 15 ou 20 chansons les unes dans les autres, ce qui n'était pas une mince affaire bien que celles que nous avions choisies étaient toutes bâties sur le même anatole, les même suites harmoniques. On passait de "Only you" des Platters à "Nights in white satin" des Moody Blues. Jean-Jacques n'y a fait que poser sa voix en alternance avec une amie anglaise qui faisait des passages parlés. Ce disque fut un gros succès de discothèque, mais n'a pas vendu vraiment. Aujourd'hui, dans la réédition "Les années Warner", on retrouve ces chansons de 45 tours regroupées en album.
Platine : Comment était l'ambiance dans Taï Phong à cette époque ?
Jean Mareska : Jean-Alain Gardet, le clavier avait même quitté le groupe la veille du premier vrai grand concert que Taï Phong avait produit et devait donner à la Maison de la Culture, ou des Jeunes, de Créteil. De gros moyens avaient été mis en place, il était prévu des plantes vertes partout, le batteur devait être installé dans une cage plexiglas, la guitare de Khanh devait tenir toute seule dans les airs, accrochée aux cintres par des fils de ny1on, Lang avait travaillé le light-show, les effets scéniques. Quand le rideau s'ouvrait, il y avait deux samourails "électriques" de deux mètres de haut, sur scène. Au dos de ces derniers, tous les racks, les boîtes d'effets, étaient planqués. Cela avait été un travail colossal et la nouvelle du départ de Jean-Alain était une catastrophe. Stéphan, le batteur, est même allé jusqu'à Limoges pour le convaincre de revenir faire le concert, avant de partir définitivement. C'était peine perdue. C'est là que l'on peut se rendre compte de la puissance et de la faculté d'adaptation des gens de Taï Phong qui ont tout de suite compris qu'un remplaçant, aussi bon soit-il, ne pourrait pas en quelques jours apprendre toutes les chansons du concert, et qui ont décidé d'en prendre quatre, chacun d'eux se chargeant de deux oui trois morceaux. Et le concert il eu lieu et c'était bien. La salle était loin d'être vide et ils ont même fait un tabac. Le nouveau chanteur Michaël Jones, était là remplaçant Jean-Jacques qui n'est pas même venu voir le concert.
Platine : A cette époque, vous étiez plus proche de Jean-Jacques que des autres membres de Taï Phong ?
Jean Mareska : Oui, nous étions très copains. J'étais copain avec les autres de Taï Phong aussi, mais je me souviens que je voyais Jean-Jacques beaucoup. Peut-être parce qu'avec les 45 tours en solo en plus de Taï Phong, nous avions déjà plus de raisons de nous voir. J'ai une photo de mon fils Eric, qui avait quatre ou cinq ans, avec Jean-Jacques jouant du Fender. Nos femmes ont sympathisé très vite, nos enfants aussi, j'appréciais beaucoup sa compagnie et lui devait apprécier la mienne. Il était très simple, continuait à travailler dans le magasin de sports de ses parents.
Platine : Le dernier album et le dernier simple de Taï Phong sort en 1979, le titre "Fed up" (plein le c...), exprime la situation du groupe ?
Jean Mareska : Je ne sais pas, mais peut-être que Jean-Jacques a mis quelque malice à chanter cette chanson. En face B, "Shanghaï casino" était aussi un titre dans cet esprit disco qui faisait des ravages à l'époque et n'a rien arrangé au succès du groupe. Le disco n'était pas pour eux, Jean-Jacques écoutant avant tout AC/DC. Tout allait mal. A cette époque, est sorti aussi le troisième album de Taï Phong, qui est passé aussi inaperçu que le second. J'avais trouvé le nom de l'album, "Last flight", en sachant que c'était le dernier du contrat, mais aussi du groupe. Il a cependant été fait suite à une demande du commercial de chez Warner qui nous disait avoir des demandes de la part des disquaires et avançant la théorie que si les singles ne se vendaient pas c'était parce que Taï Phong n'était pas un groupe de singles. En plus, le premier, comme le second album continuaient à se vendre. J'ai réuni le groupe, leur ai expliqué le projet en commun, alors que je ne voyais plus les membres de Taï Phong qu'indépendamment les uns des autres. Je sentais que c'était la fin, qu'aucun des cinq membres n'avait envie de le sauver. Ils ont écrit les morceaux de ce troisième album, chacun dans leur coin, car plus rien n'était en commun depuis longtemps. Ils avaient tous fait des chansons en prévision d'un futur éventuel single : Jean-Jacques a apporté deux chansons, Khanh aussi, jusqu'à Stéphan, qui n'avait jamais rien signé, a décidé d'apporter aussi une chanson, plus pour avoir son mot à dire que pour des problèmes de fric. Jusqu'à Michaël Jones et Pascal Wuthrich, qui ne faisaient partie que scéniquement du groupe, qui ont voulu apporter une ou deux chansons... Nous avons plus choisi les chansons pour que chacun ait la sienne que pour leurs qualités. Quand on écoute ce disque, on se rend vraiment compte de ce manque d'homogénéité : ce n'est plus un album d'un groupe mais de sept individus, alors que de grands noms ont participé à l'album, comme Michel Gaucher ou Jean-Pierre Janiaud, et qu'il a été enregistré au studio Gang de février à juin 1979. Mais, évidemment, ça n'a pas marché.
Platine : Comment annonce-t-on à un groupe qu'on arrête les frais ?
Jean Mareska : Cela s'est fait tout seul. Tout le monde rejetait la faute sur l'autre mais comprenait que ça n'était plus possible. En plus, comme il n'y avait pas de ventes derrière, le dernier ciment qui pouvait unir le groupe, était inexistant.
Platine : On raconte qu'en 1980 Jean-Jacques a écrit la musique d'un disque de First Prayer avec "High fly"/ "Tell me why". C'était sous votre direction artistique aussi ?
Jean Mareska : Je ne me souviens pas de cela, mais Jean-Jacques à la fin des années 70 a commencé à faire plein de choses pour d'autres et je n'étais pas au courant de tout. Je sais que grâce à un petit éditeur, Marc Lumbroso, il a placé quelques chansons, peu, car il avait une écriture tellement personnelle que ça n'était pas facile à faire chanter. C'est comme cela qu'ils ont commencé à travailler ensemble. J'ai quitté Warner en 1980 : au bilan Taï Phong, mais aussi des artistes Comme Philippe Lavil, mon copain de flipper de chez Barclay. Avec lui, chez Warner, j'ai fait trois singles dont "Mister Lee". Je l'avais mis en contact avec Didier Barbelivien, que j'avais connu chez un éditeur par hasard alors que je cherchais un parolier pour la musique de "Mister Lee" que j'avais en maquette sur bande, car à l'époque ou ne travaillait pas sur cassette. Un autre de mes groupes importants chez Warner fut Week-End Millionnaire avec lequel j'ai fait deux albums.
Platine : Vous avez suivi l'arrivée de Jean-Jacques chez Epic en 1981 ?
Jean Mareska : Un jour vers 1980. avant que je ne quitte Warner, Jean-Jacques est venu me voir avec une maquette de dix ou douze titres, quasiment tous ceux qu'on va trouver sur le premier album chez Epic. Il avait enregistré ces titres sur son quatre pistes dans sa cave, sommairement. Il me dit : "Les singles, j'ai réfléchi, c'est pas mon truc, je veux faire un album.". J'ai pris la bande et je suis allé la faire écouter au directeur de la production française, qui était, a l'époque, Jean-Pierre Bourtayre, l'ex-collaborateur de Claude François. Il a tout de suite dit non à l'album de Jean-Jacques. J'ai insisté et il accepté de produire un single. J'ai repris ma petite voiture et je suis allé à Montrouge porter la réponse à. Jean-Jacques, qui était dans son magasin de sports. J'ai essayé de le convaincre d'accepter le single, mais il n'en voulait pas : c'était un album ou rien du tout. Je suis reparti me disant que je pourrais convaincre Bourtayre. Je lui en ai reparlé, en proposant de faire un album pas trop cher mais le "Non", fut toujours aussi catégorique. J'ai donné cette nouvelle réponse à Jean-Jacques, qui a envoyé chez Warner un petit mot qui lui ressemblait, précis et concis, du genre : "Vu les bons résultats qu'on a obtenu ensemble quant a ma carrière en français, merci de me rendre mon contrat". Et Warner lui renvoya son contrat. En août 1980, j'ai quitté Warner. Des gens nouveaux étaient arrivés, en moins d'un an, de nombreux autres contrats avaient été rendus : à Rose Laurens, qui est partie ailleurs faire "Africa", à Hervé Cristiani, qui est parti ailleurs faire "Il est libre Max", à Philippe Lavil qui est parti faire "Il tape sur des bambous" chez RCA, Jean Shulteiss, qui a fait "Confidences pour confidences" chez Carrère... Je sais que Jean-Jacques voyait beaucoup Marc Lumbroso. Quelques mois après, fin 1980 ou début 1981, comme j'étais libre, j'ai proposé à Jean-Jacques d'aller présenter son album aux autres maisons de disques. Il a accepté. J'ai donc fait le tour de toutes les maisons de disques que je connaissais, ma bande sous le bras, en disant partout : "Ecoutez, c'est l'ex-chanteur de Taï Phong...". Il ne manquait qu'un titre par rapport au futur album, je ne sais plus lequel. En revanche, il y avait "Il suffira d'un signe", qui était à la base une chanson lente, presque molle. Je me souviens que Jean-Jacques un jour a rajouté une guitare derrière et cela a donné la pêche. Malgré ça, avec cet album, je me suis fait jeter de partout : de chez RCA, Philips, AZ. Le seul qui m'ait donné une réponse négative cohérente fut le patron de la production chez Barclay, Claude Righi, que je connaissais car il avait fait un passage chez Warner. Il ma dit qu'il développait un artiste à la couleur de voix trop similaire à celle de Jean-Jacques : Daniel Balavoine. Marc Lumbroso s'est, de son côté, fait jeter de chez Epic, de chez Sony, de chez Francis Dreyfus, je crois. Personne ne voulait de Goldman. C'est finalement Jean-Jacques qui, connaissant quelqu'un de chez Sony qui n'était pas à l'artistique, est allé le voir. Cette personne, je crois que c'est Jean-Jacques Gozlan qui était au commercial à l'époque, est revenu à la charge chez Epic et Jean-Jacques a été signé. On doit saluer le flair de Sony qui, après Joe Dassin, Francis Cabrel ... a su voir les potentialités de Jean-Jacques. Mais là, je n'ai pas très bien suivi, car l'histoire commençait à m'échapper. Jean-Jacques m'a annoncé la nouvelle en me précisant qu'il était désolé mais qu'on ne pourrait plus travailler ensemble, étant donné que chez Epic, on lui imposait un directeur artistique anglais.
Platine : Vous aviez d'autres projets à part Jean-Jacques ?
Jean Mareska : Oui. Je travaillais, d'abord en parallèle de chez Warner puis en indépendant, pour les producteurs financiers de Philippe Lavil, Tabata, qui étaient distribués par RCA. De 1979 à 1980. on a fait deux simples qui se sont ramassés, puis en 1981, on a fait ensemble "Il tape sur des bambous", qui a explosé en 1982. J'ai fait aussi des disques avec d'anciens membres de Week-End Millionnaire, Jean-Michel Navarre, Alain Thomas, grâce auxquels j'ai connu Jean-Pierre Mader à Toulouse. J'ai aussi travaillé avec Nicolas Peyrac, Martine Clémenceau... En 1987, je suis rentré chez Flarenasch, où j'ai fait "Disparue" avec Jean-Pierre Mader... En 1988, je suis passé chez Pianola, en 1990 chez Arcade, où j'ai appris beaucoup de techniques que les maisons de disques plus classiques n'utilisaient pas à l'époque. Depuis 1991, je suis chez Sony, la maison de disques de Jean-Jacques Goldman, la boucle est bouclée.
Platine : Dans la discographie de Jean-Jacques, on trouve un disque avec Taï Phong en 1986 chez Vogue ?
Jean Mareska : C'est vrai. D'anciens membres du groupe. qui ont toujours voulu refaire de la musique, sont venus me voir régulièrement durant ces années pour remonter le groupe. En 1986, j'ai réussi à convaincre Detry chez Vogue de les laisser refaire un simple, assumant la direction artistique. Ils voulaient que je demande à Jean-Jacques, qui était devenu énorme, de venir jouer avec eux. J'ai fait l'intermédiaire, n'y croyant guère. A mon grand étonnement, il a accepté en demandant simplement que le studio ne soit pas très loin de chez lui et d'écouter une maquette au préalable. Il a aussi prévenu Sony qu'il allait participer à ce disque Vogue, pour ne pas avoir d'ennuis avec le juridique. Nous lui avons envoyé la maquette d' "I'm your son" signé par Stéphan, et j'ai réservé un studio du côté de la Porte de Vanves. Jean-Jacques est allé enregistrer, à l'heure prévue, un après-midi. Ça n'a pas duré longtemps, deux heures maximum. Comme toujours, et peut-être même encore plus qu'avant, il était bon aux premières prises. Ses anciens camarades de Tai-Phong, Stéphan et Khanh, pensaient qu'il allait juste faire une petite guitare, mais il s'est mis devant le micro et a fait les chœurs. C'est nul à dire, mais nous étions aux anges, nous retrouvant dix ans en arrière. Le disque est sorti avec le nom de Jean-Jacques sur la pochette, mais il n'a pas marché. Après cela, Jean-Jacques a invité pour un de ses Zéniths, Stéphan et Khanh à venir faire les chœurs sur scène, et, une fois encore, j'ai été très ému.
Platine : Deux compilations propose un "Sister Jane 93". Qu'est ce que c'est ?
Jean Mareska : L'année dernière, Stéphan et Khanh - qui tient maintenant un magasin de musique - ont trouvé un chanteur qui chante comme Jean-Jacques. Comme Alain Puglia voulait "Sister Jane" pour "Génération slow" chez Flarenasch, ils l'ont réenregistrée et ça ressort cette année chez Vogue dans les "Méga summer hits"... en attendant le vingtième anniversaire de la chanson...
Propos recueillis par J.-P. P. le 8 juin 1994 Photos: X... DR. Collections Numéros 1, Jean Mareska et Eric Jacquet. Remerciements à Zita Berube pour son aide précieuse.
Retour au sommaire - Retour à l'année 1994