
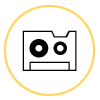
|
Disque : qui perd gagne à produire français ?
|
Disque : qui perd gagne à produire français ?
Libération, 23 octobre 1995
Laurent Rigoulet
Retranscription de Monique Hudlot
Disque : qui perd gagne à produire français ? Les labels cherchent tous azimuts la perle rare. Récit d'une surenchère.
D'une maison de disques à l'autre, le même mot d'ordre : "Trouver le nouveau Cabrel, le nouveau Souchon, le nouveau Goldman…" Eviter à tout prix de sauter une génération. Ne pas se reposer sur les succès millionnaires de ceux que la profession appelle les "quadras". Produire français, dénicher les talents de demain, leur donner le temps de mûrir, amortir le coût de plus en plus extravagant de leurs carrières.
Un joli casse-tête. La France pourtant se défend. Elle est un des derniers pays où la production locale fait jeu égal avec les pointures anglo-américaines (environ 50-50 dans le domaine des variétés). Mais la corde est franchement raide; les investissements sont lourds et les résultats souvent décevants. Certains gardent de l'allant. Emmanuel de Burtel, responsable de Virgin France, avance qu'il pourrait vivre "en ne produisant que français". Il a rentabilisé en quatre ans Delabel, une nouvelle structure jouant la gagne avec de jeunes artistes du pays (Alliance Ethnik, IAM, Tonton David…). Son optimisme est largement tempéré par les interrogations qui minent le métier. Et par ce chiffre, répété à l'envi : "80% des productions françaises sont déficitaires."
"Comment produire français si on n'en a pas les moyens", demande Sylvain Jaraud, avocat spécialisé dans les contrats d'artistes. "Or, aujourd'hui, la quasi-totalité des maisons de disques françaises ne sont que les filiales de multinationales. En dernier recours, ce sont celles-ci qui donneront les moyens d'investir. Seule vraie question: quelle est la marge de manoeuvre des "patrons" français pour réinvestir dans le local ?"
On peut en effet dessiner ainsi les contours de la carte : la terre de Brassens, Ferré, Bashung est aujourd'hui une zone de surprofit parmi d'autres pour les multinationales qui augmentent leurs marges bénéficiaires en "travaillant" à l'échelle planétaire des produits dont le coût est souvent amorti sur le territoire d'origine (l'Amérique en général). Certaines maisons de disques comme Warner possèdent des catalogues étrangers (Prince, Madonna, REM…) qui pourraient les inviter à ne fonctionner que comme une mini-cellule marketing chargée de rentabiliser au mieux ce trésor. C'est loin d'être aussi simple : "Quand une multinationale te met à la tête d'une filiale, dit Yves Bigot, directeur général de Mercury, elle te demande deux choses si tu veux passer le mois de janvier suivant. Travailler très efficacement l'international, maintenir le profit, et développer ton propre catalogue, parce que c'est aussi le chiffre de l'avenir".
Les hommes tournent de plus en plus vite à la tête des labels. Pour s'imposer, il faut travailler dans l'urgence. La tentation est d'aller au plus simple. Aujourd'hui le rap, le ragga, la musique black que l'on signe à tours de bras. Le coût est souvent moindre et la réaction rapide. On cherche à élargir la famille Solaar comme on l'a fait à l'époque des yé-yé ou de Téléphone. "Hors du groove, point de salut, s'amuse Didier Varrod, directeur artistique chez Sony, mais l'illusion ne dure qu'une saison".
Où est le talent capable de passer les années, voire les décennies ? Bigot encore : "Problème terrible pour les maisons de disques: Cabrel, Souchon, c'est ce que tu souhaites, mais c'est ce que tu as le moins de chances de trouver. C'est le domaine où il y a de moins en moins de mecs, celui où tu dépenses des fortunes et où tu as toutes les chances de te casser la gueule. Mais c'est là que tu peux ramasser gros parce que tu es producteur. Là que tu construis ta réputation et que tu réponds à une exigence culturelle. Celui qui n'investit pas sur la chanson française est comme un joueur de poker qui ne miserait pas".
La mise est lourde. On ne compte plus les artistes sur lesquels on dépense 2 millions de francs et qui vendent à peine plus de dix mille disques. "On surfe sur un équilibre de plus en plus précaire, constate Philippe Desindes, à la tête d'une grosse cellule de développement chez Sony France. Pendant longtemps, on finançait la production en multipliant les compilations, mais le fond de catalogue s'épuise, on n'a plus ce matelas confortable, on a de moins en moins de temps devant nous et les coûts augmentent de manière spectaculaire". Pour lancer un jeune artiste français, il faut entrer en compétition avec les produits anglo-saxons qui se taillent la part du lion sur les FM, tourner des clips qui peuvent exister aux côtés de ceux d'Elton John ou Janet Jackson.
Les additions sont vite faites. Le budget de production d'un album américain est de 1 million de francs au bas mot. Les Français sont à la relance : on va souvent chercher à l'étranger un producteur qui demande 250 000 francs en moyenne (et un petit pourcentage sur les ventes), on paye le studio, les musiciens capables d'amener leur patte, et on allonge souvent 200 000 francs à la sortie pour graver l'album aux Etats-Unis. "Parce que si tu n'as pas la patate, les radios ne veulent même pas entendre parler de toi", dit Bigot.
On est encore loin du compte. 600 000 francs au moins pour deux clips. 500 000 francs pour aider l'artiste à tourner. Et nulle garantie à l'arrivée. "C'est de l'acharnement thérapeutique, dit Didier Varrod. On trouve de moins en moins de médias pour nous défendre. Les réseaux FM - Sky, NRJ, Fun - prennent peu de risques sur la nouvelle chanson et nous reprochent de ne pas signer d'artistes qui correspondent à leur "format", il n'y a quasiment plus d'émissions de variétés à la télé et de moins en moins de petites salles pour tourner…" D'où la multiplication des pubs TV (un petit million de plus) et un courant qui privilégie le tout-marketing. Hervé Lasseigne, nouveau responsable de BMG, vient de l'agroalimentaire et s'en explique avec naturel : "Le disque aujourd'hui, c'est une réflexion sur le marché avant tout".
Les maisons de disques créent des petites structures pour "répondre à l'éparpillement du marché". Elles multiplient aussi les signatures de nouveaux artistes sur un tempo qui ne fait qu'ajouter à la confusion. "Pour beaucoup, la logique est simple, dit Emmanuel De Burtel, de Virgin. On jette vingt artistes au plafond et si deux restent collés, on est satisfait. L'élan marketing fait qu'on se jette sur les nouveaux courants. On oublie que ce n'est pas la vague qui importe mais l'artiste. Il y a déjà eu une vague rap, ceux qui ont été signés alors se sont fait jeter. Et on recommence. Où est l'intérêt de démarrer tous azimuts ? Ça n'est pas le marketing qui fait qu'un chanteur va marcher ou pas. La chanson française est bannie des FM, alors signons des artistes capables d'exister sur scène et de s'imposer peu à peu ; les grandes carrières françaises ne se sont pas bâties en quelques mois". Les exemples ne manquent pas. Bashung, Jonasz, Eicher entre autres ont mis des années avant de connaître le succès. Mais plus personne n'est sûr d'avoir le temps. "La multiplication des médias fait que les gens oublient vite, dit Yves Bigot. Quand tu es patron de maison de disques, tu sais que tu es sur un siège éjectable, tu as besoin que tes poulains marchent, tu as vite tendance à considérer qu'un artiste ne plaît pas, tu vois un échec quand tu sais que tu devrais raisonner sur cinq-six ans".
La machine s'affole et les différentes parties se renvoient facilement la balle. "Les jeunes artistes ont souvent tendance à fonctionner comme des enfants gâtés, dit Didier Varrod. Pour eux, signer sur une "major" c'est une consécration et ils manquent de vision à terme sur leur carrière. La France est un pays très particulier, on manque de managers, d'interlocuteurs un peu visionnaires qui serviraient de courroie de transmission". "Il y a presque chez eux une revendication bourgeoise, appuie l'avocat Sylvain Jaraud, qui négocie nombre de contrats pour des débutants. On a l'impression qu'ils refusent de passer par la case "vache enragée", comme l'ont fait Brassens ou les Beatles".
Ces dernières années, les négociations se sont durcies. Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, François Feldman, Francis Cabrel ont signé des contrats de licence qui font d'eux leur propres producteurs et leur garantissent plus de 30% de royalties. "Les contrats français sont parmi les plus durs au monde, dit Sylvain Jaraud. Au contraire des artistes anglo-saxons, qui doivent attendre que les investissements soient recoupés par les ventes, les artistes d'ici touchent un pourcentage dès la vente du premier exemplaire. Ces négociations sont satisfaisantes pour ceux qui les mènent. Les maisons de disques, qui peuvent avoir l'impression qu'on tue la poule aux oeufs d'or, ont toujours le pouvoir de dire non. Mais on dirait qu'il y a un manque de lucidité générale, ce microcosme se vit de manière très égocentrique comme s'il ne participait pas du mouvement général de l'économie. Pour certains artistes, ça devient un problème, ils ont un contrat de star, un statut de star qu'ils ne sont pas forcément prêts à assumer. Seulement tout le monde avance ensemble, personne n'est innocent dans cette affaire-là".
Cet été a été notamment marqué par des négociations spectaculaires. Michel Jonasz est passé chez EMI sur des critères que la concurrence taxe d'"irresponsabilité pure". Après des mois de discussions et des enchères dures, Bruno Maman - dont le premier album s'est écoulé à à peine plus de 7 000 exemplaires chez Fnac Musique - a été signé par Sony pour une avance de 1 million de francs et des royalties tournant autour de 20 %.
"La barre est tellement haute, dit un directeur général qui a quitté la table des négociations, que s'il ne vend pas 200 000, c'est un gouffre". Dominique Dalcan, qui peinait à vendre chez BMG, s'est vu proposer des sommes astronomiques pour changer d'écurie. Pas très à l'aise, il a laissé tomber l'excitation d'un cran pour signer dans une structure à hauteur d'homme, Island France. "Au bout d'un moment, dit- il, ça n'a plus tellement de sens. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'argent avancé que la disponibilité des gens qui vont travailler avec toi".
Le problème, c'est que, d'une maison à l'autre, on entend souvent la même petite chanson. Il n'y aurait pas en France tant de talents que ça. Et finalement pas de raisons d'espérer plus qu'un Bashung ou un Solaar tous les deux ans. Et le public qui tire les ficelles n'a plus les moyens de dépenser des fortunes. Plus sa confusion augmente, plus sa sanction est dure : "Il est terriblement sollicité et a une grande faculté d'oubli, dit Yves Bigot. A force de voir les efforts de promotion, il a intégré l'idée que les chanteurs sont un peu désespérés. J'ai l'impression qu'il est conscient de participer à un jeu de massacre".
Demain: la distribution, où sont passés les disquaires ?
Chiffres
5e marché mondial pour la France avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs en 1994, soit 5,4% du total planétaire derrière les Etats-Unis (33,3%), le Japon (16,7%), l'Allemagne (8,1%) et la Grande-Bretagne (6,7%). Viennent ensuite, à moins de 3%,le Canada, le Brésil, le Mexique… La part du budget individuel consacré à la musique reste faible : 0,24% (0,31 en Grande Bretagne, 0,28% en Allemagne).
60% des acheteurs de disques ont entre 15 et 34 ans.
43% du marché pour le catalogue national contre 48% à l'international en 1993 (le pourcentage restant allant au classique) : la France possède l'un des répertoires locaux qui résiste le mieux à la concurrence. Au Japon, la production locale représentait 77% contre 23% et en Allemagne 25% contre 65%.
320, le nombre d'albums commercialisés pendant le premier trimestre 1995, en augmentation de 9,6% par rapport à l'an dernier. Le nombre d'albums français est resté stable : 86 en 1995 (soit 27% du total) contre 88 en 1994. Par contre, le nombre de nouvelles signatures dans les maisons de disques a considérablement augmenté (+80% par rapport au premier trimestre 1994). Les investissements en production, promotion et marketing sont en hausse de 11%. On estime que l'investissement par artiste produisant un album est 3,5 fois plus important pour les nouveaux talents francophones que pour les artistes internationaux.
2/3 des investissements promotion sont consacrés à l'achat d'espaces publicitaires à la télévision.
40% de chansons françaises, c'est le quota que devront respecter les radios en janvier 1996.
30%, la part de diffusion de répertoire francophone à la radio, réalisée en 1994 par seulement trois artistes : MC Solaar, Francis Cabrel, Alain Souchon.
(Source: Syndicat national de l'édition phonographique)
Retour au sommaire - Retour à l'année 1995