
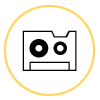
|
Interview de Jean-Jacques Goldman
|
Interview de Jean-Jacques Goldman
Télé Moustique, 24 septembre 1997
Jean-Luc Cambier
Jean-Luc Cambier : Vous êtes prêt à répondre toute la journée à la question pourquoi un album solo maintenant ?
Jean-Jacques Goldman : C'est normal. Quand on interview Zidane, on doit lui demander pourquoi il est parti en Italie. La réponse est la même que pour justifier les albums Carole Fredericks et Michael Jones : ce sont les chansons qui commandent. Après la tournée 87 où l'on avait passé un an et demi ensemble, toutes les chansons qui venaient étaient des duos ou des trios et cela a duré 10 ans. C'était déjà arrivé avant d'ailleurs pour Je te donne, chanté avec Michael, et Là-bas, avec Sirima. Il se fait que Carole et Michael ont eu envie de faire un album solo et que de l'autre côté, les chansons qui venaient étaient simples, solitaires. Par réaction à Rouge, l'album précèdent très produit, En passant est très intime.
Jean-Luc Cambier : Aux chansons de Rouge venaient s'ajouter les illustrations de Mattoti et les courtes fictions du journaliste Chalandon. Cette fois, ce sont des photos de Claude Gassian qui font écho aux nouveaux titres. Vous avez besoin d'un partenaire pour faire un album ?
Jean-Jacques Goldman : Non, mais un CD doit être un bel objet. Comme la scène, il a un côté visuel dont on doit s'occuper. Je ne peux pas prendre en charge seul, donc je m'entoure. On a trouve cette idée d'associer des photos de Claude Gassian. Voilà dix ans que je travaille avec lui, que je vois ses photos. Il est donc probable que certaines m'ont inspiré. Certaines photos sont tellement fortes que la musique en devient la bande son.
Jean-Luc Cambier : Gassian a suivi plusieurs de vos tournées et en a tiré des livres. Aimez-vous être photographié ?
Jean-Jacques Goldman : Non, et il s'en plaint beaucoup. La plupart du temps, ce sont des photos volées. On a fait une séance posée la semaine passée, la première depuis quatre ans ! Si j'aime travailler avec Claude, c'est qu'il est parmi mes amis, parmi l'équipe et puis il prend des photos au restaurant ou pendant la balance, sans se faire remarquer.
Jean-Luc Cambier : Mais la photographie c'est la possibilité de fixer l'instant qui vous intéresse ?
Jean-Jacques Goldman : Autant je suis absolument hermétique à la peinture, autant les photos me touchent. J'aime les regarder. Je fais moi-même beaucoup de photos et, comme tout le monde, surtout de mes enfants. Il y a tant de choses qui disparaissent.
Jean-Luc Cambier : Par contre, le succès n'a pas disparu malgré vos prévisions récurrentes. Sur ce point-là au moins, Goldman s'est trompé.
Jean-Jacques Goldman : Je ne sais pas si c'était une prévision ou une supposition. Quand on me demande si je suis surpris par ce succès, on trouve bizarre que je réponde oui. Pour moi, ce qui me paraîtrait étrange, ce serait de soutenir l'inverse. Quand Bod Dylan, McCartney, Ray Charles ou Barbara sortent des albums qui ne marchent pas, le gars qui croit que ça ne peut pas leur arriver est fou. D'un autre côté, il est normal que certaines de mes chansons marchent. Il en est même sur lesquelles je n'ai presque aucun doute, parce que, tout simplement, elles sont bonnes.
Jean-Luc Cambier : En 1981, vous vouliez appeler votre premier album Démodé. Vous prenez ces quinze ans de succès ininterrompu comme une revanche ?
Jean-Jacques Goldman : Je n'ai jamais eu cette idée de revanche. Quand je disais démodé, c'était plus prétentieux, plus orgueilleux qu'amer. Ça voulait dire: je suis comme ça et je ne vais pas changer pour vous.
Jean-Luc Cambier : A l'époque, les médias sérieux se moquaient de votre public de jeunes filles hystériques. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait une grande différence entre les chansons qui provoquaient alors ces réactions et celles des boys bands actuels.
Jean-Jacques Goldman : Ce n'était pas aussi différent que cela. Au début, quand les filles hurlaient sur Elvis Presley ou sur les Beatles, il y avait beaucoup de ce phénomène absolument hormonal. La musique est alors une espèce de bande son pour ces réactions qui sont un apprentissage de l'amour, qui existera toujours. La seule différence, c'est que les boys bands meurent, pas les Beatles ou Presley qui, à un moment, ont vu le contenu et l'invention de leur carrière prendre le pas sur l'attachement des filles.
Jean-Luc Cambier : De Julien Clerc à Native, le métier, toutes générations confondues, c'est la catastrophe de voir les maisons de disques et les médias parier massivement sur les boys bands. Vous comprenez cet énervement ?
Jean-Jacques Goldman : Pas du tout. Pour moi, c'est exactement comme si un écrivain était contre le catalogue des 3 Suisses. Les boys bands s'adressent aux premiers émois des filles de 8 à 12 ans, ça ne nous concerne pas où ça ne nous concerne plus ! C'est une histoire d'identification extrêmement ponctuelle. C'est un autre métier qui n'est pas de la musique. Au début, le casting doit être exécuté de façon extrêmement sérieuse et après, ils se demandent seulement quelle chanson prendre tant cela a peu d'importance. On ne peut pas lutter contre les boys bands mais ils ne peuvent pas lutter contre nous.
Jean-Luc Cambier : Pensez-vous parfois que vous devrez vous arrêter à temps ?
Jean-Jacques Goldman : J'ai entendu quelques collègues dirent: je veux finir en haut, je ne veux pas devenir un vieux chanteur. Je trouve cette façon de penser misérable. Ça veut dire que l'on a fait tout cela pour une histoire de carrière, d'image. Moi, je ne fais pas cela pour ça. Je le fais par plaisir. J'ai l'impression que tant que je prendrai du plaisir, tant qu'il y aura des gens pour m'écouter, même cent cinquante, ça vaudra le coup.
Jean-Luc Cambier : Et vous pourrez le supporter ?
Jean-Jacques Goldman : Oui. La chose la plus difficile à vivre pour moi, c'est plutôt une salle de 6 000 personnes, mais pas 200 ou 150.
Jean-Luc Cambier : Justement, cela ne vous embarrasse pas qu'aujourd'hui on n'évoque plus vos chansons que pour les faramineux droits d'auteur qu'elles rapportent ?
Jean-Jacques Goldman: C'est comme cela. C'est normal. Mais je reçois des lettres, je rencontre des gens. Ils ne me parlent pas de pognon. Ils disent : voilà, j'ai écouté cette chanson et je vous remercie de l'avoir écrite ou : à mon mariage, on a discuté ce texte ou bien : lors de tel enterrement, j'ai voulu entendre cette chanson, des trucs comme cela. Mon quotidien, il est fait de ça.
Jean-Luc Cambier : Je peux vous demander ce qu'un homme normal fait avec cet argent ?
Jean-Jacques Goldman : Oui. Vous pouvez très bien et je peux vous répondre que l'argent ne m'intéresse pas, voilà. Donc, j'ai la chance de vivre dans un pays où la plus grosse partie, c'est-à-dire plus de 60 % est redistribuée aux gens. Ce qui me laisse près de 40 % et cela fait encore beaucoup. Ça me permet, disons, d'arranger les quelques côtés difficiles a vivre de la notoriété. Par exemple, habiter dans un quartier où tout le monde se fout de toi. Ce sont les quartiers chers. Prendre parfois un avion privé pour ne pas être des heures dans une salle d'attente. Aller dans des hôtels où l'on ne va pas t'embêter... Et puis aussi aider des amis qui n'ont pas forcément le même niveau de vie pour pouvoir vivre avec eux. Mais il y en a encore trop et ce qui reste, je n'en fais rien.
Jean-Luc Cambier : Trois albums personnels en dix ans, c'est quand même peu ?
Jean-Jacques Goldman : Certains trouvent que c'est déjà beaucoup. Je compose peu, six ou sept chansons par an. Et comme j'ai composé pas mal pour les autres...
Jean-Luc Cambier : Il y aura un deuxième album pour Céline Dion ?
Jean-Jacques Goldman : Normalement, oui.
Jean-Luc Cambier : Votre rêve secret serait d'être n°1 aux Etats-Unis avec une de vos chansons pour Dion adaptée en anglais ?
Jean-Jacques Goldman : Non. Je n'ai jamais eu l'impression que les chansons de New Kids On The Block soient intouchables. J'ai toujours que c'était une question de marché. Ce n'est pas comme courir le 100 mètres en 9.82 alors que les autres se contentent de 9.89. Le succès d'une chanson n'est pas uniquement une question de talent.
Jean-Luc Cambier : Le triomphe de "Aïcha" écrit pour Khaled a été une formidable surprise. Il l'a présentée comme un pied de nez d'un arabe allié à un juif à la France du Front National. Avez-vous pensé à cet aspect des choses en acceptant sa commande ?
Jean-Jacques Goldman : Beaucoup de chanteurs m'ont proposé de travailler avec eux, je n'ai pas tout accepté. Chez Khaled, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Le fait qu'il soit arabe ne m'a pas dérangé mais n'a pas été déterminant. Mais j'ai été séduit par son courage. Pour ce qu'il représente, pour sa position sur l'Islam et ses rapports avec la musique... Ce n'est pas évident actuellement pour un Algérien de faire du raï. Certains meurent à cause de ça. Je l'ai trouvé courageux mais je ne l'aurais pas fait sans ses capacités musicales. C'est un très bon chanteur et un vrai musicien, encore plus que je ne le croyais. La prochaine fois que vous le rencontrez, demandez-lui d'expliquer les rythmes tunisiens, oranais, algérois, égyptiens, ceux des Emirats... Il va faire ça sur la table. En plus, le fait d'écrire ce texte et que Khaled le chante pour les beurettes françaises, je trouvais cela très attirant.
Jean-Luc Cambier : Il y a sur son album une autre chanson, "Le jour viendra", qu'il vous a demandée sur l'Algérie.
Jean-Jacques Goldman: Oui, sur la réconciliation. Elle dit qu'il y a toujours un moment où la nuit et le jour se rencontrent. Tous les animaux vont boire a la même eau. Peut-être un jour viendra où le peuple algérien lui-même sera apaisé.
Jean-Luc Cambier : Réalistiquement, qu'est-ce qu'on peut faire à part trouver cela terrible et se sentir coupable de cette impuissance ?
Jean-Jacques Goldman : Je n'ai jamais eu l'impression d'être suffisamment important pour me sentir coupable. Je n'ai pas le pouvoir de changer la vie des gens. Si on peut travailler pour l'Algérie, il faut le faire mais on ne va pas écrire l'histoire a leur place. On peut être solidaire mais pas se substituer à eux. Est-ce qu'un pays qui a obtenu l'indépendance, ce qui est tout a fait légitime, peut faire l'économie de l'expérience de l'horreur ? Est-ce que ce n'est pas sur ces cendres-là qu'on construit une société paisible ? Je me rappelle avoir discuté avec un ancien ambassadeur du Cambodge. Je lui ai demandé si ce qui s'est passé au Cambodge, soit la moitié de la population qui a tué l'autre moitié, si cet incroyable autogénocide était prévisible. Il a répondu : Non, puisque c'était le peuple le plus doux de la terre et oui parce que c'était le peuple le plus doux de la terre. Il nous a peut-être fallu deux mille ans de guerres pour comprendre vraiment ce que c'était.
Jean-Luc Cambier : Vous n'avez jamais eu l'envie d'être journaliste ?
Jean-Jacques Goldman : Mais j'ai l'impression d'être un peu journaliste. Je me retrouve beaucoup dans cette phrase d'Albert Londres qui disait: Nous sommes des flâneurs professionnels. Ce que j'envie le plus aux journalistes, c'est leur capacité à rencontrer des gens. On pourrait penser ce genre de rencontre artificielle, moi je le trouve assez naturel, pas forcé. Si je veux rencontrer quelqu'un maintenant, il va trouver ça louche, se demander quel est son intérêt, le mien, etc. J'envie ceux qui, tous les jours, en radio, pour des journaux ou la télé, reçoivent leurs contemporains. C'est peut-être un regret dans ma vie mais on ne peut tout avoir. J'ai pensé faire une émission de télé par exemple. Le pire c'est qu'on m'a proposé d'interviewer Mark Knopfler. Mais j'ai peur de ça. C'est peut-être aussi pour cela que ça m'attire.
Jean-Luc Cambier : Récemment encore, vous disiez pourtant n'avoir jamais éprouvé l'envie de rencontrer des hommes que vous admiriez comme Sadate, premier dirigeant arabe à reconnaître l'Etat d'Israël ou Sven Olof Palme, le socialiste visionnaire suédois assassiné en 86 alors qu'il était premier ministre.
Jean-Jacques Goldman : Oui, et c'est une erreur. J'ai enregistré mon premier album au studio Pathé en 1980. Elton John était dans le studio à côté. A cette époque, je connaissais ses trois premiers albums par coeur. Je pouvais les jouer mais j'étais incapable de lui parler. J'avais l'impression de déjà le connaître. J'ai eu tort. J'aurais dû lui dire que je connaissais ses chansons parfaitement parce que, quand on me le dit, je suis touché.
Jean-Luc Cambier : En rapport avec ce goût de l'information et de la réflexion, on peut peut-être évoquer quelques sujets d'actualité. A propos de la Suède justement, les stérilisations forcées ont continué ou, en tout cas, n'ont pas été denoncées sous Palme. Cela vous déçoit ?
Jean-Jacques Goldman : Globalement et évidemment, on va dire que tout se situe entre gris clair et gris foncé. Il n'y a pas de héros irréprochable mais je ne suis pas choqué. Il est très politiquement correct de trouver cela horrible mais on peut aussi admettre que certaines personnes ne sont pas en état d'élever un enfant. Une enquête est en cours. Les chiffres seront plus précis. Il est possible qu'il y ait eu des excès, des erreurs mais la sociale-démocratie suédoise n'est pas le régime nazi avec ses stérilisations planifiées pour que les tziganes, les juifs ou les Noirs ne se reproduisent pas.
Jean-Luc Cambier : Quand Eurodisney a des difficultés, vous y voyez la preuve d'un esprit de résistance. Maintenant que ça marche très bien, vous le prenez comme une capitulation ?
JJG : Non, mais disons que j'aime bien les manifestations du pas politiquement correct que les Français sont seuls à avoir. Par exemple, Michael Jackson arrive avec une statue de dix mètres mais, en France, on décide de ne pas l'ériger parce que c'est impossible. Comme est impossible cette affiche (une publicité pour Céline Dion qui met en avant ses énormes chiffres de ventes). Se vanter ainsi de ce succès, c'est une mort annoncée. Les gens viendraient rapporter leurs disques. Au concert de U2, la semaine dernière, à chaque chanson, le stade explosait. Tout à coup, ils ont commis l'erreur dont, à mon avis, ils ne se relèveront pas, d'avoir passé une photo de la princesse Diana. Il y a eu un quasi-silence dans le stade, choqué par cette démagogie. Toutes ces manifestations-là me rendent amoureux de la France.
Jean-Luc Cambier : Vous êtes vous-même un spécialiste du contre-pied. Pour l'instant, votre préféré semble être la défense du pape.
Jean-Jacques Goldman : Non, pas le pape. Mais je trouve bien qu'un million de gamins se soient déplacés non pour des points Coca-Cola gratuits mais parce qu'ils pensent qu'une vie matérielle c'est très bien, mais qu'il n'y a peut-être pas uniquement cela.
Jean-Luc Cambier : Vous auriez dit qu'on crève de faux-semblants. Je ne vous imaginais pas aussi énervé par la question.
Jean-Jacques Goldman : Oui, cela m'agace, le fait qu'un type dise que mère Teresa est avant tout une vieille reac et que ce soit largement repris. Elle a passé sa vie dans la merde des lépreux et, en France, on va en tirer ce qui est politiquement correct : elle était contre l'avortement. Elle était pour les plannings familiaux mais on ne le dit pas très haut. Voilà, c'est le prêt-à-penser. Il y a un tel poids de politiquement correct que, par exemple, le pape est mauvais parce qu'il ne veut pas qu'on se serve du préservatif. Il faut arrêter cela. Ce pape a fait tomber le Mur. Il a changé l'histoire. Il a permis à des millions de gens d'espérer vivre. C'est cela aussi, pas uniquement une affaire de préservatif. L'histoire de faire mettre des préservatifs aux Africains, c'est du domaine du surréalisme. Il faut y aller quoi, c'est une blague.
Jean-Luc Cambier : Le cinquième élément fut un succès énorme malgré le tir groupé de la critique. Luc Besson et son acteur Bruce Willis en ont profité pour dire qu'elle n'avait plus de raison d'être.
Jean-Jacques Goldman : C'est vrai et c'est simplement le fruit d'une incompétence critique spécifique à la France. Dans certains pays, la critique est suivie parce que, par expérience, le public lui fait confiance. Il n'est pas possible d'aller systématiquement voir des films qui ne te plaisent pas et d'éviter systématiquement ceux qui pourraient te plaire. Pareil pour les disques, la presse est de moins en moins prescriptrice.
Jean-Luc Cambier : Pour résumer le parcours de Michel Field, de la Ligue communiste révolutionnaire au remplacement d'Anne Sinclair à TF1 en passant par le Cercle de minuit et Canal +, le journal "Le Monde" a titré "De Marx à Bouygues". Peut-on être trotskyste à vingt ans et diriger une société de production à 43 ?
Jean-Jacques Goldman : Je ne suis pas persuadé que Michel Field ait renoncé à ses convictions. L'endroit où tu es n'est pas une garantie de la pureté des convictions. On peut être un vrai réactionnaire en étant syndicaliste ou au parti communiste. On a pu être une véritable ordure en étant proche de la gauche. François Mitterrand a ordonné les écoutes. Il ne suffit pas de se proclamer de gauche pour l'être, de se proclamer moral pour l'être. Être à TF1 ne te transforme pas en ordure, de la même façon qu'être sur Canal + ne fait pas de toi quelqu'un d'absolument magnifique.
Jean-Luc Cambier : En Belgique, on ne peut pas ne pas évoquer l'affaire Dutroux. Vous l'avez suivie ?
Jean-Jacques Goldman : Bien sûr, et avec le regard d'un père. Qu'en 1996, on puisse enlever une petite fille, la mettre dans une cachette et la laisser mourir de faim, au vu et au su de tout le monde, sans que la police n'intervienne, ça paraît incroyable. On a l'impression que ça ne peut arriver qu'à une Sri-Lankaise. Ça me fait penser que bien des choses nous semblent acquises sur le plan de la morale, de la civilité, de la vie sociale. Mais le sauvage est encore là sous un très mince vernis. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'on a tendance à l'oublier.
Jean-Luc Cambier : Un an après la Marche Blanche, on constate que la nouvelle morale politique promise reste une affaire de mots. La politisation outrancière des nominations et le clientélisme restent la règle, comme si notre système démocratique finalement assez paresseux conférait une marge d'impunité au pouvoir en place.
Jean-Jacques Goldman : Autrement dit, on ne sait plus trop si la démocratie joue encore un rôle. C'est une vraie question. On pourrait aussi parler des Etats-Unis où moins de la moitié des électeurs votent. Mais pour l'affaire Dutroux, je n'ai pas l'impression que cela peut en rester là. Après l'histoire du sang contaminé en France, les gens savent maintenant qu'une telle chose est possible. Aujourd'hui, il y a un problème de normes de stérilisation pour un hôpital et ça sort automatiquement et très violemment. Ça ne peut plus être caché. Avant, on n'imaginait pas que cela soit possible. C'était des problèmes de gros sous. Maintenant, les gens savent qu'ils peuvent aller en prison. Un policier qui reçoit une information, il ne peut plus ne rien en faire.
Jean-Luc Cambier : Dernière question plus légère. On dit que le sport révèle la personnalité profonde. Comment jouez-vous au tennis ?
Jean-Jacques Goldman : Je suis extrêment maladroit... mais courageux. Je ne suis pas un attaquant parce que je suis trop lent et trop maladroit à la volée. Je suis un teigneux de fonds de cours.
Jean-Luc Cambier : Comme Francis Cabrel ?
Jean-Jacques Goldman : Effectivement. On a joué ensemble. Globalement, je le battais mais c'était toujours très serré, genre un set partout. Mais la dernière fois qu'on a joué, il y a longtemps, il m'a mis 6-0 !
Retour au sommaire - Retour à l'année 1997