
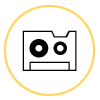
|
Confessions d'un flâneur solitaire
|
Confessions d'un flâneur solitaire
Télérama, 22 Octobre 1997
Anne-Marie Paquotte et Philippe Barbot.
Il trimballe l'image d'un gentil chanteur à tubes. Mais qui est vraiment JJG ? Rencontre à l'occasion de la sortie de son nouveau CD.
Le maestro du mystère. Voilà 15 ans que JJG truste les hits-parades avec une tranquille régularité qui n'a d'égal que le soin qu'il met à éviter les médias. A la fois omniprésent et invisible, en solo, duo ou trio, en blues ou en ballades, l'homme dont les droits d'auteur à la Sacem ont dépassé les scores du Boléro de Ravel a essuyé toutes les critiques avec une impassibilité confondante. Crooner boy-scout et gnangnan pour les uns, étalon de la variétoche raplapla pour les autres, notre national JJ est surtout l'un des plus fiables fabricants de chansons en activité. L'ancien vendeur d'articles de sport dans le magasin familial, le guitariste de Taï Phong - groupe de pop progressive des années 70 - semble s'être lancé à reculons dans la carrière de chanteur à succès. Pudique jusqu'à la banalité, il n'a cessé de revendiquer, depuis, un statut de citoyen ordinaire. Issu de la génération de Mai 68, il préfère militer en douceur. Et s'il fustige le racisme ou l'exclusion, c'est avec les mots en demi-teintes et les musiques un tantinet ronronnantes qui ont fait sa griffe. D'où méprise: et si JJ, le gentil vocaliste, était en fait un doucereux subversif ? A l'occasion de la sortie de son nouvel album, un exercice solitaire intitulé En passant, il a accepté de nous recevoir. A condition qu'il puisse relire ses propos, et que Télérama ne lui consacre pas sa couverture. Histoire, une nouvelle fois, de rester dans l'ombre à visage découvert.
Télérama: C'est votre premier album solo depuis 10 ans. La fin d'un cycle ? Jean-Jacques Goldman: Ce sont les chansons qui commandent. Après mon album "Entre gris clair et gris fonçé", je me suis mis à composer pour un duo ou un trio. Nous avons donc institutionnalisé l'équipe qui existait déjà sur scène depuis plusieurs années : c'est devenu Fredericks - Goldman - Jones. J'aimais cette idée de chanter à plusieurs. Finalement, c'était plutôt mon parcours solitaire, de 1980 à 1987, qui était un peu atypique. Avant, j'avais vécu quinze années d'apprentissage dans des groupes. Taï Phong, mais aussi les Gospellers, Phalanstère, des orchestres de lycée... Pour ce nouvel album me sont venues des chansons plus personnelles. Je les interprête donc seul.
Télérama : Ca vous vexerait si on vous disait que certaines chansons font parfois penser à Cabrel ? Jean-Jacques Goldman : On m'a cité aussi Springsteen ! Mais il faut remonter aux sources. On ne peut pas écouter Springsteen sans penser à Dylan. Dylan, c'est notre cousin commun, à Cabrel et moi...
Télérama : Dylan plus que Brassens ? Jean-Jacques Goldman : Je suis plus de l'école Dylan, cette forme d'écriture où les mots sont asservis aux sons. Je crois que Brassens aurait pu écrire ses textes de façon indépendante de la musique. Pour nous, les mots font partie de la musique ; la mélodie impose des sons de façon très précise. Je travaille beaucoup, je rature, je retouche, mais je n'écris jamais sans avoir à ma disposition trois ou quatre pages de notes sur le thème que je veux aborder. Je ne me mets jamais dans la position du type qui angoisse devant la page blanche.
Télérama : On peut s'étonner du contraste entre vos textes, plutôt inquiets, et vos musiques, plutôt lénifiantes. Comme si vous donniez à la fois le mal et le remède qui va avec. C'est de l'homéopathie musicale ? Jean-Jacques Goldman : C'est possible... J'ai peut-être une vision extrêmement conventionnelle de la musique. Je ne suis pas du tout un aventurier sur ce plan-là. Mais ce n'est pas mon but non plus d'alarmer les gens. Disons que si je parle de choses qui m'inquiètent, la musique, elle, est faite pour me rassurer.
Télérama : D'où vient votre culture musicale ? Jean-Jacques Goldman : Ce qu'on écoutait chez moi allait des Compagnons de la chanson aux chants scouts, en passant par les choeurs de l'Armée rouge, puisque mon père et ma mère étaient nés à l'est. Ensuite, on m'a mis à la musique classique: j'ai fait du violon pendant une dizaine d'années. Ma première découverte vraiment personnelle, ça a été dans les surprises-parties des années 63-64: tous ces disques de rythm'n'blues sous le label Formidable, où cohabitaient des artistes comme Aretha Franklin, Otis Redding, Sam and Dave, Wilson Pickett, Solomon Burke... Ça et le blues. Puis Bob Dylan, qui est arrivé après.
Télérama : Vous avez décidé très tôt d'être musicien ? Jean-Jacques Goldman : J'ai toujours su que la musique était une chose absolument déterminante de mon existence. Mais je n'ai jamais pensé en vivre, pouvoir en faire un métier. J'avais juste l'idée d'écrire des chansons pour les autres. Même avec Taï Phong, mon premier groupe professionnel, je ne faisais des concerts que le week-end, je n'enregistrais que pendant mes vacances. Quand ils ont décidé de partir en tournée, je les ai quittés. Michael Jones est venu me remplacer.
Télérama : Vous vous êtes toujours situé dans le camp du rock ? Jean-Jacques Goldman : Ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que Jean-Louis Murat est du côté du rock, pas les Forbans. Mais si on pouvait le faire écouter à Eddie Cochran, je ne suis pas sûr qu'il y comprendrait quelque chose... Si vous parlez du rock au sens d'attitude culturelle, je me sens très peu concerné par cet univers-là.
Télérama : Vous semblez quand même être resté fidèle à la musique des années 60-70. Pourtant, il s'en est passé des choses, depuis : le rap, la techno, les musiques électroniques... Jean-Jacques Goldman : C'est vrai, je reste attaché aux sonorités de ces années-là, aux guitares acoustiques, par exemple. L'électronique, même si je m'en sers un peu, ne m'est pas naturelle. Ce n'est pas ma culture, ma formation, mon monde. Faire un album entièrement électronique, ce serait une attitude, une façon pathétique de vouloir faire jeune à tout prix. Quant au rap, à la maison, je n'entends que ça !
Télérama : Que pensez-vous de votre voix ? Jean-Jacques Goldman : Je trouve que je ne suis pas un mauvais chanteur, mais je sais que je ne suis pas un grand chanteur. Je travaille peu ma voix, enfin, pas assez. Même s'il en existe de nettement plus puissants, plus techniques, plus intéressants que moi, je pense être un assez bon interprête pour mes chansons. J'ai pris des cours de chant après deux cents ou trois cents concerts, parce que ma voix a lâché un jour, sur scène, à Bordeaux. Je suis allé voir un ORL qui m'a dit que je n'avais rien de grave mais qu'il serait assez judicieux de prendre des leçons. Après quelques millions de disques, c'était un peu vexant !
Télérama : Pourquoi la poussez-vous si haut, votre voix ? On a l'impression que vous êtes parfois à la limite de ce qui est... Jean-Jacques Goldman : ...supportable ? Télérama : Disons chantable dans le registre qui est le vôtre. Jean-Jacques Goldman : Je crois que c'est un cheminement naturel. Quand j'ai enregistré mon 1er album, je sortais de 15 ans de chant en anglais. L'anglais se chante plus haut que le français - ça doit venir des sonorités. Prenez Céline Dion, qui utilise les 2 langues : il y a à peu près un ton et demi de différence entre ses chansons en anglais et celles en français. Au fil de mes albums, j'ai essayé de corriger ça. Il me semble que c'est beaucoup moins hurlé, maintenant... Aujourd'hui, il m'arrive même de baisser de trois tons certaines chansons, sur scène.
Télérama : Depuis quelques années, vous semblez être devenu une sorte de mercenaire de la rime. Outre vos propres disques, vous avez travaillé pour Khaled, Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Kaas... Etes-vous un boulimique de travail ? Jean-Jacques Goldman : On ne va pas faire des comptes d'apothicaire, mais si vous additionnez les chansons que j'ai écrites pour d'autres, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. On doit arriver à 16 ou 17 titres, plus onze pour moi, ça fait une trentaine en quatre ans. Pas vraiment des cadences infernales... Je ne stocke pas des chansons en me demandant à qui je pourrais bien les caser. Khaled, par exemple, je l'ai rencontré à l'occasion d'une émission de télé, on est allé manger un couscous ensemble, il m'a dit : "J'aimerais que tu me fasses des chansons." A partir de ce moment-là, je me suis mis à composer. Je n'avais pas un truc qui s'appelait "Hélène" et que j'aurais rebaptisé "Aïcha" pour lui...
Télérama : Avec le temps, vous n'avez pas le sentiment d'appliquer une recette, jusqu'à vous autoplagier parfois ? Jean-Jacques Goldman : Dès la fin de mon deuxième album, je disais qu'à mon avis, en deux disques, un artiste avait tout dit. Trouvez-moi un contre-exemple. Prenez les quelques albums qui sont sortis récemment : Lavilliers, Nougaro, Mc Cartney, Oasis, Dylan même. Et dites-moi si le mien se répète notablement plus que les leurs. Plus que de recette musicale, je crois qu'il faut parler de limites harmoniques. Et l'une des seules façons de se renouveler, c'est le texte.
Télérama : Vous vous considérez davantage comme un auteur ou un compositeur ? Jean-Jacques Goldman : Il y a un terme anglo-saxon que j'aime bien: songmaker. Un "faiseur de chansons", voilà ce que je suis.
Télérama : Vous participez volontiers à des manifestations humanitaires pour Amnesty International ou les Restos du Coeur. Pensez-vous que c'est le devoir d'un artiste de s'exprimer sur de tels problèmes ? Jean-Jacques Goldman : Chacun fait comme il le sent. Je pense que ce sont les gens qui nous choisissent. Bob Dylan est devenu le fédérateur d'une génération parce que celle-ci se reconnaissait en lui, quand il chantait "Les temps changent". Au même moment, il y avait peut-être des chanteurs qui disaient : "Revenons au passé, aux valeurs de nos parents, tuons tous les viêt-congs", mais ils n'ont pas été choisis par la jeunesse.
Télérama : Qu'est-ce qui vous révolte ? Jean-Jacques Goldman : Toujours les mêmes choses. Les abus de pouvoir, surtout lorsqu'ils viennent d'endroits où on ne les attendait pas. Par exemple, des écoutes téléphoniques sous un gouvernement de gauche ou de la diffamation dans des journaux moralisateurs.
Télérama : Vous avez une image de chanteur gentil à la limite du scoutisme. Elle vous correspond ? Jean-Jacques Goldman : Je pense être assez costaud pour pouvoir défendre cette gentillesse-là, cette mièvrerie, même. Je suis peut-être gentil, mais nullement victime, pas du tout fragile. Quand j'étais scout - je l'ai été pendant 10 ans - mon totem était un caffra, un chat sauvage, "arrogant et décidé"...
Télérama : A une époque, vous avez été critiqué assez rudement par certains médias. Cela explique-t-il votre méfiance à l'égard de la presse ? Jean-Jacques Goldman : Je crois que c'était un accès extrêmement banal de racisme ordinaire. On condamne sur des apparences : un type mignon, avec des cheveux longs et une voix aiguë, qui plait visiblement aux jeunes filles. Aujourd'hui, imaginez qu'un boy's band enregistre une bonne chanson sur son album, personne n'ira la déceler. Ce serait même politiquement incorrect de le dire.
Télérama : Vous avez été blessé ? Jean-Jacques Goldman : Ce qui m'a blessé, c'est qu'on s'attachait à la forme. Aux apparences, au mépris du fond. Avec le recul, je trouve qu'il y avait d'assez bonnes chansons dans ces albums. Mais j'ai toujours été assez prétentieux là-dessus. Je n'ai jamais eu de complexe culturel, dans le sens où je savais avoir fait plus d'études que la plupart des gens qui me critiquaient. Pas de complexe musical non plus, car je crois savoir ce qu'est la musique et, une guitare à la main, je n'ai pas peur de grand-chose. Enfin, pas de complexe d'origine, genre complexe du petit-bourgeois, puisque je viens d'un milieu d'immigrés. Non, je savais que c'était juste des manifestations banales de bêtise et d'incompétence. Tant pis !
Télérama : Est-ce que, finalement, vous ne vous voyez pas comme une sorte de chroniqueur des bleus de l'âme, de reporter musical sur le front des sentiments ? Jean-Jacques Goldman : Albert Londres, c'est quelqu'un de votre profession il me semble, disait : "Nous sommes des flâneurs professionnels." Eh bien, les chanteurs aussi.
Retour au sommaire - Retour à l'année 1997