
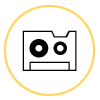
|
Rencontre avec Jean Mareska
|
Rencontre avec Jean Mareska
Issy-les-Moulineaux, 20 juillet 2001
Propos recueillis et retranscrits par Ludovic Lorenzi en exclusivité pour "Parler d'sa vie"
Ludovic Lorenzi : Grâce à une interview de Platine, on connaît votre carrière jusqu'en 1994. Donc, 1975 : WEA. 1980 : Barclay. 1984 : Flarenach. 1988 : Pianola. 1990 : Arcade. 1994 : Sony… Vous me corrigez s'il y a des erreurs.
Jean Mareska : Tout est faux.
Ludovic Lorenzi : Tout est faux ?
Jean Mareska : Barclay : 69-70. WEA : 71-80. Ensuite, j'ai été indépendant de 80 à 84. Ensuite, Flarenach, ensuite, Pianola, ensuite, Arcade et ensuite Sony. Voilà, les tous débuts, c'est pas…
Ludovic Lorenzi : Et, que s'est-il passé depuis 1994 ? Qu'avez-vous fait ?
Jean Mareska : Depuis 94 ? En ce qui concerne Taï Phong ou moi-même ?
Ludovic Lorenzi : En ce qui concerne votre carrière.
Jean Mareska : Je bossais chez Sony. Maintenant, je bosse chez EMI. Je m'occupe du fond de catalogues. Et parallèlement, on a fait l'album avec Taï Phong.
Ludovic Lorenzi : On va revenir au début de Taï Phong. Donc, en 1975, on vous propose de faire le directeur artistique.
Jean Mareska : Je souhaitais, moi, faire de la direction artistique et comme j'étais journaliste, en plus, dans Best, à l'époque et à Extra, et plus tard, à Pop Music, j'étais assez pote avec tous les groupes de l'époque, les Martin Circus, les Triangles, les Variations et tout ça… Et je voulais mettre la main à la pate parce que j'étais, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui chef de produit chez Warner. Je pensais que je n'avais pas vraiment grand mérite à faire un disque d'or avec Led Zeppelin au bout d'un mois, alors qu'ils étaient disque d'or aux USA ou en Angleterre le jour de la sortie du disque. Je connaissais un peu les groupes, j'étais allé traîner dans les studios et j'avais fait part de mon désir d'aller vers l'artistique au patron de Warner. Et l'arrivée de Taï Phong a fait que, d'un seul coup, comme j'étais dans la période Yes, Genesis et tout ça… ils m'ont dit « Tu veux toujours faire de la direction artistique ? ». J'ai dit « Plus que jamais ». Ils m'ont dit « Voilà, il y a un projet pour toi, si tu veux, tu fonces ». Et donc, j'ai changé ma casquette de chef de produit, qui s'appelait label manager, à l'époque, pour une casquette de directeur artistique.
Ludovic Lorenzi : Vous avez rencontré le groupe en écoutant une bande. Est-ce que vous avez…
Jean Mareska : C'était plus qu'une bande. On a écouté une gravure, parce que Khanh travaillait, à l'époque, au studio de gravure de chez, anciennement, Polygram, Philips, même… Ce qui prouvait déjà leur haut degré de technique et d'approche technique de leur musique, c'est qu'ils ne se contentaient pas de faire écouter leurs maquettes sur une petite bande de quart de pouce et que le produit était déjà gravé. Aujourd'hui, on dirait masterisé.
Ludovic Lorenzi : Et, donc, vous avez flashé tout de suite.
Jean Mareska : Voilà.
Ludovic Lorenzi : Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le travail d'un directeur artistique ?
Jean Mareska : Disons que là, je n'ai pas fait un réel travail. J'ai appris le métier de directeur artistique, en fin de compte, avec eux. Le métier de directeur artistique, comme son nom l'indique, pour moi du moins, c'est beaucoup de ce qui se passe en amont. Avant d'entrer en studio, c'est la direction qu'on va donner. C'est à travers un échantillonnage de chansons quel public on va essayer de toucher et comment on va essayer de le toucher. Là, le boulot était déjà fait, les chansons étaient faites. Je n'ai même pas eu à faire le choix parce qu'ils sont arrivés avec l'album. L'album était, au niveau des maquettes, entièrement fini. C'était comme ça, il y avait sept ou huit chansons, je ne sais plus exactement. Et sur le papier, à coté de ça, il y avait tout ce qui allait être le devenir du disque une fois que l'on serait passé en studio d'enregistrement professionnel. Donc, je n'ai pas eu une vraie direction artistique. La direction artistique en amont, elle était déjà faite : le groupe existait, le nom du groupe, le choix des titres, la manière d'enregistrer, comment ils voulaient le faire… Tout ça était fait. Mais eux, comme ils étaient aussi des musiciens assez aboutis, déjà, dès qu'il y en avait un qui chantait faux ou une note qui ne sonnait pas juste… avant que j'appuie sur le bouton pour dire « Je crois qu'il y a un problème », il y en avait déjà un qui avait… Eux-mêmes entendaient et corrigeaient. C'était déjà des musiciens très affirmés.
Ludovic Lorenzi : Donc, vous, vous aviez essentiellement un rôle d'organisation.
Jean Mareska : J'ai eu un rôle d'organisation. J'ai eu aussi un rôle de conseils quand même. J'ai aussi, vraisemblablement, un peu ajouté mon grain là-dedans. Mais, ce n'était pas de ma part un vrai travail de création artistique, si vous voulez. Il faut que ce soit clair là- dessus.
Ludovic Lorenzi : En ce qui concerne la promotion du groupe, qui faisait les démarches ? C'était vous ou Dominique Lamblin ?
Jean Mareska : Ce n'était ni moi ni Dominique Lamblin. Dominique Lamblin était le patron de l'international à l'époque. Donc, c'est vrai que c'est lui et Bernard de Bosson, qui était le grand patron de WEA, qui m'ont fait écouter la maquette un soir dans le bureau de Bernard. On a une équipe promo qui, elle, faisait la promo. Mais, ce n'était ni moi, ni Dominique.
Ludovic Lorenzi : Parce qu'en fait, le problème, ce qui s'est passé par la suite après « Sister Jane », après le premier album, c'est qu'il y a eu des problèmes de promotion puisqu'ils n'ont plus fait de télévision… Alors, que s'est-il passé exactement ?
Jean Mareska : Le problème est que ça n'a jamais été un groupe très visuellement attractif. En plus, Jean-Jacques, ça le faisait chier de faire de la scène… Et même de faire des télés, ça ne les amusait pas beaucoup. Ils n'étaient pas très - par rapport aux groupes de l'époque, où il se passait quand même pas mal de choses visuellement parlant - par exemple, un groupe comme les Martin Circus ou des gens comme ça, où il y avait une vraie création en scène… Il y avait cinq mecs qui jouaient leurs chansons comme ça, très concentrés. Ça pouvait paraître un peu… pas sinistre, mais enfin, ce n'était pas très très gai. Donc, c'est vrai que télégéniquement parlant, ça n'offrait pas un grand intérêt d'avoir cinq mecs immobiles en train de débiter des chansons comme ça. Ludovic Lorenzi : D'accord, le groupe n'était peut-être pas télégénique mais « Sister Jane » s'est quand même vendu à 200 000 exemplaires. Est-ce que c'était forcément un problème d'image à ce niveau-là ?
Jean Mareska : Non. On a eu beaucoup de chance aussi. « Sister Jane » est sorti le même été que « I'm not in love » de Ten CC et « L'été indien » de Joe Dassin. Le DJ - parce qu'à l'époque, en discothèque on passait encore des slows - le DJ, il avait sa série de trois slows à enchaîner toute trouvée. On s'est trouvé bénéficier de ce concours de circonstances. C'est vrai que la chanson était bien aussi, il ne faut pas minimiser. Le disque s'est vendu et puis, c'est un nouveau groupe qui émergeait, il n'y avait pas de groupe de ce calibre-là en France, qui pratiquait ce type de musique, à un niveau professionnel comme eux le faisaient… Non, ça avait largement sa place dans le paysage.
Ludovic Lorenzi : En ce qui concerne le deuxième single « North for winter », il y a eu une seule télé pour la promo et, par la suite, plus de promo. Alors, que s'est-il passé exactement ? Ils n'ont plus voulu en faire ou plus personne n'a voulu leur faire faire de promotion ?
Jean Mareska : Le problème, c'est que « North for winter » a moins bien fonctionné que « Sister Jane », peut-être parce que la chanson était moins catchy. Le problème, c'était aussi que « Sister Jane » était chantée par Jean-Jacques, « North for winter » était chantée par Taï, donc, il y avait une confusion sur le plan visuel. Les gens aiment bien se raccrocher à un chanteur, savoir qui est le Mick Jagger de l'affaire et qui est le Keith Richard de l'affaire. D'un seul coup, il y avait un peu une déstabilisation. C'est un groupe qui n'avait pas une image très très précise à part qu'il y avait deux frères vietnamiens là-dedans. Point. Il y a un petit mec mignon qui chantait bien et qui jouait de la guitare. C'était un peu mince quand même. Les groupes des années 70 avaient une identité visuelle plus forte que ça. Mais ce n'était pas leur propos non plus. Ils n'entendaient pas du tout être des stars de la scène ou quoi que ce soit. Ils voulaient être reconnus avant tout en tant que musiciens, que créateurs et pas être des vedettes.
Ludovic Lorenzi : Il y a la télé, mais il y a aussi la radio. A l'époque, ça passait quand même beaucoup plus à la radio, donc est-ce que ça n'aurait pas pu marcher uniquement par le biais de la radio ?
Jean Mareska : Il faut croire que non. Dans l'ordre, généralement, proportionnellement, ce sont les radios qui déclenchent un tube, encore plus à cette époque là, et les télés qui suivent. Et comme les radios ont moins bien accroché sur « North for winter » que sur « Sister Jane », il n'y a pas eu de télé ou très peu de télé derrière.
Ludovic Lorenzi : Après, il y a eu le troisième single, « Games ». C'était quand même une belle chanson qui aurait pu marcher, un peu dans la lignée de « Sister Jane ». Alors, toujours pas de réponse ? Est-ce que les radios ne se sont pas précipitées dessus ?
Jean Mareska : Non. Je crois que « Sister Jane » était une chanson vraiment calibrée pour être un vrai tube et que, interprétée par quelqu'un d'autre, ça aurait fait aussi un tube. Et je pense que les médias, les radios surtout, attendaient de Taï Phong qu'ils renouvellent - à travers des chansons hyper calibrées, volontairement ou involontairement - que Taï Phong renouvelle à chaque fois le coup de « Sister Jane » - enfin, je dis le coup, ce n'était pas un coup - refassent à chaque fois du, des « Sister Jane » bis. Ce qui n'était pas le cas pour ces autres chansons-là qui étaient plus des morceaux de musiciens que des chansons à destination grand public.
Ludovic Lorenzi : Pour « Games », cela aurait pu être le cas, c'est un peu dans la lignée de…
Jean Mareska : Oui, mais bon… Ça ne s'est pas fait.
Ludovic Lorenzi : Ensuite, il y a eu le deuxième album « Windows », qui n'a pas du tout marché, qui pourtant est plus…
Jean Mareska : Oh, si. Il a pas mal fonctionné « Windows ». Je n'ai plus les chiffres de vente en tête mais ça a pas mal fonctionné, « Windows ». Allez, ça a dû faire 25 ou 30 000 albums, ce qui est honorable.
Ludovic Lorenzi : Après « Windows », il a commencé à y avoir quelques problèmes. Et on se rend compte que les disques de Taï Phong, par la suite, après « Windows », sont essentiellement des singles. Il y a eu « Follow me », tentative d'adaptation au disco, « Back again » et « Fed up ». Il y a deux titres disco sur les trois, c'est quand même bien une preuve que le groupe faisait des efforts pour évoluer, pour s'adapter et pour vendre. Pourquoi ne les a-t-on pas plus aidés pour la promotion ?
Jean Mareska : Parce que ce n'était pas leur musique. Parce qu'ils ont effectivement essayé de mettre un pied dans la musique disco mais ce n'était pas leur truc, donc ce n'était pas bien. Ça ne pouvait pas lutter avec les tubes disco de l'époque, ce n'était pas leur truc, ce n'était pas leur musique. Disons qu'on n'avait pas réussi à installer suffisamment cette image de groupe progressiste - de groupe qui faisait de la musique progressive - pour qu'ils arrivent à entretenir cela auprès d'un public suffisamment nombreux. Et puis, comme je vous le disais, il y a eu des dissensions qui se sont installées dans le groupe, assez rapidement. Je ne me souviens plus de la date de sortie du premier single de Jean-Jacques mais ça doit être pendant « Windows » ou juste après. Le groupe est moins devenu un groupe mais plus des entités, cinq individus. Stéphan voulait chanter, les autres ne voulaient pas qu'il chante… Quand on n'a pas le temps de se réunir pour écrire quinze chansons pour en prendre les dix meilleures pour en faire un album, on fait un single. Il y avait bien entre Khanh, Taï et Jean-Jacques qui étaient les principaux compositeurs du groupe, il y en avait bien deux des trois qui avaient une chanson qui disait « Bon, ben, on va faire un single ».
Ludovic Lorenzi : Et si on regarde ces trois singles, les faces A sont quand même signées Jean-Jacques Goldman donc, il s'était quand même pas mal imposé par la suite malgré ses disques en français.
Jean Mareska : Parce qu'il écrivait des chansons qui nous semblaient, à ce moment-là, au moment où on décidait de faire quelque chose, les plus fortes, les plus efficaces. Ce qui n'arrangeait pas l'ambiance générale parce que les frères Ho-Tong, qui étaient des garçons charmants, entendaient mal voir la main mise qu'ils avaient sur le groupe commencer à barrer un petit peu.
Ludovic Lorenzi : Je vois, par exemple, une chanson comme « Cherry », qui aurait pu faire l'objet d'une face A, est sur une face B. Pourquoi a-t-on mis « Back again » (sur la première face) et choisi « Cherry » sur la face B ?
Jean Mareska : Alors ça, je n'en sais rien. Je serais incapable de vous dire pourquoi.
Ludovic Lorenzi : Par rapport à l'album « Last flight », est-ce que vous étiez convaincu qu'un troisième album aurait pu faire redémarrer le groupe ou vous pensiez que ça ne servait à rien d'enregistrer ce troisième album ?
Jean Mareska : Alors, « Last flight »… et ça va corroborer ce que je vous disais à propos des ventes de « Windows »… « Last flight » est un disque qu'on a enregistré à la demande du commercial de WEA. C'est à dire que les commerciaux de temps en temps demandent « Y'a pas un nouvel album de Taï Phong qui va arriver bientôt ? Parce que, regarde le premier, il a vendu 50, 60, 80 000… Et puis, le deuxième, ça a du vendre 25, 30 000. Ce n'est pas si mal que ça. Pourquoi vous ne faites pas un troisième album ? » Donc, j'ai réuni tout le monde à ce moment- là. Mais entre-temps, Jean-Alain était déjà parti, donc il y avait un autre clavier. Il y a eu cette histoire du fameux concert à Créteil où trois jours avant, Jean-Alain s'est tiré parce qu'il n'en pouvait plus et où il les a plantés… Mais je le comprends… La situation devenait invivable au sein du groupe. Donc, pour faire ce concert à Créteil, comme il n'y avait pas un clavier qui pouvait apprendre en trois jours les quinze morceaux du concert, ils ont pris quatre claviers différents, je crois, et chacun a appris deux ou trois morceaux. Et puis, à la fin, ils ont gardé le meilleur - ce qui leur semblait être le meilleur des quatre claviers - et ils l'ont adjoint au groupe. C'est Pascal Wuthrich qui, à ce moment-là, est arrivé. Donc, ce dernier album, « Last flight » - c'est moi qui ai trouvé le titre, ça m'amusait beaucoup. Je sentais que c'était l'album de la fin - a été fait vraiment de bric et de broc - non, pas de bric et de broc - il a été fait dans de bonnes conditions techniques, puisqu'on l'a enregistré à Gang. Mais chacun venait faire sa chanson. Stéphan a profité un peu du flou pour pouvoir enfin chanter, placer une composition à lui. Michael est arrivé lui aussi avec des compos. Chaque musicien venait pour ses titres à lui, faisait venir celui du groupe dont il avait besoin pour un solo de guitare, pour ceci, pour cela… Je ne pense pas que dans « Last flight », les cinq membres du groupe se soient retrouvés une seule fois ensemble en studio. Jamais… Et il s'est passé un truc extrêmement prémonitoire. Michael chantait… je ne sais plus quel titre il chante sur « Last flight ».
Ludovic Lorenzi : « How do you do » et « Thirteenth space ».
Jean Mareska : Michael chantait. Jean-Jacques était à côté de moi dans la cabine et Jean-Jacques m'a dit, « Putain, qu'est ce qu'il chante bien ce mec-là, j'aimerais bien faire un truc avec lui un jour ». C'est la vérité vraie. Il m'a dit ça, c'était… Je ne sais plus la date d'enregistrement de « Last flight », ça doit être 1979, quelque chose comme ça…
Ludovic Lorenzi : 1979.
Jean Mareska : 1979, voilà. Jean-Jacques m'a dit « Qu'est ce qu'il chante bien ce mec, j'aimerais bien faire un truc avec lui un de ces jours ». Quelques années après, on sait ce que ça a donné. Ça a donné, si je ne me trompe, le seul single de Jean-Jacques Goldman qui est arrivé numéro un au Top 50. C'est le seul.
Ludovic Lorenzi : Il a été beaucoup de fois numéro 2 mais pas énormément numéro un. Sinon, la séparation du groupe, vous l'avez vécu comment ?
Jean Mareska : Pour moi, d'abord, elle était inéluctable. Je dois le dire, j'avais beaucoup plus d'intérêt pour ce que faisait Jean-Jacques même si les singles qu'on faisait se vautraient à chaque fois. J'avais d'autres projets aussi sur lesquels je travaillais qui m'étaient arrivés… Donc, je ne peux pas dire que je l'aie mal vécu. C'est parti un peu comme ça en eau de boudin, comme on dit. Il n'y a pas eu une vraie séparation. Il ne se sont pas réunis un jour en se disant « Bon, ça y est, on arrête tout. On fait le dernier concert ou on boit le dernier coup ensemble… ». Ça s'est fait comme ça. Jean-Alain était parti vivre à Limoges. Khanh s'occupait de son magasin de disques, ce qui lui prenait beaucoup de temps, ce qui est normal. Jean-Jacques était déjà dans ses compos en français. Taï avait quitté le groupe. Michael cachetonnait dans les bals à droite à gauche… Il n'y avait plus de groupe. Ça s'est liquéfié comme ça.
Ludovic Lorenzi : En ce qui concerne les 45 tours de Jean-Jacques, on va revenir là-dessus. Comment lui est-il venu l'idée de faire un 45 tours en français ? Il chantait en anglais dans Taï Phong, est-ce qu'il avait déjà envie de faire de la variété ?
Jean Mareska : Oui, oui. Je pense que c'est à l'époque de « Windows ». On était très proches à l'époque et on allait bouffer les uns chez les autres, il venait à la maison, j'allais chez lui ; j'ai vu grandir ses enfants, et il a vu grandir les miens par la même occasion. J'ai même une photo de mon fils aîné, qui a 28 ans aujourd'hui, qui devait en avoir quatre ou cinq à l'époque, accoudé sur un piano Fender sur lequel il y a Jean-Jacques en train de jouer. Alors, il garde la photo précieusement, bien sûr. Et Jean-Jacques m'a dit « Je veux faire des trucs en français ». L'influence Berger. On a aménagé le contrat de Taï Phong de façon à ce que la sortie des singles de Jean-Jacques ne perturbe pas les éventuels futurs enregistrements, les futures sorties de Taï Phong et puis on est entrés en studio avec Jean-Jacques. Et puis, on a fait un premier single, et puis on s'est vautrés, et puis on a recontinué avec Taï Phong derrière, et puis on a fait un deuxième single et on s'est vautrés et puis on a fait un troisième… L'idée était peut-être pour Jean-Jacques d'avoir une espèce de carrière double, à vrai dire, à la Phil Collins, à l'époque où Phil Collins faisait du solo et continuait à jouer avec Genesis. Et puis, bon, les singles en français de Jean-Jacques n'ont pas fonctionné. Et pourtant, il y avait tout dedans, tout ce que j'ai écouté et entendu de lui depuis. Il y avait l'humour, les préoccupations sociales. « C'est pas grave papa », c'est une vraie chanson avec une vraie préoccupation sociale. « Back to the city again », il y avait déjà l'humour de Jean- Jacques là dedans. Il y avait les prémices. C'était pas le moment, peut-être que les chansons étaient pas suffisamment abouties, affirmées. Et puis, peut-être que c'était pas le moment, tout simplement. Et puis, il avait quand même aussi, néanmoins, cette estampille Taï Phong. Il fallait expliquer aux médias, d'un seul coup, pourquoi le chanteur, leader d'un groupe qui chante en anglais et qui fait de la musique progressive se mettait à faire des chansons en français. Donc, ce n'était pas très simple.
Ludovic Lorenzi : Vous aviez dit que la maison de disques en avait pressé 1 000 ou 2 000 exemplaires, ce n'était peut-être pas assez pour faire un succès, sans compter le manque de promotion.
Jean Mareska : Si. Les choses ont relativement peu changé. Aujourd'hui, quand on sort un single d'un artiste, la maison de disques ne se risque pas à en fabriquer 100 000 d'un seul coup, même si elle pense qu'elle va les vendre. Elle commence à en fabriquer 2 000, à faire de la promo. Puis quand la promo commence à démarrer, on essaie d'estimer ce que les retombées promo vont générer en terme de ventes. Mais on ne fabrique jamais 200 000 disques d'un seul coup.
Ludovic Lorenzi : En ce qui concerne l'implication de Jean-Jacques dans ses titres solos, jusqu'où s'impliquait-il ? J'ai lu une interview de lui qui date de décembre 1981, donc, il sortait fraîchement de Taï Phong, il venait de sortir son album. Il n'avait pas encore de succès avec « Il suffira d'un signe », le succès ne viendra qu'en mars 1982. Il disait que pour ses trois singles, il n'avait pas grand chose à faire puisqu'il y avait un arrangeur qui orchestrait la chanson, et lui, il n'avait plus qu'à poser sa voix. Est-ce que c'est vrai ?
Jean Mareska : Oui, c'est vrai. Complètement. Avec Jean-Jacques, on rentrait dans un schéma de variété. Donc, qui dit variété dit généralement arrangeurs, musiciens de studio. Et même s'il était présent, il était là tout au long des enregistrements, ils se voyaient avec l'arrangeur auparavant, ils parlaient un peu de la manière dont les choses allaient être, dont la ou les chansons allaient être arrangées. Et puis au bout d'un moment, on rentrait en studio, il était là, il donnait quelques indications, il amenait quelques corrections pour que ça sonne comme il avait envie que ça sonne. Mais, c'est vrai qu'on n'était plus dans un schéma d'un enregistrement de variété classique plutôt que d'un travail de groupe où les cinq musiciens sont supposés être en studio ensemble, où il y a beaucoup plus d'interactivité entre chacun des musiciens, si vous voulez.
Ludovic Lorenzi : Est-ce qu'il vous avait proposé plus de titres ? Là, ça fait en tout six titres. Est-ce qu'il vous proposait plus de titres et vous faisiez un choix ?
Jean Mareska : Oui, il proposait plus de titres et on faisait un choix comme ça, d'un commun accord, lui et moi.
Ludovic Lorenzi : A côté de ces trois 45 tours en français, il a fait un medley de slows. Ça fait un peu bizarre entre trois singles. Ça ne fait pas un peu une cassure ? Jean Mareska : Non, parce que lui l'a vu comme un coup, complètement. Et c'est « Rockollection » qui lui a filé le déclic. Il est venu me voir un jour en me disant « C'est quand même un peu con, parce qu'avec un saucissonnage d'extraits de titres plus ou moins rock ou pop, Voulzy fait un carton. Si on essayait de faire la même chose avec des slows ? » On s'est rendu compte que la quasi totalité des grands slows qui fonctionnent, ça tourne sur quatre accords, les fameux do, la mineur, fa, sol. Et puis, pareil, on a pris un arrangeur, on a trouvé une idée avec la voix d'une fille qui annonçait un peu - je ne sais pas si vous avez écouté le single. Et puis, on a fait un coup, purement et simplement. Qui a peu vendu et qui a beaucoup tourné en club. Je ne sais plus quelle était la durée de la version longue…
Ludovic Lorenzi : Dix minutes.
Jean Mareska : Dix minutes… Le disc jockey, il mettait le maxi et puis il avait le temps d'aller boire un coup, draguer ou je ne sais quoi… Donc, ça a été un gros succès de discothèque. Ludovic Lorenzi : Et pourquoi avoir mis sur la face B du maxi 45 tours, la version anglaise des « Nuits de solitude » ? Est-ce que c'était pour boucher un trou ?
Jean Mareska : Non, c'est peut-être qu'il avait envie lui d'avoir cette version, que cette version en anglais existe. Voilà, pourquoi pas…
Ludovic Lorenzi : Tous ces 45 tours, on les trouve - peut-être pas le Sweet Memories - mais les trois 45 tours solo sous son nom, on les trouve à 1 500 francs pièce. Est-ce que ça vous surprend ?
Jean Mareska : Ce qui m'a le plus surpris, c'est un jour où je suis allé à la convention du disque où il y avait un coin Goldman et où il y avait scotché au mur les 45 tours japonais de « Sister Jane » qui, eux, valaient 2 500 balles pièce. Si j'avais su, j'en aurais mis quelques uns de côté à l'époque [rires]. Non, ça ne me surprend pas parce qu'un collectionneur, c'est un collectionneur et il est prêt à mettre sa chemise pour avoir la pièce rare qui lui manque. C'est des 45 tours qu'on trouvait il y a vingt ans à dix balles dans les brocantes et qui, aujourd'hui, ont pris de la valeur surtout s'ils ne sont pas abîmés. Il doit me rester un de chaque chez moi, donc, je suis assis sur trois fois 1 500 francs [rires].
Ludovic Lorenzi : C'est vrai que ça varie énormément. Je vois « Follow me » que j'avais retrouvé à dix francs il y a une quinzaine d'années, maintenant c'est 250, 300 francs. Et encore, il est courant celui-là, on le trouve assez facilement. Ça dépend des titres… On en revient au succès de Jean-Jacques Goldman en 1981, vous de votre côté…
Jean Mareska : Il y a eu l'épisode Alpha Ralpha avant, non ?
Ludovic Lorenzi : Oui.
Jean Mareska : Alpha Ralpha, c'est un concept album qui a été crée par deux musiciens qui sont Claude Alvarez-Pereyre et mon frère, Michel Mareska qui fait de la musique aussi. Bien qu'il y avait mille kilomètres qui les séparaient, puisque Claude habitait et habite toujours Paris et mon frère habitait et habite toujours Barcelone, il y a eu des échanges de bandes de maquettes et de choses comme ça jusqu'à un moment où je suis arrivé à une maquette d'album que j'ai fait écouter chez Warner. Ils m'ont dit « Ben, vas-y fonce ». Claude Alvarez jouait les guitares, principalement sur les tires qu'il avait composés. Il jouait du violon. Mon frère a fait toutes les guitares sur les titres qu'il avait composés. On a pris Emmanuel Lacordaire qui était le batteur de Lavilliers, François Bréant qui était le batteur de Lavilliers (NDLL : sur le disque en question, il joue du piano acoustique et du synthé). Un garçon qui s'appelait Charlie Charriras, je ne sais plus d'où il venait, qui rodait aussi dans cette mouvance. Et puis j'ai demandé à Khanh, à Taï de venir faire des chœurs sur des titres, et à Jean-Jacques de venir faire des chœurs sur un autre titre. Ce qui fait que cet album-là, lui, à mon avis, il doit valoir plus cher que 1 500 balles. Pour un vrai collectionneur qui collectionne, qui collecte tout ce qui touche de près ou de loin à Jean-Jacques, ça doit représenter quelque chose. Et ce même jour où j'ai vu les singles de Taï Phong, japonais, à 2 500 balles pièce, à coté de ces singles, il y avait un single, lui aussi scotché au mur, d'un groupe que je produisais à l'époque qui s'appelait Week-end millionnaire. Et je regarde le single, et je me dis « Mais qu'est ce que ça fout là-dedans. Je ne comprend pas, Jean-Jacques n'a jamais fait de chœurs pour Week-end, parce qu'ils se suffisaient largement à eux-mêmes. Je ne comprends pas pourquoi ». Et je demande le prix du disque… Et ça, c'est même plus dix balles mais cinq balles qu'on le trouve encore au jour d'aujourd'hui, peut-être et hélas pour eux, dans les brocantes… Et je dis au garçon qui était là « Mais pourquoi ce single de Week-end vaut 150 francs ? » Il me dit « Michael Jones ». Et je me suis souvenu d'un seul coup qu'effectivement j'utilisais les services de Michael en tant que guitariste sur les enregistrements de ce groupe-là. Du coup, parce que Michael a posé des guitares sur les chansons de ce groupe, ce single vaut 150 balles. Donc, c'est la foi du collectionneur. C'est infiniment respectable.
Ludovic Lorenzi : Et maintenant, les albums de Week-end millionnaire, ils sont introuvables ?
Jean Mareska : Oui, ils sont assez rares mais on en trouve encore. En fin de compte, Week-end, eux, faisaient beaucoup de scène. C'était un trio, ils faisaient beaucoup de scène et ils avaient pour les accompagner Michael, que j'avais donc ramené de Taï Phong, un garçon qui s'appelait Jean-François Gauthier qui a été le batteur de Jean- Jacques pendant des années et, au départ, un Australien qui s'appelait Lance Dixon, qui a disparu après. Donc, la base des premiers groupes de Jean-Jacques était autour de Week-end millionnaire quelques années auparavant.
Ludovic Lorenzi : Là, ça a fait sauter quelques questions, finalement. Je voulais poser la question « Michael a fait partie du groupe, combien de temps est-il resté, pourquoi est-il parti ? »
Jean Mareska : Il n'est pas parti. Il avait d'autres choses à faire, Michael. Il n'était jamais qu'un sixième du groupe qui n'avait plus beaucoup d'activité. Lui tournait beaucoup, il était musicien de bal à l'époque. Il a dû le dire plusieurs fois, donc il avait sa vie à vivre de son côté. Moi, quand j'avais des séances, je le faisais venir à Paris parce que c'était et c'est toujours un excellent guitariste et un superbe chanteur.
Ludovic Lorenzi : Alors, on va en revenir à Jean-Jacques. Vous aviez fait des démarches pour lui, à l'époque où il voulait déjà sortir son premier album, avant d'aller chez Epic.
Jean Mareska : Mais ça, je l'ai déjà raconté dans Platine. Vous êtes en train d'essayer de recouper pour voir si j'ai pas dit de conneries [rires]. Alors, l'histoire. Jean-Jacques a fait les maquettes d'un album, dans lesquelles, je pense qu'il y a neuf des dix titres du premier album. Il y avait donc « Il suffira d'un signe », « Le rapt » et… je ne me souviens plus des titres. Il fait cette maquette et je vais trouver mon directeur de production à l'époque. Donc, j'étais toujours le directeur artistique de Jean-Jacques. J'ai dit « Voilà Goldman. On s'est vautré sur les trois singles ». On arrivait à la fin des années 70, et émergeaient tous ces artistes à albums, la nouvelle chanson française et tout ça… Jean-Jacques me dit « Je veux faire un album aussi, j'ai suffisamment de chansons. Je veux faire un album ». Je vais voir mon directeur de production qui me dit « Non, on fait un single, rien d'autre ». Je reviens vers Jean-Jacques, je lui dis « Il ne veut pas, il ne veut faire qu'un single ». Jean-Jacques dit « Si c'est pour faire un single, je me casse ». Je vais revoir mon directeur de production. Je lui dit « Bon, on va perdre Goldman, ça fait quand même chier. Tu ne veux pas qu'on fasse l'album ? ». « Non, non. Dis lui qu'on fait un single et si le single marche, on fera l'album derrière ». Je vais revoir Jean-Jacques. Je faisais l'aller et retour entre WEA qui était sur les Champs-Elysées et le magasin de sport de Jean-Jacques qui était à Montrouge. Je lui dis « Ben, écoute, non, c'est un single et puis si ça marche, on fait l'album derrière ». Il dit « Je me casse ». Et il a fait une petite lettre qui tient en deux lignes, qui disait grosso modo « Au vu des résultats obtenus sur mes trois précédents singles, je vous demande de me rendre ma liberté ». Ce qu'ils ont fait. Et sans qu'il y ait de relation de cause à effet, j'ai quitté Warner peu de temps après. Et on s'est retrouvés un jour dans un studio qui s'appelait le studio du Chien Jaune, qui à l'époque était vers le boulevard Exelmans. Il y avait Marc Lumbroso, que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas, Jean- Jacques, un garçon qui devait être le patron du studio et moi-même. Je n'étais plus chez WEA, j'étais libre. On a dit « On va faire le tour des maisons de disques de Paris pour essayer de faire signer Jean- Jacques ». Et on s'est fait jeter de partout, partout, partout. Avec des réponses hallucinantes du genre « Ça ressemble trop à Capdevielle… ». Rien, quoi. Ça a failli accrocher ici chez EMI, avec Claude Dejacques, puis ça ne s'est pas fait. Les deux seules personnes qui s'en souviennent, parce que personne ne se souvient de ça, bien sûr, d'avoir laissé passé - les personnes qui sont encore de ce monde, puisque Claude Dejacques est décédé - Les deux seules qui s'en souviennent sont ceux qui m'ont fourni des réponses qui tenaient parfaitement la route pour m'expliquer leur refus. Le premier, c'est Claude Righi, le directeur de la production chez Barclay à l'époque, qui connaissait Jean-Jacques puisqu'il avait fait un séjour d'un an comme patron de la production chez WEA. Quand je suis allé le voir, naturellement, il m'a reçu. On a écouté des chansons. Il m'a dit « Je connais Jean-Jacques, je connais son talent. Malheureusement, je ne peux pas le signer parce qu'on est en train de développer, en ce moment, un jeune chanteur, chez Barclay, qui rentre quand même un peu trop, du moins, au niveau de la voix, dans la même catégorie que ce que fait Jean-Jacques. C'était Balavoine. Et ça, c'était une vraie réponse que je pouvais entendre. Et le deuxième qui m'a fait une réponse négative, quelques année après, c'était Thomas Noton, chez Polydor, qui était un Écossais qui vivait en France depuis des années. Il avait fait partie d'un groupe qui s'appelait les Fantômes dans les années 60. Et Thomas, quelques années après, on en parlait comme ça, m'a dit « Je sais, je regrette », avec son accent qu'il a toujours, « Je ne comprenais pas assez bien le français à l'époque, certainement, pour avoir mesuré l'ampleur, la force des textes ». Ludovic Lorenzi : Vous, vous croyiez, déjà à l'époque, que Jean- Jacques Goldman pouvait avoir du succès ?
Jean Mareska : J'étais loin d'imaginer que ça allait devenir la star - il n'aimerait pas le mot - l'énorme artiste qu'il est devenu. Mais oui, j'étais persuadé que ce garçon avait du talent, et puis c'était un artiste extrêmement facile à vivre, intelligent, pratique, pragmatique, fin, avec de l'humour, très bon musicien… On avait pas mal de goûts communs en matière de musique. Je parlais des Doobie Brothers qui était un de ses groupes préférés… Je pensais vraiment que ce garçon avait du talent, j'aurais bien aimé continuer avec lui.
Ludovic Lorenzi : Donc…
Jean Mareska : Comment, ça s'est rattrapé ? C'est ça la fin de l'histoire ? Comment il a signé chez Epic ? Donc, on a fait le tour des maisons de disques et on s'est fait jeter. Lumbroso, chez les gens qu'ils connaissait et moi, chez les gens que je connaissais. Et on s'est fait jeter de partout et à chaque fois qu'on sortait d'un rendez-vous, c'était « Non » ou « Bon, rappelez la semaine prochaine ». Et puis, la semaine après c'était « Finalement non ». Et il y avait donc les chansons de l'album, les chansons du premier album y étaient. Bricolées dans la cuisine, mais une bonne chanson, c'est un bon texte sur une bonne musique. Jean-Jacques connaissait personnellement un type qui était le patron du marketing chez CBS, à l'époque, qui s'appelle Jean-Jacques Goseland. Un jour, il lui a dit « Il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a deux mecs qui sont en train de démarcher pour moi dans les maisons de disque sur la place de Paris et ils se font jeter de partout, et moi, quand je fais écouter mes maquettes à des gens comme ça, tout le monde trouve ça bien ». Il lui a fait écouter la maquette, le type a pris la bande, il est allé voir Alain Lévi, il lui a dit « Signe ce mec-là, ça va être une bombe ». Et Lévi lui dit « Ça n'a pas été refusé, ça ? » Il a appelé… on peut dire les noms… il a appelé Jean-Michel Fava qui était à l'époque le directeur de production pour l'entité CBS. Fava a dit « Goldman ? Non, ça ne m'intéresse pas ». Il a appelé Philippe Duwape, décédé récemment, qui était le patron d'Epic et il lui a dit « T'as écouté un truc ? Goldman ? » « Ouais, ouais, j'ai écouté. Ça ne m'intéresse pas ». « Si, si, tu le prends ». « Non, non ». « Si, si ! Tu le prends ». Et ça c'est fait au forceps. Comme ça quoi. Ça, c'est Jean-Jacques qui me l'a dit, je ne l'invente pas. Il pourra vous le confirmer.
Ludovic Lorenzi : Donc, ça a marché. Le succès a un peu porté ses fruits aussi par rapport à Taï Phong puisque en 1984, grâce au succès de Jean-Jacques Goldman, Taï Phong ressuscite puisque WEA ressort les disques de Taï Phong et une compilation appelée « Les années Warner ». Est-ce qu'on vous en a parlé ? On vous a consulté pour ça ? Jean Mareska : En 1984, on se voyait encore pas mal avec Jean-Jacques. Moins, parce qu'il commençait à être vraiment hyper occupé, mais on se voyait de temps en temps. Et un jour, il m'appelle et me dit « Ecoute, il y a un truc bizarre chez Warner, les gros malins, bien sûr. Ils vont sortir un albun qui s'appelle « Jean-Jacques Goldman / Taï Phong, les années Warner ». Ils m'ont envoyé le test pressing de l'album et je trouve ça vraiment bizarre. Ça t'embête de l'écouter ? ». Non, bien sûr. Donc, on se voit, il me file le test pressing, je rentre chez moi, je l'écoute. Il y a les six chansons en français de Jean-Jacques sur une face et trois titres de Taï Phong sur l'autre. Sur les six chansons en français de Jean-Jacques, il y avait deux chansons qui n'étaient pas les masters originaux mais qui étaient des playbacks télé. Jean-Jacques avait, et a toujours, une manière très simple mais très efficace de construire des chansons. Généralement, vous avez une intro, vous avez un premier couplet où il chante lead, vous avez un deuxième couplet où il double sa voix, où il harmonise sa voix, vous entrez dans un refrain et là, comme c'était les playbacks télé où il était supposé chanter en direct, ça donnait qu'on avait l'intro et tout le premier couplet, il n'y avait pas de voix. Puisque la voix avait été retirée pour faire le playback télé. Et d'un seul coup, au deuxième couplet, on entendait le doublage de voix seulement. Alors, je le rappelle, je lui dis « Effectivement, ils ont fait… Il y a ça et ça ». Il les rappelle, il le leur dit, ils refont un pressage, ils retrouvent des bandes… Et puis finalement, ils ont fait cet album. Il y a eu encore d'autres péripéties, des erreurs sur la pochette… Jean- Jacques a demandé à ce que mon nom y figure, ce à quoi Warner n'avait pas pensé. Et puis le directeur du marketing de Warner à l'époque, pour l'accumulation de gaffes faites sur cet album, a envoyé une pile d'une vingtaine d'albums de Gaston Lagaffe à Jean-Jacques… pour la petite histoire [rires]. Ludovic Lorenzi : C'est vrai que ces disques dont vous parlez, avec les versions playback, sont sortis dans le commerce puisqu'on en trouve encore chez les collectionneurs.
Jean Mareska : Ah, oui ?
Ludovic Lorenzi : J'ai dû en retrouver certains.
Jean Mareska : Je ne savais pas que c'était sorti dans le commerce.
Ludovic Lorenzi : Il y a « Back to the city again », « Jour bizarre » et « Les nuits de solitude ». Il y a ces trois-là mais sur des pressages différents. C'est assez éparpillé, on ne retrouve pas les trois mêmes sur le même disque.
Jean Mareska : Ça aurait été beaucoup plus simple, même si je ne faisais plus partie de WEA à l'époque, de me passer un coup de fil en me disant « Jean, tu ne veux pas assurer la supervision de ce disque ». Et en plus, j'avais les doubles chez moi, j'avais les doubles de toutes les bandes. Je pouvais rapidement rattraper l'affaire.
Ludovic Lorenzi : Par la suite, il y a eu un nouveau 45 tours de Taï Phong, en 1986. Donc, le groupe était monté sur scène avec Jean- Jacques et ça leur a donné, redonné l'envie de refaire un disque.
Jean Mareska : De toute façon, moi, je suis resté en bon rapport avec eux. Même Jean-Alain qui vivait à Limoges et qui était en train de sombrer, le pauvre, dans l'alcool. Quand il venait à Paris, on se voyait. Moi, je voyais Khanh de temps en temps, je voyais Stéphan assez souvent. Taï avait disparu complètement de la circulation et il se disait qu'à l'époque il chantait dans le métro. Je ne l'ai jamais vu… Je ne prends pas beaucoup le métro non plus. Mais on se voyait souvent et ils avaient toujours des velléités de faire des choses. Stéphan essayait d'affirmer de plus en plus ses qualités de compositeur. Khanh rêvait du bon vieux temps où Taï Phong vendait beaucoup de disques. On se voyait, on écoutait des bandes, des maquettes, des trucs comme ça. Et puis, bon… je n'avais pas d'opportunité. Et puis, ils ont fait ce fameux concert avec Jean- Jacques, où j'étais, où ils sont montés sur scène. Et puis, à quelques temps de là, je pense que c'est vers 85, je suis rentré chez Vogue, j'ai ouvert un petit label chez Vogue, qui s'appelait Mayday. Donc, j'avais d'un seul coup un opportunité, donc quand j'ai dit à Detry qui était la patron de Vogue « J'ai la possibilité de signer certains des membres, il n'y aura plus Jean-Jacques, bien sûr, mais certains des membres de Taï Phong », il m'a dit « Vas-y ». Toujours pareil, on avait de quoi faire, on avait peut-être trois-quatre chansons. On a dit, on va faire un single, on a fait ce single. Et sans trop y croire, on a demandé à Jean-Jacques si ça ne le dérangerait pas, par rapport à sa carrière qui était déjà quelque chose d'assez abouti, de venir poser une guitare, mettre une voix. Et très gentiment, il est venu au studio un soir, mais vraiment très simplement, comme ça. Il est arrivé dans sa vieille bagnole pourrie et puis il a fait des voix jusqu'à ce qu'on lui dise « C'est Ok ». Il était vraiment à dispo et ça c'était formidable de pas avoir oublié ça. Ludovic Lorenzi : En ce qui concerne cette chanson, vous aviez prévu de la promotion puisque qu'un clip a été tourné, dont cinquante diffusions avaient été prévues sur TV6, la chaîne musicale de l'époque. Mais la chaîne s'est arrêtée. Est-ce qu'on peut mettre ça uniquement sur le compte de la malchance ? Jean Mareska : Je n'en sais rien. Peut-être, je ne sais pas. Là Taï Phong revenait avec un nouveau chanteur, qui était le batteur. Donc, ça pouvait ne pas faciliter les choses… Je ne sais pas, franchement. Vous savez, la réussite d'un disque et l'échec, ça tient à tellement peu de choses. Un petit maillon de la chaîne qui craque et puis c'est foutu.
Ludovic Lorenzi : L'échec du 45 tours a arrêté l'album, en fait. Parce qu'un album était prévu, c'était marqué derrière la pochette : « The return of the samouraï ».
Jean Mareska : Dans nos rêves les plus fous, oui. On disait que si le single décollait, on allait vite enchaîner avec un album derrière. Mais bon, le single n'ayant pas fonctionné, ça s'est arrêté. Puis, moi, j'ai quitté Vogue à ce moment-là pour entrer chez Flarenach. Et comme ce n'était pas du tout dans les orientations musicales de Flarenach de signer ce genre d'artiste, chacun a repris sa vie. Stéphan en donnant des cours de batterie, en jouant dans les orchestres, Khanh s'occupant de son magasin de musique.
Ludovic Lorenzi : De son côté, Stéphan avait une carrière solo parallèle puisqu'il a quand même tenté de sortir des 45 tours.
Jean Mareska : C'est pour vous dire combien on était restés en bons termes parce que quand j'ai quitté WEA en 80, en 82, j'ai monté une structure d'édition-production et Stéphan est venu me voir en me disant « Ecoute, j'ai des chansons. Est-ce que tu veux produire mon premier single ? » Je n'avais pas les moyens de produire un album parce que c'était une petite structure que j'avais montée. Donc, on a fait ce premier single qu'on a signé chez Barclay, d'ailleurs, toujours avec Claude Righi puisque, lui aussi se souvenait de Taï Phong et de Stéphan, bien sûr. Et puis, ce single n'a pas fonctionné. Et puis, quelques années après, on en a fait un deuxième et je crois même un troisième. Donc, on était restés en bons termes et comme c'est un groupe que j'aimais beaucoup et des gens que j'aimais bien pour la plupart, chaque fois que j'ai pu essayer de faire quelque chose, je l'ai fait.
Ludovic Lorenzi : Ensuite, les années passent et en 93, vous faites réenregistrer « Sister Jane » avec un chanteur qui s'appelle Hervé Acosta.
Jean Mareska : C'était une commande. C'était un titre de commande. Flarenach m'avait demandé pour une compilation… Le patron de Flarenach, donc, chez qui j'avais bossé dans les années 80 m'appelle en me disant « Dis moi, j'essaie d'avoir « Sister Jane » de Taï Phong chez Warner mais ils ne veulent pas me le donner. Tu ne peux pas essayer d'influencer le juridique ? ». Je lui dis « Attends, je n'ai aucune influence sur le juridique ». « Bon ! Tu ne sais pas s'il existe un cover de la chanson ? » « A ma connaissance, il n'en existe pas ». « Tu pourrais pas essayer de m'en trouver un, de m'en faire un ? » J'ai appelé Khanh, j'ai appelé Stéphan, je leur ai expliqué le pourquoi de l'affaire. J'avais rencontré Acosta chez Arcade comme ça, par hasard et je me rappelais que ce mec pouvait chanter comme Jean- Jacques. Donc, on a fait un enregistrement très simple en studio, sans les membres du groupe mais qui étaient d'accord, qui le savaient - contrairement à ce qu'ils disent - je crois. Mais ils le savaient. Je ne sais pas qui dit qu'il ne le savait pas. Ils le savaient parce que, ne serait-ce que quand la chanson est sortie sur la compilation, Khanh, forcément, a touché des droits Sacem. Donc, il le sait. C'était vraiment une chanson de commande, un cover comme ça se faisait quand une maison de disques n'arrivait pas à avoir l'original.
Ludovic Lorenzi : Ça a quand même porté puisque apparemment, c'est le point de départ d'un nouveau disque, enfin, du futur album « Sun ». Jean Mareska : Ah, non, pas du tout ! Ça, c'était vraiment un disque de commande et ça s'est passé en 93. Et puis, je pense que vers 95 ou 96, Khanh et Stéphan, qui ont dû se retrouver, se rabibocher plus ou moins puisqu'il y avait un peu de tension entre eux, mais rien de très grave. Et puis, ils avaient écrit suffisamment de chansons pour faire un album, il m'ont demandé si j'étais ok pour le produire. Et là, alors que je travaillais chez Sony… Comme j'avais conservé ma boîte d'édition-production, j'ai produit l'album, financé entièrement, quoi.
Ludovic Lorenzi : Avant de parler de « Sun », on va parler des rééditions des albums de Taï Phong en CD en France et au Japon. WEA a donc réédité les trois albums de Taï Phong en CD avec les six titres. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
Jean Mareska : Parce que ce sont des ânes et qu'ils ne savaient peut- être pas qu'ils avaient des choses qui avaient de la valeur qui dormaient dans leurs armoires blindées. Moi, je n'étais pas intéressé sur les ventes des disques à l'époque. La seule rémunération que j'ai eue pour cet album, pour le premier album de Taï Phong, c'était un billet de dix mille balles que Warner m'a donné en guise de prime. Ce qui m'a permis de m'acheter un très joli canapé pour mon living. Moi, je n'ai aucun intérêt financier à pousser Warner en disant « Mais vous êtes con, pourquoi vous ne sortez pas ça ? » Et puis un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit « Mais merde… Taï Phong, Goldman, machin… On va rééditer les albums ». Et les albums continuent à se vendre extrêmement bien.
Ludovic Lorenzi : Il paraît que, parce que ce sont les Japonais qui ont édité, ça a décidé la France a éditer aussi.
Jean Mareska : C'est fort possible. Taï Phong a eu du succès au Japon… je parle du premier album surtout et de « Sister Jane »… a eu du succès au Japon, a eu du succès un petit peu aux Pays-Bas, un petit peu en Allemagne, et il y a un single qui doit, lui aussi valoir une fortune et dont j'ai un exemplaire chez moi, c'est un pressage américain de « Sister Jane ». On a obtenu d'Atlantic ou de Warner - je pense que c'est Atlantic - qu'ils essaient… ce n'était que purement promotionnel au départ puisqu'il n'y a pas de marché de singles aux USA ou très peu… Donc c'est sorti sur un petit label, une sous-marque d'Atlantic qui s'appelle Big Tree, je crois, ou un truc comme ça. Et il y a donc un pressage américain de « Sister Jane ». Mais c'est vrai que le Japon avait beaucoup d'intérêt pour ce groupe, bien sûr pour la musique, mais aussi pour l'aspect visuel des pochettes avec le samouraï qui parlait forcément aux Japonais. Ludovic Lorenzi : Les Japonais, justement, ont réédité les albums mais ils ont rajouté cinq titres de plus sur les deux premiers albums. Des titres de singles comme « North for winter », « Let us play », « Dance », « Back again » et « Cherry ». Est-ce que vous êtes surpris de l'intérêt que les Japonais portent au groupe ?
Jean Mareska : Oui, je suis assez surpris. Je suis toujours agréablement surpris. D'ailleurs, sur le dernier album, sur « Sun », je sais qu'il y a eu beaucoup de ventes qui se sont faites à l'export et au Japon en particulier. Donc, il y a un intérêt du Japon, d'un certain public japonais pour ce groupe.
Ludovic Lorenzi : Vous n'êtes pas déçus par le peu d'intérêt que porte WEA ? Parce qu'ils auraient finalement de quoi faire un album supplémentaire avec les singles.
Jean Mareska : Oui. Ils n'y ont jamais pensé. Peut-être que ça ne les intéresse pas. Cela dit, les trois albums en pressage français vendent vraiment beaucoup et vous les retrouvez dans toutes les opérations qui sont à mid price maintenant. Vous pouvez les trouver à 59 balles dans les Fnacs, peut-être même à 49 balles dans les hypers, si les hypers les prennent. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a des opérations commerciales mid price, les trois albums - les quatre albums, disons, les trois de Taï Phong et l'album Taï Phong / Jean-Jacques - sont bien exposés et on les voit.
Ludovic Lorenzi : On va revenir à l'album « Sun ». Sept ans pour le concrétiser, ce n'est pas un petit peu long ? Ça s'est passé comment, en gros ?
Jean Mareska : Pour concrétiser l'album, ça n'a pas pris sept ans. Enfin, pour enregistrer l'album, ça n'a pas pris sept ans, Dieu merci, ça a été assez vite une fois qu'on a eu déterminé un budget, trouvé un studio. Khanh a recruté Angelo, donc le clavier. On a rappelé Acosta, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est Khanh. On est partis là- dessus, on est rentrés en studio, on a enregistré assez rapidement.
Ludovic Lorenzi : Comment est-ce que vous voyez l'avenir du groupe actuellement ?
Jean Mareska : Les membres du groupe ont tous des activités séparées, personnelles, les uns des autres qui tournent toutes plus ou moins autour de la musique. Mais il faudrait une belle opportunité pour que le groupe se reforme.
Ludovic Lorenzi : Est-ce que vous ne pensez pas que le groupe devrait se faire une identité autonome par rapport à l'image de Goldman ? Parce que j'ai l'impression que l'image de Goldman reste très forte.
Jean Mareska : Oui mais enfin, s'il n'y avait pas eu Goldman, vous ne seriez pas en train de m'interviewer aujourd'hui. On ne parlerait pas de Taï Phong. Taï Phong, même si ce n'est pas une idée qui peut plaire forcément au membres du groupe, Taï Phong existe en grande partie grâce à ce passage que Jean-Jacques a fait dans le groupe dans les années 70. C'est l'ancien groupe de Goldman. Quand on me parle de Taï Phong et que des jeunes têtes de vingt ans me disent « Mais c'est quoi Taï Phong », je dis « C'est l'ancien groupe de Goldman ». Ça recadre. Même si ça ne recadre pas musicalement, ça donne une espèce de point de repère chronologique. 1
1
Retour au sommaire - Retour à l'année 2001