
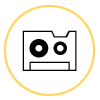
|
Ça cartonne
|
Ça cartonne
RTL, 20 novembre 2001
Anthony Martin
Retranscription de Stéphane Dumond
Anthony Martin : Cet album est présenté comme un objet et un ensemble de chansons faites pour danser, pour mettre de l’ambiance, pour rapprocher les gens et faire en sorte qu’ils sortent un peu de leur morosité. Vous trouvez que la chanson - et la chanson française en particulier - est stérile et ne fait plus d’effet ? Il manque de chaleur aujourd’hui dans le monde musical ?
Jean-Jacques Goldman : Non, je ne trouve pas, au contraire, il y a de plus en plus de musiques de danse et tout ça. Il se trouve que celui- là s’adresse plus aux pieds qu’à la tête. Mais ça n’a pas de rapport avec le contexte.
Anthony Martin : Ça vous est venu comment de faire un album présenté avec des compartiments, des styles musicaux différents à chaque chanson, qui font effectivement de l’effet car on se prend à bouger, forcément ?
Jean-Jacques Goldman : Finalement, ça vient peut-être des voyages. Dès qu’on arrive aux Antilles, en Afrique ou à Madagascar, dans un petit bar, tout à coup, le musicien arrive et il a un autre statut. Il a un statut utilitaire qui me semble beaucoup plus important que le statut que l’on donne au musicien chez nous. L’équivalent, chez nous, ce sont les musiciens de bal. Lorsqu’ils arrivent, tout à coup, ils modifient l’ambiance, ils modifient les relations entre les gens, et je trouve ça magnifique.
Anthony Martin : Vous êtes un adepte des bals populaires ?
Jean-Jacques Goldman : Non, pas trop, mais j’en ai fait beaucoup, quand j’étais adolescent. C’est là où j’ai appris, en jouant la musique des autres. J’ai fait beaucoup de bals, mais pas trop comme danseur [rires].
Anthony Martin : Plutôt pour l’ambiance et ce rapport tactile à la musique. Les gens viennent là pour danser et ça marche à chaque fois ?
Jean-Jacques Goldman : Voilà, tout à coup, ils changent. Ils ne se parlent pas, ils vont à leur boulot, ils sont dans le bus et puis, parce qu’un musicien vient, tout à coup, ils se regardent et ils vont danser, se serrer l’un l’autre, sentir leur peau, leurs odeurs, ils vont se parler, se sourire, essayer de se séduire. S’il n’y a pas la musique, il n’y a pas ça.
Anthony Martin : Vous êtes toujours fasciné par le pouvoir de la musique, ce qu’elle peut faire, ce qu’elle peut provoquer ?
Jean-Jacques Goldman : Moi, oui, je trouve ça super. Je suis encore fasciné aussi quand on voit un orchestre de cordes arriver, avec vingt personnes habillées comme n’importe quelle personne dans la rue. Puis elles ouvrent leur petite mallette, dans laquelle se trouve un morceau de bois. Sur le bois, des cordes en métal sont tendues. Puis elles prennent un autre morceau de bois avec du crin dessus. Elles frottent l’un contre l’autre et tout à coup on entend Mozart ou Vivaldi. Je trouve cela absolument fascinant.
Anthony Martin : J’imagine que vous baignez dans un univers musical, qu’il ne se passe pas une journée sans que vous jouiez de quelque chose. La musique vous fait-elle toujours de l’effet ? N’êtes-vous pas à un moment comme sevré au point de ne plus rien entendre et de ne plus être réceptif ?
Jean-Jacques Goldman : J’ai toujours baigné dans la musique depuis le début, mais c’est vrai que depuis quelques années j’y suis un peu moins réceptif. J’écoute moins et je suis plus dans la lecture. Je n’arrive pas à faire les deux en même temps. Je sais qu’il y a des gens qui lisent en écoutant de la musique mais moi, le musique me happe tellement qu’il me faut le silence. Je passe de l’un à l’autre et je suis plus dans la lecture pour l’instant que dans la musique, c’est vrai.
Anthony Martin : Pourquoi avoir choisi de faire un album qui est presque un album concept ? Chaque chanson a son style. A Lyon, chez moi, on dit qu’"à chaque chanson faut y mettre son canon" [rires]. C’est presque ça dans votre album où chaque chanson a son identité, sa couleur. Vous trouvez que les albums sont faits de chansons qui se ressemblent toutes et cela vous ennuie, c’est pour ça ?
Jean-Jacques Goldman : Pour ce qui me concerne, je n’ai jamais fait ça. J’ai toujours fait des chansons, enfin des albums de variété, on va dire. Je passais de "Quand la musique est bonne", avec des gros riffs de guitare saturée à "Comme toi" où il y avait un violon tzigane, ou aux Chœurs de l’Armée rouge, ou à "A nos actes manqués" qui était plutôt zouk, ou à des ballades plutôt folk. J’ai toujours aimé passer d’un style à l’autre, du blues au gospel aussi. Mais là il me semblait que le fait de marquer au bout de chaque chanson à quelle danse elle correspondait c’était une façon de rendre hommage justement à ces musiciens de bal.
Anthony Martin : Vous vous êtes fait aussi un petit plaisir personnel ? Le fait d’avoir à chaque fois une couleur différente lorsque vous enregistriez, avec des ambiances différentes pour la chanson folk ou le technoriental, c’était aussi pour renouveler le genre ?
Jean-Jacques Goldman : Pour me faire des plaisirs personnels, oui. Je ne fais que ça quand je fais des disques. C’est très difficile de donner du plaisir aux autres si l’on n’en prend pas soi-même. Ça m’a permis d’aller à Lorient enregistrer des cornemuses avec un vrai bagad, et puis de voir mes copains en même temps. Ça m’a permis d’aller à Alès enregistrer plus de 500 choristes dans le théâtre. Ça m’a permis de rencontrer un type qui a 30 ans et qui joue de la vielle traditionnelle et qui est devenu le spécialiste de cet instrument. C’est un album de musiciens. Il y en a plein que je connaissais mais j’ai pu en découvrir d’autres, c’est un vrai plaisir.
Anthony Martin : C’est un album de rencontres aussi ? Vous fonctionnez comme ça ? Il faut, pour aller chercher la nourriture en période d’hibernation, de composition, que vous vous déplaciez, que vous rencontriez des gens ? Comment fonctionnez-vous ?
Jean-Jacques Goldman : Je trouve que sur le plan musical, on s’enrichit beaucoup au contact des musiciens. Je leur donne des directives de base, assez précises, mais je les laisse ensuite aller dans leur direction. Lorsque j’envoie une maquette par exemple à Yvan Cassar, qui arrange les cordes, elle est très simple et je lui dis d’aller là où il veut. Après, je prends ou je ne prends pas. Mais ces rencontres-là et tout ce que les gens peuvent apporter, et en particulier les musiciens, c’est vraiment super intéressant et super jouissif.
Anthony Martin : Cet album est, je pense, fait pour la scène. En tout cas, quand on l’écoute, on a tout de suite des images et on vous voit sur scène devant une foule en délire qui alterne entre la techno, la tarentelle et tout ça. C’est vraiment une idée que vous avez eue ? Peut-être chaque album est-il fait pour la scène, mais celui là en particulier ?
Jean-Jacques Goldman : Plus on fait de la scène et plus cela intervient, plus ou moins consciemment, sur la façon de composer. C’est difficile de ne pas imaginer ce qu’une chanson va donner sur scène, si elle est faite pour la scène ou pas. On reçoit des choses tellement excitantes sur scène qu’on se donne des munitions après en composant. Je crois que ça intervient beaucoup.
Anthony Martin : On va parler un peu des paroles de cet album. J’ai l’impression que là aussi, vous vous êtes fait plaisir. Vous avez trempé votre plume dans l’acide...
Jean-Jacques Goldman : Je me fais toujours plaisir !
Anthony Martin : Oui mais cette fois, il y a quelque chose peut-être d’un peu plus franc. C’est parce que vous vous sentez plus que jamais libre, c’est ça ?
Jean-Jacques Goldman : Non, je crois que je me suis toujours lâché, pas plus spécialement sur cet album là.
Anthony Martin : Je pense notamment à la chanson étiquetée "disco" dont je n’ai pas retenu le titre, car nous avons écouté l’album hier…
Jean-Jacques Goldman : "C’est pas vrai".
Anthony Martin : Voilà, "C’est pas vrai". Je crois qu’il y a tout dans cette chanson. C’est assez exhaustif. Tous vos coups de gueule, tous vos énervements, tout y passe !
Jean-Jacques Goldman : Non, tous les lieux communs qui m’énervent. Tous les lieux communs, tout ce qu’on dit, toutes les phrases à la con quoi. Cela va des choses les plus anecdotiques comme "ah t’as pas changé" ou alors "tu verras, ça fera pas mal", ou alors "c’est à deux pas, y en a pour 5 minutes", jusqu’à des choses du genre "tous les politiciens sont corrompus", ce qui est faux. Ce n’est pas vrai. Je déteste cette phrase là. Ou alors "y a de plus en plus de racisme" aussi, ce qui est faux. Voilà. Cette chanson est un sac en plastique où j’ai mis toutes ces phrases-là qui m’agacent.
Anthony Martin : La chanson ça sert aussi à ça, quand on en fait beaucoup comme vous, quand on compose beaucoup ? On trouve toujours l’utilité d’une chanson ?
Jean-Jacques Goldman : Je trouve que l’utilité d’une chanson c’est de plaire. Je me répète peut-être mais je donne souvent l’exemple des chansons qu’on écoutait nous, qui étaient des chansons anglaises ou américaines, qui nous arrivaient sans qu’on en comprenne les textes. On les prenait uniquement sensuellemment. Elles nous plaisaient, ça passait que par les pieds ou par l’épiderme mais pas du tout par le cerveau. Après on traduisait et on se disait "tiens, Bob Dylan, il y a deux ou trois trucs qui ne sont pas mal…". La première fonction et la fonction la plus digne, la plus magique, la plus particulière de la chanson, ce qui la différencie d’un article de journal ou d’un livre, c’est ça. C’est cet aspect là. Mais ce n’est pas du tout incompatible avec le fait d’y mettre des choses.
Anthony Martin : Vous vous sentez presque obligé de mettre des choses dans chaque chanson ?
Jean-Jacques Goldman : Pas obligé, mais je sens que c’est une demande des gens. C’est-à-dire que si je fais une chanson bidon, je crois qu’ils sont déçus. Enfin, ceux qui m’écoutent…
Anthony Martin : Il y a une chanson en toute fin d’album qui est ce qu’on appelle une chanson cachée, il faut laisser passer un petit peu de temps après la dernière plage réellement annoncée sur le livret. Il n’y a pas de paroles, juste deux ou trois phrases qui sont des onomatopées en fait. Vous ne dites pas quelque chose, il n’y a pas de message en tout cas universel. Mais pourquoi avoir fait cette chanson ?
Jean-Jacques Goldman : C’était comme ça, un peu mignon, un peu marrant… Une chanson inachevée. J’ai essayé de mettre des paroles sur cette chanson. C’est une chanson qui s’appelle donc "La vie c’est mieux quand on est amoureux". Ça, c’est le thème. Après, j’ai essayé de dire "parce que ceci" ou "parce que cela". J’ai commencé à écrire et je me suis rendu compte que cela ne servait à rien. Une fois qu’on a dit "la vie c’est mieux quand on est amoureux", on a tout dit. Enfin tout ce que veut dire la chanson. Voilà, donc le reste du temps, j’ai fait "nanana nanana, nanana nanana" [rires] juste comme ça, et puis avec le refrain qui disait cette phrase.
Anthony Martin : Ce n’est pas un lieu commun de dire que "la vie c’est mieux quand on est amoureux" ?
Jean-Jacques Goldman : Peut-être, peut-être ! Mais c’est comme quand on dit "Tant qu’on a la santé". Ça paraît tout con, mais le jour où on le vit soi-même, on se rend compte que… que c’est vrai, quoi.
Anthony Martin : Les politiciens corrompus, vous ne l’avez donc pas vécu vous-même ?
Jean-Jacques Goldman : Non, les politiciens ne sont pas corrompus ! Enfin, pas tous.
Anthony Martin : C’est vrai que "la vie c’est mieux quand on est amoureux" ?
Jean-Jacques Goldman : Moi je trouve. La vie, elle est bien, mais tout à coup, quand qu’on est amoureux, tout a un petit peu plus de couleur. Tout est un petit peu différent. Ce n’est pas valable pour moi spécialement. C’est valable pour tout le monde. On se rend compte que dans nos existences, tout à coup, les couleurs sont un tout petit peu différentes.
Anthony Martin : Je voulais vous demander quelque chose : je fais ce métier à RTL, je suis spécialisé dans la musique donc je reçois tous les albums. En gros, vous êtes dans le livret d’un album sur cinq de chanson de variété française, soit sous le nom de Sam Brewski, soit votre frère est là. On sent bien qu’il y a votre "patte". Il y a quelque chose. Vous êtes omniprésent. Comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Vous passez votre vie entière à composer, à faire de la musique, à rencontrer les chanteurs, à travailler avec eux ?
Jean-Jacques Goldman : Non, mais déjà, il faut vraiment différencier mon frère et moi. Mon frère fait de la musique depuis très longtemps, et il se trouve que tout à coup ça commence à marcher pour lui. Evidemment, ça multiplie les choses, mais ce n’est pas moi ! Je ne suis même pas au courant de ce qu’il fait.
Anthony Martin : Vous savez que vous avez les mêmes mélodies et la même façon de faire de la musique en tout cas...
Jean-Jacques Goldman : Ah mais ça, on a écouté les mêmes musiques, lui m’a beaucoup écouté, on a travaillé ensemble, on a fait des choses ensemble, donc on aime le même genre de musique. On n’est pas les seuls à faire ce même style de musique, il y en a d’autres. Au début, mon frère ne faisait pas de textes, maintenant il en écrit. Pour ce qui me concerne, je crois que l’année dernière, j’ai fait un texte pour de Palmas et puis c’est tout. Je fais de moins en moins de choses.
Anthony Martin : Il y a eu Patricia Kaas, Isabelle Boulay…
Jean-Jacques Goldman : Isabelle Boulay ? Je n’ai rien fait pour Isabelle Boulay. J’ai fait une chanson pour Noah aussi pour son album, chanson que l’on n’a pas entendue. Je n’ai pas beaucoup travaillé à part sur mon album. Je suis loin d’être omniprésent.
Anthony Martin : Alors la "patte" Goldman est omniprésente. C’est ça qui vous fait chaud au cœur, de voir que sans que vous vous mêliez de quoi que ce soit, on retrouve votre son, votre façon de faire, vos accords, votre façon d’écrire et de chanter ?
Jean-Jacques Goldman : Oui mais moi je me suis tellement inspiré de Michel Berger, je l’ai tellement écouté ! J’ai tellement écouté Elton John ou les bluesmen… Quand vous avez du succès, les gens essaient de vous copier et le jour où vous n’avez plus de succès, on ne vous copie plus. Je suppose qu’après Trénet, il y a eu des milliers de petits Trénet qui sont arrivés. C’est comme ça.
Anthony Martin : Avant votre arrivée, je discutais avec le chef de produit ici qui disait que lorsqu’un album de Goldman arrive, on est ravi, mais on ne se fait même plus de souci, on sait que ça va se vendre. Comment le vivez-vous ?
Jean-Jacques Goldman : Avec beaucoup de confort, c’est sûr. C’est sûr que c’est différent des premiers albums où on ne connaît pas les gens, où on se demande si on va les toucher. Chaque disque vendu est une surprise et une émotion, parce qu’on se dit que quelqu’un a été touché par ce que l’on a fait. Mais au bout de 20 ans, évidemment, on s’habitue plus à ça, la connexion est plus directe. C’est un peu comme quand on rencontre quelqu’un de sa famille. On essaie juste de ne pas se décevoir, d’être le plus sérieux possible. Mais c’est vrai que l’enjeu n’est plus le même.
Anthony Martin : Comment cette confiance, cette longueur d’avance, se manifeste-t-elle concrètement ? Vous êtes moins angoissé, vous avez plus de liberté, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez ? Vous pouvez rendre à la maison de disque le travail que vous voulez ?
Jean-Jacques Goldman : Oui mais ça a presque toujours été le cas. Au début, on ne croyait pas beaucoup en moi dans les maisons de disques, donc on ne me demandait rien. Et puis ça a commencé à marcher assez vite puisque dans le premier album se trouvait "Il suffira d’un signe". Dans le deuxième, il y avait "Quand la musique est bonne", etc. A partir du moment où vous avez du succès, les maisons de disques vous laissent vraiment tranquille et vous font confiance.
Anthony Martin : J’aimerais revenir à votre travail de musicien. Est- il vrai que vous travaillez en pantoufles au studio ? [rires]
Jean-Jacques Goldman : C’est-à-dire que maintenant, les studios sont chez soi. Le volume du matériel a diminué et l’on n’est plus obligé d’aller en studio pour beaucoup de choses, pour les voix, les guitares, et tout ça. Chez moi, je suis en pantoufles et en studio, je suis en chaussures.
Anthony Martin : Vous composez souvent à domicile. Grâce au home studio, vous travaillez chez vous la plupart du temps ?
Jean-Jacques Goldman : Toujours. Les compositions, ça se fait à son piano, à sa guitare. Ça se fait chez soi, ou alors en vacances, mais ça ne se fait pas en studio. Enfin je crois.
Anthony Martin : De quoi avez-vous besoin concrètement pour composer ? Il vous faut, de manière très scolaire, un petit cahier avec un stylo ou ça arrive n’importe quand, comme ça, par jet, pouf ?
Jean-Jacques Goldman : Ça arrive n’importe quand mais après j’ai besoin d’un petit cahier exactement et d’un stylo et là le travail commence. Le travail dure longtemps, un an. Mais il se fait autour de la matière première qui est venue n’importe quand.
Anthony Martin : Etes-vous laborieux dans l’écriture et la composition ? Qu’est-ce qui est le plus facile chez vous ?
Jean-Jacques Goldman : Je suis très laborieux. Le plus facile, ce sont les idées qui viennent et que je note. Mais à partir de ce moment, il y a vraiment du travail.
Anthony Martin : Ce qui vous pose le plus de problème, c’est de trouver le mot juste, c’est le souci de la rigueur ?
Jean-Jacques Goldman : Non, maintenant, ce qui me pose le plus de problèmes ce sont les musiques parce qu’on tourne en rond. J’ai fait, je ne sais pas, près de 200 chansons peut-être, et je n’ai pas une suite d’accords très jazz et très différents, en plus ça ne me plaît pas des masses, donc je retombe toujours un peu sur les mêmes mélodies. Mais c’est le cas de tout le monde.
Anthony Martin : Ça vous ennuie ?
Jean-Jacques Goldman : Oui, ça m’ennuie parce que j’aimerais trouver des choses un peu plus nouvelles.
Anthony Martin : Qu’est-ce qu’il faudrait pour cela ?
Jean-Jacques Goldman : Rien, je crois qu’il faut mourir, c’est tout. Mais tout le monde est dans ce cas. Si vous écoutez Brassens à ses débuts et Brassens à la fin, si vous écoutez mes collègues, au bout de dix albums… Ou même le dernier Dylan ou le dernier Mc Cartney : on sait que c’est du Dylan et du Mc Cartney. Idem pour Michael Jackson. Si des gens aussi talentueux finissent par refaire ce qu’ils ont fait, c’est qu’on ne peut pas vraiment échapper à ça.
Anthony Martin : Vous écoutez beaucoup les disques des autres ?
Jean-Jacques Goldman : Pas beaucoup non. Je n’écoute pas beaucoup de musique.
Anthony Martin : C’est peut-être pour cela que dans l’approche de cet album vous vous êtes imposé de faire un style une chanson, une chanson une couleur. Vous avez cherché à casser cette logique qui vous fait faire toujours un peu la même chose ?
Jean-Jacques Goldman : Non non, ce n’est pas trop pour ça, parce que toutes ces choses qui sont sur l’album, je les ai déjà faites. Que ce soit un rock, un rythm & blues, un zouk, une ballade, un slow… Ce sont des choses qui ne sont pas très nouvelles.
Anthony Martin : Les copains dans le métier. On sait, et c’est tout à votre honneur, très peu de chose sur vous. Vous avez des potes qui sont chanteurs ? Vous vous voyez souvent ? On imagine des réunions Cabrel, Souchon, Goldman, Le Forestier, ou d’autres, tous ensemble. Ça se passe comme ça ?
Jean-Jacques Goldman : Non. On ne se voit pas si souvent que ça. On est tous un peu solitaire. Mais par contre, on peut parler d’une vraie fraternité. Quand on se revoit, quand on se croise ou quand on a un souci et qu’on s’appelle, on est toujours présent les uns par rapport aux autres. C’est vraiment une génération très sympa. Je suis super content d’avoir été chanteur en même temps que cette génération-là.
Anthony Martin : Qu’est-ce qui vous rapproche ? Le fait que vous soyez tous au top, au même niveau, ou une vraie complicité dans l’approche et dans la conception de la musique, dans la façon de dire, de chanter ou d’aborder ce métier ?
Jean-Jacques Goldman : Je dirais que c’est des valeurs communes par rapport à ce métier. C’est-à-dire une estime qui ne dépend pas justement ni du succès ni de la notoriété mais de ce que l’autre fait. Je sais que Francis peut très bien détester des albums que j’ai faits et aimer bien un texte. On peut être archi-fan de Philippe Lafontaine par exemple, qu’il ait du succès ou qu’il n’en ait pas. Je crois que c’est l’absence d’ego en ce qui nous concerne, ce qui est assez rare, et surtout la fascination pour les mêmes choses, pour un vrai musicien. On est des petits garçons nous devant un solo de guitare comme celui de Basile [Leroux] lors du concert de blues qu’on vient de faire avec Francis.
Anthony Martin : On a du mal à le croire, ça, votre absence d’ego, quand on en arrive là. Vous êtes le chanteur numéro un, le compositeur numéro un en France. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut un ego surdimensionné pour y arriver quand même !
Jean-Jacques Goldman : Non, il faut faire des bonnes chansons, enfin, des chansons qui plaisent.
Anthony Martin : Il faut tout de même un moteur. D’où vient ce moteur ?
Jean-Jacques Goldman : C’est le plaisir de faire des chansons.
Anthony Martin : Uniquement ?
Jean-Jacques Goldman : Oui oui, je le jure ! Et c’est la même chose pour les autres, que ce soit Souchon, Voulzy ou Francis. On apprécie tous à mort la notoriété, le fric, et puis tout ça, mais bon on n’est pas partis en Suisse non plus pour pas payer d’impôts ! On s’en fout. On n’est pas footballeur. C’est pas du tout l’essentiel. On apprécie ça, mais au-dessus de tout, il y a ce respect et cet amour des chansons, de la musique et des mots, vraiment.
Anthony Martin : Quelle est LA chanson que vous n’avez pas composée et que vous vénérez ?
Jean-Jacques Goldman : Il y en a plein ! On pense évidemment à des chansons comme "Avec le temps" ou "L’Auvergnat" par exemple. Mais même une chanson comme "Plus près des étoiles" de Gold, que j’aurais pu faire, que je trouve parfaite et que j’adore. "Je te suivrai" de Cabrel. Dans Voulzy, toutes [rires], ou Souchon...
Anthony Martin : "Mourir pour des idées" de Brassens ?
Jean-Jacques Goldman : Non, pas celle là ! [rires]
Anthony Martin : Je croyais savoir… Avez-vous l’impression de détenir la recette de la bonne chanson, du tube, d’avoir compris quels ingrédients il fallait mettre pour que ça marche à coup sûr ?
Jean-Jacques Goldman : Non. Et je trouve que je n’ai pas fait de tube depuis longtemps, des gros tubes, des trucs comme "Aïcha", "Je te donne", "Pour que tu m’aimes encore" ou comme par exemple "A ma place" de Bauer et Zazie. Des trucs qui tout à coup prennent leur envol et on ne sait pas où ça va. J’ai fait des succès récemment, mais pas de tube.
Anthony Martin : Mais ça fait quand même généralement mouche à chaque fois.
Jean-Jacques Goldman : Oui mais un tube c’est autre chose. Un tube, c’est une chanson qui tout à coup décolle. Je ne parle pas des succès. Les succès, tout le monde peut en faire. Mais une chanson qui tout à coup te dépasse, comme "Belle", qui passe partout jusque dans les ascenseurs, qu’on entend tout le temps, qui devient presque un phénomène, ça fait longtemps que je n’en ai pas fait.
Anthony Martin : Mais vous en avez fait. Et ça vous fascine ?
Jean-Jacques Goldman : Oui, j’adore ça.
Anthony Martin : Vous cherchez à atteindre cet effet-là à chaque fois que vous composez ? Vous ne pouvez pas libérer une chanson et la mettre sur un album tant qu’il n’y a pas ce petit plus magique ?
Jean-Jacques Goldman : Pour mes albums, non. Pour mes albums, j’ai l’impression que c’est une conversation avec des gens qui me sont fidèles. Il y en a qui ne m’aiment pas et ne m’aimeront jamais. Il y en a d’autres me suivent et là c’est une conversation avec eux. J’écris ce qui me plaît, mais aussi j’ai l’impression de reprendre la discussion là où l’avait laissée l’album précédent. Donc non. Mais pour les autres, oui. Pour les autres je ne vise que ça : la chanson qui va sortir des transistors, des télés et qui va aller dans la rue.
Anthony Martin : Mais justement, à chaque fois, vous faites ça pour les autres. Vous faites des chansons qui marchent, qui sont des gros succès, même s’ils ne passent pas tous dans les ascenseurs. Dans ces phases de composition, savez-vous ce qu’il faut mettre dans une chanson pour qu’elle marche ?
Jean-Jacques Goldman : Non. Je ne sais pas. Et je me trompe souvent. Je sais comment faire une "bonne chanson", mais personne ne sait faire une "Foule sentimentale" ou une chanson qui va marquer une année.
Anthony Martin : Que faut-il pour qu’une chanson soit une "bonne chanson" ?
Jean-Jacques Goldman : Il faut être dans l’air du temps mais pas trop, il faut le texte qui va toucher comme "La vie par procuration", "Foule sentimentale" ou comme "La corrida". Tout à coup, ça on le sait quand on a trouvé un thème de chanson qui n’est peut-être pas universel mais qui est fort, un angle, une façon de voir les choses qui est différente. Et sur le plan musical, on ne sait pas, parce que ça va être pour beaucoup une magie d’arrangement qui n’est jamais prévisible. Des fois, "ça le fait" et des fois, "ça ne le fait pas". Il suffit d’un son qui va tout modifier. A ce niveau là, personne ne contrôle rien.
Anthony Martin : Vous parliez tout à l’heure de Michel Berger, qui adorait aussi composer pour les autres et évidemment pour les femmes. Est-ce que, comme lui, vous vous projetez dans celle pour laquelle vous composez ou vous écrivez lorsque vous écrivez pour Patricia Kaas ou pour d’autres ?
Jean-Jacques Goldman : Qu’entendez-vous par se projeter ? Est-ce que je me mets à sa place ?
Anthony Martin : Se mettre à la place, c’est aussi l’une des facettes du métier lorsqu’on écrit pour les autres. C’est comme ça que vous l’abordez ?
Jean-Jacques Goldman : Tout à fait. Si j’ai fait "Une fille de l’Est", "Il me dit que je suis belle" ou "Je voudrais la connaître" pour Patricia, c’est parce que c’était elle, parce qu’elle est crédible dans ce qu’elle dit. Ça c’est important aussi que l’autre soit crédible dans ce qu’il raconte. Je ne vais pas faire à Patricia Kaas une chanson qui parle de la politique au Sénégal ou du mondialisme. Il faut que la personne soit crédible. C’est ce qui est super intéressant dans cet exercice. Quand je fais des chansons pour Céline ou pour Johnny, il faut qu’ils soient crédibles, que les chansons leur ressemblent. "L’envie", c’est bien que Johnny la chante.
Anthony Martin : Quels rapports avez-vous avec vos interprètes ?
Jean-Jacques Goldman : D’abord des rapports respectueux sur le plan vocal et ensuite des rapports respectueux sur le plan humain. Je ne pourrais pas travailler avec des gens qui me gonflent ou que je ne respecte pas.
Anthony Martin : Lorsque vous travaillez avec vos interprètes, vous êtes le chef ? Vous attendez de l’artiste qu’il prenne la chanson dans laquelle vous avez mis tellement de cœur à bras le corps pour l’emmener vers les sommets ?
Jean-Jacques Goldman : Je connais la chanson et je sais quel effet elle doit me faire. Je suis ouvert à tout ce qu’ils peuvent proposer mais si ça ne me plaît pas, je leur dis non. Mais ils sont super à l’écoute car ils sont habitués à travailler avec des auteurs- compositeurs. Comme des acteurs, ils se plient aux désirs du metteur en scène en proposant des choses. Je suis super ouvert à tout ce qu’ils peuvent m’apporter. Quand Céline Dion ou Carole Fredericks commencent à improviser, je suis preneur, c’est sûr !
Anthony Martin : Vous arrive-t-il de faire des chansons que vous jetez après les avoir terminées ?
Jean-Jacques Goldman : Oui, mais elles restent inabouties, inachevées ou incomplètes. Et puis j’attends. Il est rare qu’elles ne ressortent pas un jour un peu modifiées, plus abouties ou mûries.
Anthony Martin : Comment le vivez-vous ? C’est une grosse déception ?
Jean-Jacques Goldman : Non, ce qui est une déception parfois, c’est justement de finir une chanson à laquelle on croit beaucoup, et finalement de se dire "Ah ben c’est que ça…". Mais parfois, on a l’inverse sur une chanson que l’on a faite comme ça et qui se révèle être beaucoup plus que ce que l’on croyait.
Anthony Martin : Etes-vous dépassé parfois par le pouvoir d’une chanson ? Vous semblez y attacher tellement d’importance, apparemment. Est-ce que la magie d’une chanson, même si elle vient de vous, peut vous dépasser complètement ?
Jean-Jacques Goldman : Oui bien sûr. Comme je vous l’ai dit, personne ne peut contrôler un tube. Je n’aime pas ce mot qui est un peu péjoratif mais… vous comprenez ce que je veux dire ? C’est une chanson qui passe tout à coup dans la rue, qui est chantée. Ce sont les gens qui se l’approprient et qui en font ce qu’elle est. Et c’est super de voir ça.
Anthony Martin : Avant que la chanson soit disponible, soit offerte au public, quand vous réécoutez votre travail en studio, vous arrive-t-il de pleurer ou d’éclater de rire, d’être ravi du pouvoir de la chanson, d’écouter, tout à coup de devenir auditeur de votre boulot et de dire "Wow !!" ?
Jean-Jacques Goldman : Ça m’est arrivé quelquefois.
Anthony Martin : Sur quelles chansons ?
Jean-Jacques Goldman : "Quand la musique est bonne", j’étais sûr, "Je te donne", j’étais sûr. C’était surtout à cette époque-là. "L’envie", je n’en étais pas sûr parce que je me disais que c’était une chanson qui ne pouvait pas passer en radio parce qu’elle était trop bizarre, mais j’étais super content de ce que j’entendais. A contrario, des chansons que je n’ai pas du tout senties, c’est par exemple "Pour que tu m’aimes encore", qui était pour moi une chanson mineure de l’album.
Retour au sommaire - Retour à l'année 2001